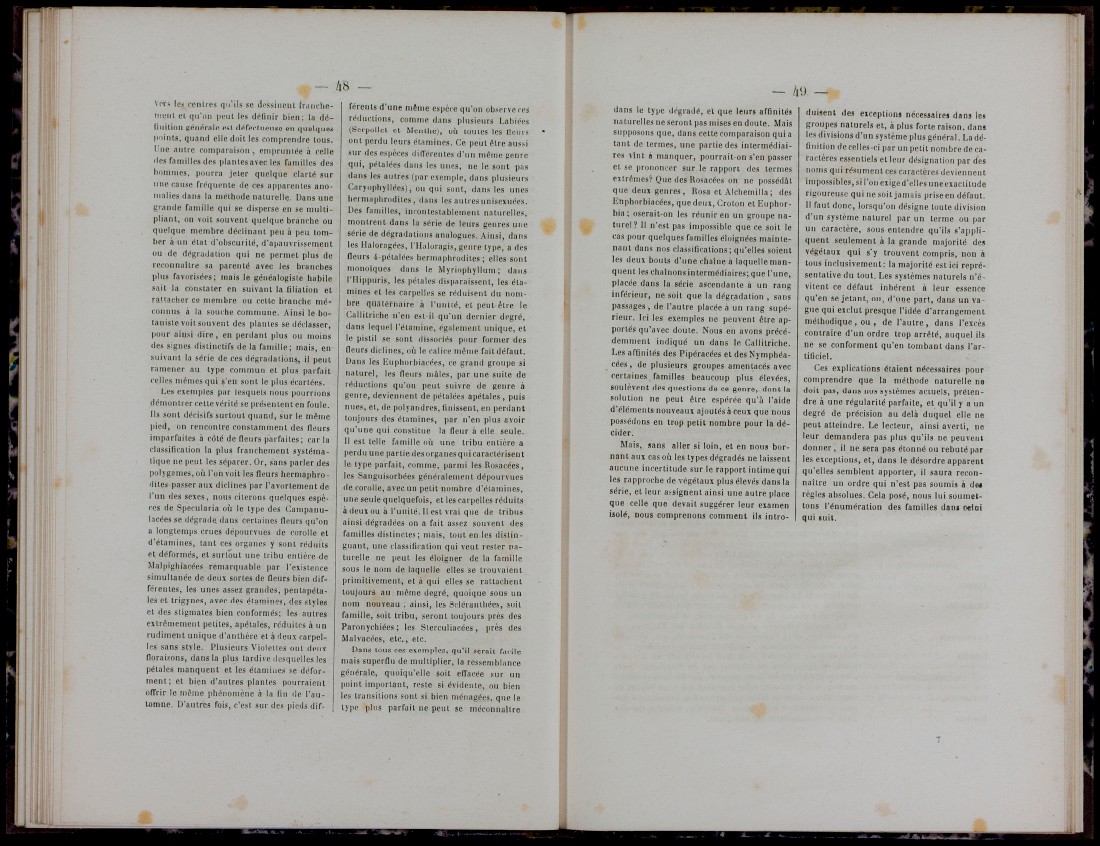
/ 1 8
- h\}
fi I
VOVS les ceñiros (pTils se dossincnt franclieinont
cl q\\\m peut les définir bien: la déliiiition
générale est défectueuse en quelques
points, quand elle doit les comprendre tous.
Une autre comparaison, empruntée à celle
des familles des plantes avec les familles des
hommes, pourra jeter quelque clarté sur
une cause fréquente de ces apparentes anomalies
dans la méthode naturelle. Dans une
g r a n d e famille qui se disperse en se ïnultip
l i a n t , on voit souvent quelque branche ou
q u e l q u e membre déclinant peu à peu tomber
à un éiat d'obscurité, d^pauvrissement
ou de dégradation qui ne permet plus de
r e c o n n a î t r e sa parenté avec les branches
plus favorisées; mais le généalogiste habile
sait la constater en suivant la filiation et
r a t t a c h e r ce membr e ou cette branche méconnus
à la souche comrmine. Ainsi le bot
a n i s t e voit souvent des piaules se déclasser,
pour ainsi dire, en perdant plus ou moins
des signes dislinctifs de la famille; mais, en
s u i v a n t la série de ces dégradat ions, il peut
r a m e n e r au type commun et plus parfait
celles mêmes qui s'en sont le plus écartées.
Les exemples par lesquels nous pourrions
d é m o n t r e r cette vér i t é se p résentent en foule.
Ils sont décisifs sur tout quatïd, sur le même
pied, on rencontre constamment des fleurs
i m p a r f a i t e s à côté de fleurs parfai tes; caria
classification la plus franchement systémat
i q u e ne peut les séparer. Or, sans parler des
polygames, où Ton voit les fleurs hermaphr o •
dites passer aux diclines par Tavortement de
Tun des sexes, nous citerons quelques espèc<
ïs de Specularia oii le type des Campanulaeées
se dégrada dans certaines Heurs qu'on
a longtemps crues dépourvues de corolle et
d ' é l a m i n e s , tant ces organes y sont réduits
e t déformés, et surtout une tribu entière de
Malpighiacées remarquable par Texisience
s i m u l t a n é e de deux sortes de fleurs bien diff
é r e n t e s , les unes assez grandes, pentapétales
et trigynes, avec des étamines, des styles
et des stigmates bien conformés; les autres
e x t r ê m e m e n t pelites, apétales, réduites à un
r u d i m e n t unique d'anthère et à deux carpelles
sans style. Plusieurs Violettes ont deux
floraisons, dans la plus tardive desquelles les
pétales manquent et les étamines se déform
e n t ; et bien d'autres plantes pourraient
o f f r i r le môme phénomène à la fin de l'automne.
D'autres fois, c'est sur des pieds diff
é r e n t s d'une mêriie espèce qu'on observe (Cîi
r é d u c t i o n s , comme dans plusieurs Labiées
(Serpollet et Menthe), où toutes les fleurs
ont perdu leurs étamines. Ce peut être aussi
sur des espèces diliérentes d'un même genre
q u i , pétalées dans les unes, ne le sont pas
dans les autres (par exemple, dans plusieurs
Caryophyllées), ou qui sont, dans les unes
h e r m a p h r o d i t e s , dans les autresunisexuées.
Des families, incontestablement naturelles,
m o n t r e n t dans la série de leurs genres une
série de dégradations analogues. Ainsi, dans
les Halorngées, THaloragis, genre type, a des
fleurs 4-pétalées hermaphrodites; elles sont
monoïques dans le Myriophyllum ; dans
r i i i p p u r i s , les pétales disparaissent, les étamines
et les carpelles se réduisent du nombre
quaternaire à l'unité, et peut-être le
C a l l i t r i c h e n'et» est-il qu'un dernier degré,
dans lequel l'éiamine, également unique, et
le pistil se sont dissociés pour former des
fleurs diclines, où le calice même fait défaut .
Dans les ïiuphorbiacées, ce grand groupe si
n a t u r e l , les fleurs n)âles, par une suite de
réductions qu'on peut suivre de genre à
genre, devientient de pétalées apétales, puis
nues, et, de polyandres, finissent, en perdant
t o u j o u r s des étamines, par ti'en plus avoir
q u ' u n e qui constitue la fleur à elle seule.
Il est telle famille où une tribu entière a
perdu une partie des o rganes qui caractérisent
le type parfait, comme, parmi les Rosacées,
les Sanguisorbées généralement dépourvues
d e corolle, avec un petit nombre d'étamines,
u n e seule quelquefois, et les carpel les réduits
à deux ou à l'unité. 11 est vrai que de tribus
ainsi dégradées on a fait assez souvent des
familles distinctes; mais, tout en les disting
u a n t , une classification qui veut rester nat
u r e l l e ne peut les éloigner de la famille
sous le nom de laquelle elles se trouvaient
p r i m i t i v e m e n t , et à qui elles se rattachent
t o u j o u r s au môme degré, quoique sous un
nom nouveau : ainsi, les Scléranthées, soit
famille, soit tribu, seront toujours près des
Paronychiées ; les Sterculiacées, près des
Malvacées, etc., etc.
Dans tous ces exemples, qu'il serait facile
mais superflu de multiplier, la ressemblance
générale, quoiqu'elle soit efl'acée sur un
point important, reste si évidente, ou bien
les transitions sont si bien ménagées, que le
type plus parfait ne peut se méconnaître
dans le type dégradé, et que leurs affinités
n a t u r e l l e s ne seront pas mises en doute. Mais
su|)posons que, dans cette comparaison qui a
t a n t de termes, une partie des intermédiaires
vînt à manquer, pourrait-on s'en passer
e t se prononcer sur le rapport des termes
extrêmes? Que des Rosacées on ne possédât
q u e deux genres, Rosa et Alchemilla; des
Euphorbiacées, que deux, Croton et Euphorbia
; oserait-on les réunir en un groupe naturel
? Il n'est pas impossible que ce soit le
cas pour quelques familles éloignées mainten
a n t dans nos classifications ; qu'el les soient
les deux bouts d'une chaîne à laquellemanq
u e n t les cha înons intermédiai res ; que l'une,
placée dans la série ascendante à un rang
i n f é r i e u r , ne soit que la dégradation , sans
p a s s a g e s , de l'autre placée à un rang supér
i e u r . Ici les exemples ne peuvent être apportés
qu'avec doute. Nous en avons précéd
e m m e n t indiqué un dans le Callitriche.
Les affinités des Pipéracées et des Nymphéac
é e s , de plusieurs groupes amenlacés avec
c e r t a i n e s familles beaucoup plus élevées,
soulèvent des quest ions de ce genre, dont la
s o l u t i o n ne peut être espérée qu'à l'aide
d ' é l é m e n t s nouveaux ajoutés à ceux que nous
possédons en trop petit nombre pour la décider.
Mais, sans aller si loin, et en nous born
a n t aux cas o ù les types dégradés ne laissent
a u c u n e incertitude sur le rapport intime qui
les rapproche de végélaux plus élevés dans la
série, et leur ai^signent ainsi une autre place
que celle que devait suggérer leur examen
isolé, nous comprenons comment ils introd
u i s e n t des exceptions nécessaires dnns Íes
groupes naturels et, à plus forte raison, dans
les divisions d 'un système plus général . La définition
decelles-ci p a runpe t i t nombredecaractères
essentiels et leur désignation par des
noms qui résument ces caractères deviennent
impossibles, si l'on exiged'ellesuneexaciitude
rigoureuse qui nesoit jamai s priseen défaut.
II faut donc, lorsqu'on désigne toute division
d ' u n système naturel par un terme ou par
u n caractère, sous entendre qu'ils s'appliq
u e n t seulement à la grande majorité des
végétaux qui s'y trouvent compris, non à
tous inclusivement : la major i t é est ici représ
e n t a t i v e du tout. Les systèmes naturels n'évitent
ce défaut inhérent à leur essence
q u ' e n se j e t ant , ou, d'une part, dans un vague
qui exclut presque l'idée d'arrangement
m é t h o d i q u e , ou , de l'autre, dans l'excès
c o n t r a i r e d'un ordre trop arrêté, auquel ils
n e se conforment qu'en tombant dans l'artificiel.
Ces explications étaient nécessaires pour
c o m p r e n d r e que la méthode naturelle na
doit pas, dans nos systèmes actuels, prétend
r e à une régularité parfaite, et qu'il y a un
degré de précision au delà duquel elle ne
peut atteindre. Le lecteur, ainsi averti, ne
leur demandera pas plus qu'ils ne peuvent
d o n n e r , il ne sera pas étonné ou rebut é par
les exceptions, et, dans le désordre apparent
q u ' e l l e s semblent apporter, il saura reconn
a î t r e un ordre qui n'est pas soumis à dei
règles absolues. Cela posé, nous lui soumettons
rénumération des familles dans oclai
qui suit.
H
i i L