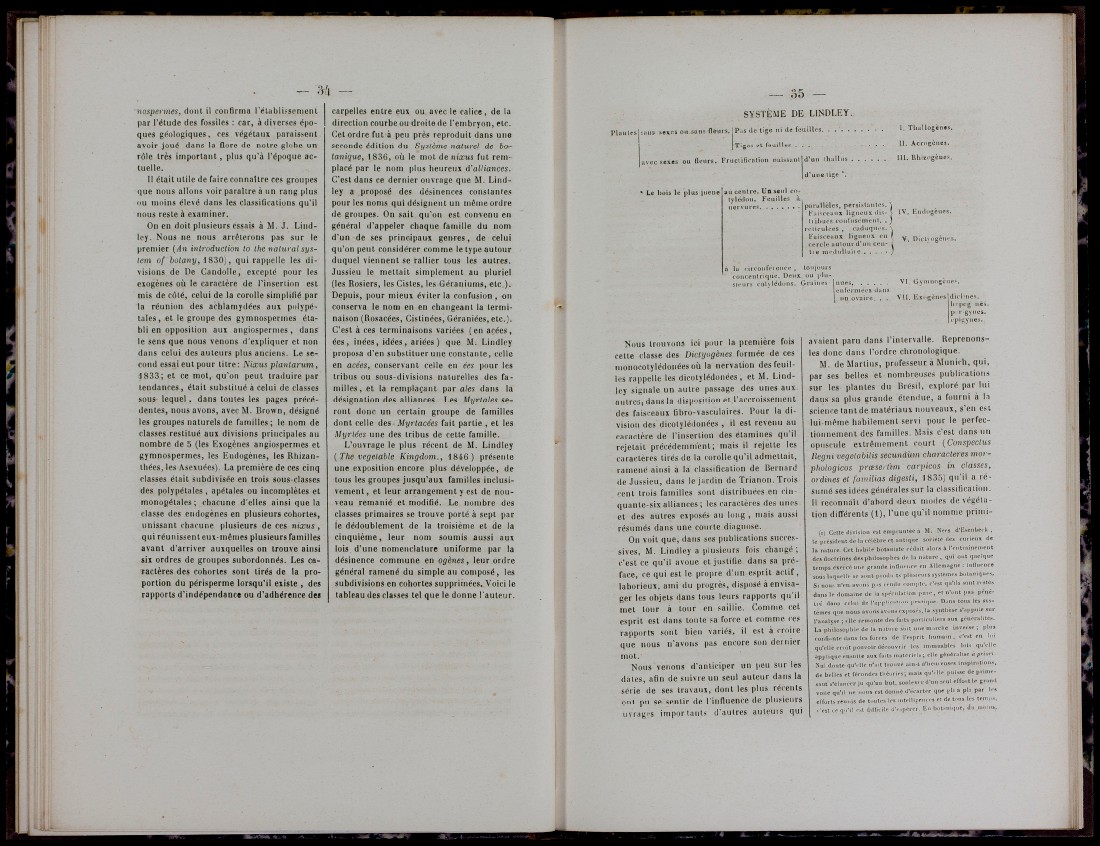
- a/i —
nospennes, dont il confirma rélabliisenienl
par rétude des fossiles : car, à diverses é[)0-
ques géologiques, ces végétaux paraissent
avoir joué dans la flore de notre globe un
rôle très important , plus qu'à l'époque actuelle.
Il était utile de faire conna î t r e ces groupes
que nous allons voir paraître à un rang plus
ou moins élevé dans les classifications qu'il
nous reste à examiner.
On en doit plusieurs essais à M. J. Lindley.
Nous ne nous arrêterons pas sur le
premier hUrodiiction to the natural system
of botany, AS30), qui rappelle les divisions
de De Candolle, excepté pour les
exogèties où le caractère de l'insertion est
mis de côté, celui de la corolle simplifié par
la réunion des achlamydées aux polypét
a l e s , et le groupe des gymnospermes établi
en opposition aux angiospermes, dans
le sens que nous venons d'expliquer et non
dans celui des auteur s plus anciens. Le second
essai eut pour titre: Nixus plantarum,
1 8 3 3 ; et ce mot, qu'on peut traduire par
t e n d a n c e s , était substitué à celui de classes
sous lequel, dans toutes les pages précédentes,
nous avons, avec M. Brown, désigné
les groupes naturels de familles ; le nom de
classes restitué aux divisions principales au
nombre de 5 (les Exogènes angiospermes et
gymnospermes, les Endogènes, les Rhizanthées,
les Asexuées). La première de ces cinq
classes était subdivisée en trois sous-classes
des polypétales , apétales ou incomplètes et
m o n o p é t a l e s; chacune d'elles ainsi que la
classe des endogènes en plusieurs cohortes,
u n i s s a n t chacune plusieurs de ces nioeus,
qui réunissent eux-mêmes plusieurs familles
avant d'arriver auxquelles on trouve ainsi
six ordres de groupes subordonnés. Les caractères
des cohortes sont tirés de la proportion
du périsperme lorsqu'il existe , des
rapports d' indépendance ou d'adhérence de«
carpelles entre eux ou avec le calice, de la
direction courbe ou droite de l'embryon, etc.
C e t o r d r « fut à peu près reproduit dans une
seconde édition du Système naturel de 6atanique,
1836, où le mot de nixus fut remplacé
par le nom plus heureux iV all tances.
C'est dans ce dernier ouvrage que M. Lindley
a proposé des désinences constantes
pour les noms qui désignent un même ordre
de groupes. On sait qu'on est convenu en
général d'appeler chaque famille du nom
d ' u n de ses principaux genres, de celui
q u ' o n peut considérer comme le type autour
duquel viennent se rallier tous les autres.
Jussieu le mettait simplement au pluriel
(les Rosiers, les Cistes, les Géraniums, etc.).
Depuis, pour mieux éviter la confusion , -on
conserva le nom en en changeant la terminaison
(Rosacées, Cistinées, Géraniées, etc.).
C'est à ces terminaisons variées (en acées,
é e s , inées, idées, ariées ) que M. Lindley
proposa d'en substituer une constante, celle
en acées, conservant celle en ees pour les
t r i b u s ou sous-divisions naturelles des fam
i l l e s , et la remplaçant par aks dans la
désignation des alliances. Les Myrtales seront
donc un certain groupe de familles
dont celle des Myrtacées fait partie , et les
Myrlées une des tribus de cette famille.
L'ouvrage le plus récent de M. Lindley
{The vegetable Kingdom,, 1846) présente
une exposition encore plus développée, de
tous les groupes jusqu'aux familles inclusivement
, et leur arrangement y est de nouveau
remanié et modifié. Le nombre des
classes primaires se trouve porté à sept par
Îe dédoublement de la troisième et de la
c i n q u i è m e , leur nom soumis aussi aux
lois d'une nomenclature uniforme par la
désinence commune en ogènes y leur ordre
général ramené du simple au composé, les
subdivisions en cohortes supprimées. Voici le
tableau des classes tel que le donne l'auteur.
— 35
P i a u l e s sans sex.cs ou sniis fleurs.
SYSTÈME DE LINDLEY.
Pas de lige rn de feuilles
Tiges et feuilles
I. Thuliogèuas.
II. Acrogènes.
avec sexes ou fltMirs. Fruciification naissunl d'un lhalliis IH. Rhizogèues.
d'uiie lige
* t e l)ois le plus juene au centre. Uo seul colyle'dou.
Feuilles à
nervures parallèles, persistantes
Faisceaux ligneux dis
liiljuCvS cont'usemenl.
r(iliculocs , cadiaqucs
IV. Endogènes.
Faisceaux ligneux eu f y^ DicLjogènes.
cercle uulourd'un cen
Il e nicdulluii e . . . .
à lu c.irconiei enee , toujours
concentrique. Deux ou plusieurs
cotylédons. Graines
Nous trouvons ici pt>ur la première fois
cette classe des Dictyogènes formée de ces
monocotylédonéesoù la nervation des feuilles
rappelle les dicotylédonées, et M. Lindley
signale un autre passage des unes aux
a u t r e s , dans la disposition et Taccroissenient
des faisceaux ûbro-vasculaires. Pour la division
des dicotylédonées , il est revenu au
c a r a c t è r e de l'insertion des étamines qu'il
r e j e t a i t précédemment; mais il rejette les
caractères tirés de la corolle qu'il admettait,
ramen é ainsi à la classification de Bernard
de Jussieu, dans lejiirdin de Trianon. Trois
cent trois familles sont distribuées en cinq
u a n t e - s i x alliances ; les caractères des unes
et des autres exposés au long , mais aussi
résumés dans une corn te diagnose.
On voit que, dans ses publications successives,
M. Lindley a plusieurs fois changé;
c'est ce qu'il avoue et justifie dans sa préface,
ce qui est le propre d'un esprit actif,
laborieux, ami du progrès, disposé à envisager
les objets dans tous leurs rapports qu'il
met tour à tour en saillie. Comme cet
esprit est dans toute sa force et comme ces
rapports sont bien variés, il est à croire
que nous n'avons pas encore son dernier
m o t . '
Nous venons d'anticiper un peu sur les
dates, afin de suivre un seul auteur dans la
série de ses travaux, dont les plus récents
ont pu se sentir de Titiiluence de plusieurs
uvragf's importants d'autres auteurs qui
nues
enfcrnitk'S dans
uu ovaire. . .
VT. Gyuujoçène.'i.
VU. Exi'gènes diclines,
livpcg nés.
p: r.gyties.
cpigynes.
avaient paru dans l'intervalle. Reprenonsles
donc dans l'ordre chronologique.
M. deMartius, professeur, à Munich, qui,
par ses belles et nombreuses publications
sur les plantes du Brésil, exploré par lui
dans sa plus grande étendue, a fourni à la
science t antde matériaux nouveaux, s'en est
lui même habilement servi pour le perfectionnement
des familles. Mais c'est dans uu
opuscule extrêmement court (Conspectus
Regni vegelahilis secundum- characteres marphologicos
proeseriim carpicos- in classes,
ordines et familias digesti, 1835) qu'il a résumé
ses idées générales sur la classification.
Il reconnaît d'abord deux modes de végétation
différents (1), l 'une qu'il nomme prinu-
(r) Cette division est empruntée à M. Nees d'EsenbecU ,
le président île la célèbre et antique société des curieux de
la nature. Cet habile botaniste cédait alors à l'ontrainement
des doctrines des phi losopl ies de la nature , qui ont quelque
temps exercé une grande iiiauence en Allemagne; influence
sous laquelle se sont prodii.ts plnsieurs systèmes botaniques.
Si nous n'en avuns p.-s ranchi compte, cVst qu'Us sont nstés
dans le domaine de la spéculat ion lune, et n'ont pas pénét
i é dans celui de ra|.plioat!Oti pratique. D^ms tous les systèmes
que nous avons avuns exposés, la syntliése sV].puie sur
l'analyse ; elle remonte des faits particuliers aux généralités.
: La philosophie de la n.iinre sint une mvirche inverse; pins
confiMite dans ics forces de l'esprit humain, c'est en hu
qu'elle croit pouvoir découvrir les immuables lois qu'elle
a p p l i q u e ensuite aux faits matériel s ; elle généralise ¿ prturi.
Nul doute quN-lle n'ait trouvé ain.i dMieuieuses inspirations,
de belles et fécondes théor ies; mais qu'elle puisse de primesaut
s'élancer ju qu'au but. soulevcrd'un seul e f foi t l e grand
voile qu'il ne nous est donné d'écarter que pli à pli par les
e f f u r l s rèuTiis de toutes les intellij-ences et de tous les temps,
( 'est ce qu'il csl dillicUe d'espérer. Eu boU-nique, du moms.