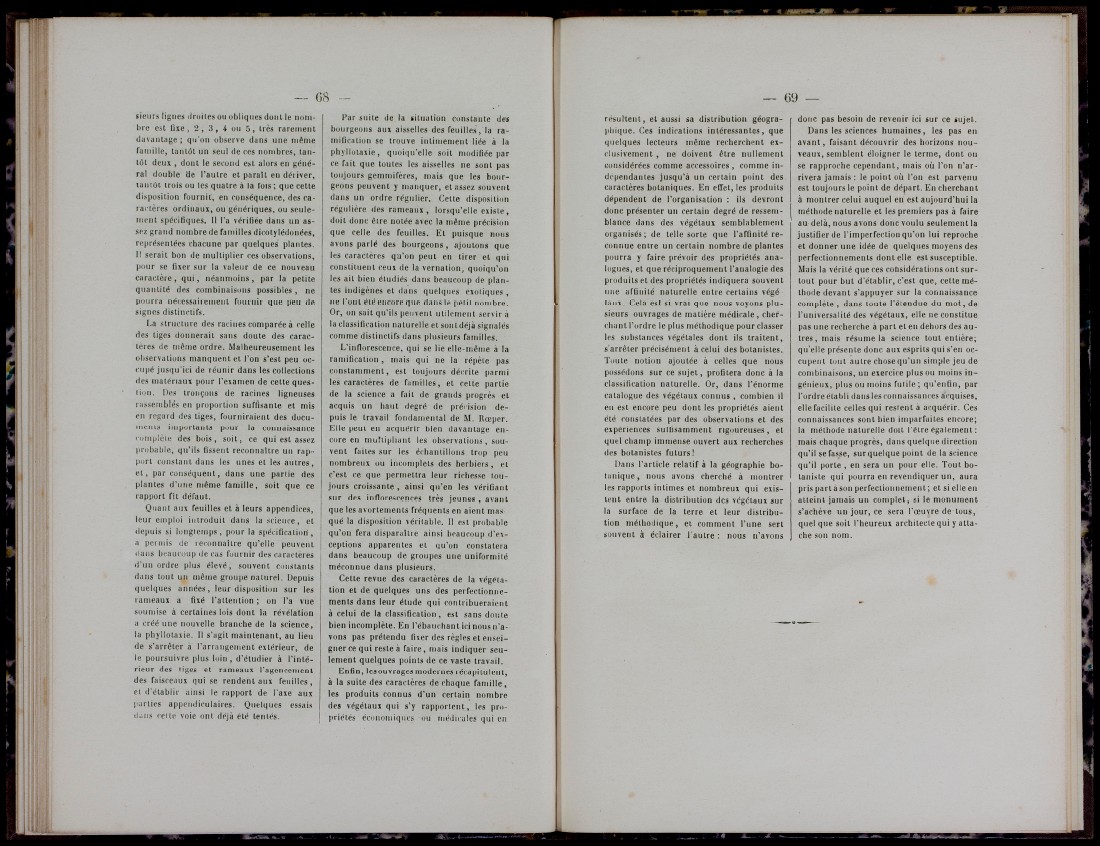
s i e u i s lignes droàes ou obl iques dont le nombre
est lixe, 2 , 3 , 4 ou 5 , très rarement
d a v a n t a g e ; qu'on observe dans une même
r a m i l l e , tantôt un seul de ces nombres, tantôt
deux , dont le second est alors en général
double de l'autre et paraît en dériver,
t a n t ô t trois ou les quatre à la fois; que cette
disposition fournil, en conséquence, des car
a c t è r e s ordinaux, ou génériques, ou seulement
spécifiques. Il Ta vérifiée dans un assez
grand nombre de Familles dicotylédonées,
représentées chacune par quelques plantes.
1! serait bon de multiplier ces observations,
pour se fixer sur la valeur de ce nouveau
c a r a c t è r e , qui, néanmoins, par la petite
q u a n t i t é des combinaisons possibles , ne
pourra nécessairement fournir que peu de
signes distinctifs.
La structure des racines comparée à celle
des tiges donnerait sans doute des caractères
de même ordre. Malheureusement les
observations manquent et Ton s'est peu occupé
jusqu' ici de réunir dans les collections
des matériaux pour l'examen de cette quesl
i o n . Des tronçons de racines ligneuses
rassemblés en proportion suffisante et mis
en regard des tiges, fourniraient des documents
importants pour la connaissance
c o i n p l è l e des bois, soit5 ce qui est assez
p r o b a b l e , qu'ils Ossent reconnaître un rapport
constant dans les unes et les autres,
e t , par conséquent, dans une partie des
plantes d'une même famille, soit que ce
rapport fit défaut.
Quant aux feuilles et à leurs appendices,
leur emploi introduit dans la science, et
depuis si longtemps, pour la spécification^
a permis de reconnaître qu'elle peuvent
«ians beaucoup de cas fournir des caractères
d'un ordre plus élevé, souvent constants
dans tout un même groupe naturel. Depuis
q u e l q u e s années, leur disposition sur les
rameaux a fixé l'attention; on Ta vue
soumise à certaines lois dont la révélation
a créé une nouvelle branche de la science,
la phyllotaxie. Il s'agit maintenant , au lieu
de s'arrêter à l'arrangement extérieur, de
le poursuivre plus loin , d'étudier à l'intér
i e u r des tiges et rameaux l'agencement
des faisceaux qui se rendent aux feuilles,
et d'établir ainsi le rapport de l'axe aux
parties appendiculaires. Quelques essais
iKuis cette voie ont déjà été tentés.
GS -
Par suite de la iitualion constante des
bourgeons aux aisselles des feuilles, la ram
i f i c a t i on se trouve intimement liée à la
p h y l l u t a x i e , quoiiiu'elle soit modifiée par
ce fait que toutes les aisselles ne sont pas
t o u j o u r s gemmifères, mais que les bourgeons
peuvent y manquer , et assez souvent
dans un ordre régulier. Cette disposition
r é g u l i è r e des rameaux, lorsqu'elle existe,
doit donc être notée avec la même précision
que celle des feuilles. Et puisque nous
avons parlé des bourgeons, ajoutons que
les caractères qu'on peut en tirer et qui
c o n s t i t u e n t ceux de la vernation, quoiqu'on
les ait bien étudiés dans beaucoup de plantes
indigènes et dans quelques exotiques ,
ne l'ont été encore que dans le petit nombre.
Or, on sait qu'ils peuvent utilement servir à
la classi f icat ion naturelle et sontdéj à signalés
comme distinctifs dans plusieurs familles.
L ' i n f l o r e s c e n c e , qui se lie e l le-même à la
r a m i f i c a t i o n , mais qui ne la répète pas
c o n s t a m m e n t , est toujours décrite parmi
les caractères de familles, et cette partie
de la science a fait de grands progrès et
acquis un haut degré de précision depuis
le travail fondamental de M. Roeper.
E l l e peut en acquérir bien davantage encore
en muîtipliant les observations, souvent
faites sur les échantillons trop peu
nombreux ou incomplets des herbiers , et
c ' e s t ce que permettra leur richesse touj
o u r s croissante , ainsi qu'en les vérifiant
sur des inflorescences très jeunes , avant
que les avor t ement s fréquents en aient mas
qué la disposition véritable. Il est probable
q u ' o n fera disparaître ainsi beaucoup d'exceptions
apparentes et qu'on constatera
dans beaucoup de groupes une uniformité
m é c o n n u e dans plusieurs.
C e t t e revue des caractères de la végétat
i on et de quelques uns des perfectionnements
dans leur étude qui contribueraient
à celui de la classification, est sans doute
b i e n incomplète. En l'ébauchant ici nous n'avons
pas prétendu fixer des règles et enseigner
ce qui reste à faire, mais indiquer seul
e m e n t quelques points de ce vaste travaiL
E n f i n , lesouvrages modernes récapitulent,
à la suite des caractères de chaque famille,
les produits connus d'un certain nombre
des végétaux qui s'y rapportent, les propriétés
économiques ou médicales qui en
6 9
r é s u l t e n t , et aussi sa distribution géograpiiique.
Ces indications intéressantes, que
quelques lecteurs même recherchent exc
l u s i v e m e n t , ne doivent être nullement
considérées comme accessoires, comme indopendantes
jusqu'à un certain point des
c a r a c t è r e s botaniques. En effet, les produits
dépendent de l'organisation : ils devront
donc présenter un certain degré de ressemb
l a n c e dans des végétaux semblablement
o r g a n i s é s ; de telle sorte que l'affinité rec
o n n u e entre un certain nombre de plantes
pourra y faire prévoir des propriétés analogueSj
et que réciproquement l'analogie des
produits et des propriétés indiquera souvent
une affinité naturelle entre certains végé
taux. Cela est si vrai que nous voyons plus
i e u r s ouvrages de matière médicale, chefc
h a n t l'ordre le plus méthodique pour classer
les substances végétales dont ils traitent,
s ' a r r ê t e r précisément à celui des botanistes.
T o u t e notion ajoutée à celles que nous
possédons sur ce sujet , profitera donc à la
c l a s s i f i c a t i on naturelle. Or, dans l'énorme
c a t a l o g u e des végétaux connus , combien il
en est encore peu dont les propriétés aient
é t é constatées par des observations et des
expériences suffisamment rigoureuses, et
quel champ immense ouvert aux recherches
des botanistes futurs!
Dans l'article relatif à la géographie bot
a n i q u e , nous avons cherché à montrer
les rapports intimes et nombreux qui exist
e n t entre la distribution des végétaux sur
la surface de la terre et leur distribution
méthodique, et comment l'une sert
souvent à éclairer l'autre: nous n'avons
donc pas besoin de revenir ici sur ce sujet.
Dans les sciences humaines, les pas en
a v a n t , faisant découvrir des horizons nouveaux,
semblent éloigner le terme, dont on
s e rapproche cependant, mais où l'on n'arrivera
jamai s : le point où l'on est parvenu
est toujours le point de départ. En cherchant
à montrer celui auquel en est aujourd'hui la
méthode naturel l e et les premiers pas à faire
a u delà, nous avons donc voulu seulement la
j u s t i f i e r de l'imperfection qu'on lui reproche
e t donner une idée de quelques moyens des
p e r f e c t i o n n e m e n t s dont elle est susceptible.
Mais la vérité que ces considérations ont surtout
pour but d'établir, c'est que> cette méthode
devant s'appuyer sur la connaissance
complète , dans toute l'étendue du mot , de
l ' u n i v e r s a l i t é des végétaux, elle ne constitue
pas une recherche à part et en dehors des aut
r e s , mais résume la science tout entière;
q u ' e l l e présente donc aux esprits qui s'en occupent
tout autre chosequ'un simple jeu de
c o m b i n a i s o n s , un exercice plus ou moins ingénieux,
plus ou moins futile ; qu'enfin, par
l ' o r d r e é tabl i dans les connai s sances acquises,
e l l e f a c i l i t e celles qui restent à acquérir. Ces
c o n n a i s s a n c e s sont bien imparfaites encore;
la méthode naturelle doit l'être également :
mais chaque progrès, dans quelque direction
q u ' i l se fasse, sur quelque point de la science
q u ' i l porte , en sera un pour elle. Tout bot
a n i s t e qui pourra en revendiquer un, aura
pris part à son per fect ionnement ; et si el l e en
a t t e i n t jamais un complet, si le monument
s ' a c h è v e un jour, ce sera l'oeuvre de tous,
q u e l q u e soit l'heureux architecte qui y attache
son nom.
ITP*^