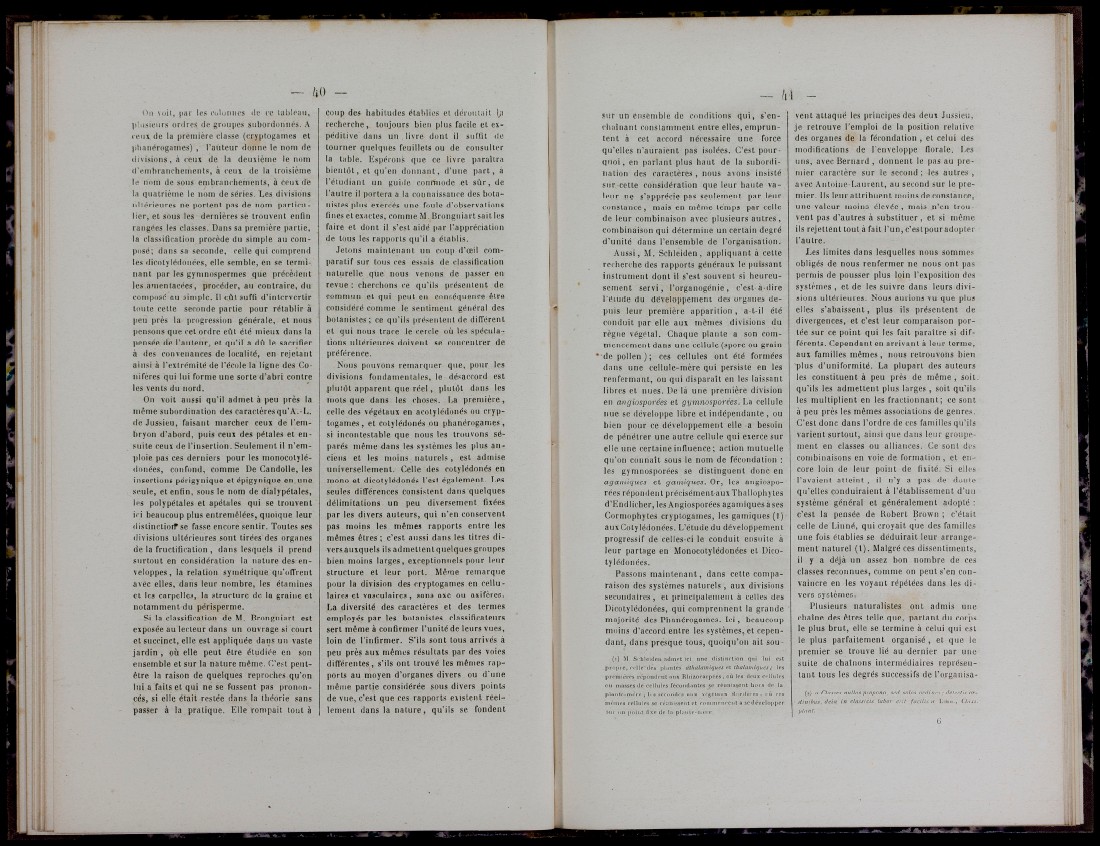
/ i O
r: i
JI
l i I
1
Oil M)ii, par tes Colonnes de ce lablciuj,
plusieurs ordres de groupes subordonnés. A
ceux de la première classe (cryptogames et
plianérogames) , Tauteur donne le nom de
d i v i s i o n s , à ceux de la deuxième le nom
( i ' e m h r a n c h e m e n t s , à ceux de la troisième
le nom de sons etnbranchements, à ceux de
la quatrième le nom de séries. Les divisions
iiUérieures ne portent pas de nom particul
i e r , et sous les dernières se trouvent enfin
rangées les classes. Dans sa première partie,
la classification procède du simple au comp(
tsé; dans sa seconde, celle qui com|)rend
les dicotyléiionéeSv elle semble, en se termin
a n t par les gymnospermes que précèdent
les amentacées, procéder, au contraire, du
composé au simple. Il eût suffi d'intervertir
t o u t e cette seconde partie pour rétablir à
peu près la progression générale, et nous
pensons que cet ordre eût été mieux dans la
pensée de l 'auteur, et qu'il a dû le sacrifier
à des convenances de localité, en rejetant
ainsi à l'extrémité de l'école la ligne des Con
i f è r e s qui lui forme une sorte d'abri contre
les vents du nord.
On voit aussi qu'il admet à peu près la
meme subordination des caractères qu'A.-L.
( i e J u s s i e u , faisant marcher ceux de l'embryon
d'abord, puis ceux des pétales et ens
u i t e ceux de l'insertion. Seulement il n'emploie
pas ces derniers pour les monocotyléiionées,
confond, comme De Candolle, les
i n s e r t i o n s périgynique et épigynique en une
seule, et enfin, sous le nom de dialypétales,
les polypétales et apétales qui se trouvent
ici beaucoup plus entremêlées, quoique leur
d i s t i n c t i o i f se fasse encore sent ir. Toutes ses
divisions ultérieures sont tirées des organes
d e la fructification , dans lesquels il prend
s u r t o u t en considération la nature des enveloppes,
la relation symétrique qu'otlVent
avec elles, dans leur nombre, les étamines
e t les carpelles, la structure de la graine et
n o t a m m e n t du périsperme.
Si la classification de M. Brongniart est
exposée au lecteur dans un ouvrage si court
e t succinct, elle est appliquée dans un vaste
j a r d i n , où elle peut être étudiée en son
ensemble et sur la natur e même. C'est peutê
t r e la raison de quelques reproches qu'on
tu! a faits et qui ne se fussent pas prononcés,
si elle était restée dans la théorie sans
passer à la pratique. Elle rompait tout à
coup des habitudes établies et déroutait Î;Î
r e c h e r c h e , toujours bien plus facile et exp
é d i t i v e dans un livre dont il suffit de
t o u r n e r quelques feuillets ou de consulter
la table. Espérons que ce livre paraîtra
b i e n t ô t , et qu'en donnant, d'une part, à
l ' é t u d i a n t un guide cornTuode et sûr, de
l ' a u t r e il portera a la connaissance des botanistes
plus exercés une foule d'observations
fines et exactes, comme M. Brongniar t sait les
f a i r e et dont il s'est aidé par l'appréciation
d e tous les rapport s qu'il a établis.
J e t o n s maintenant un coup d'oeil comp
a r a t i f sur tous ces essais de classification
n a t u r e l l e que nous venons de passer eu
r e v u e : cherchons ce qu'ils présentent de
commun et qui i)eut en conséquence être
considéré comme le sentiment géïiéral des
b o t a n i s t e s ; ce qu'ils présentent de diiîérent
et qui nous trace le cercle où les spéculations
ultérieures doivent se concentrer de
p r é f é r e n c e .
Nous pouvons remarquer que, pour les
divisions fondamentales, le désaccord est
p l u t ô t apparent que réel , plutôt dans les
mots que dans les choses. La première,
celle des végétaux en acotyiédonés ou crypt
o g a m e s , et cotylédonés ou phanérogames,
si incontestable que nous les trouvons séparés
même dans les systèmes les plus anciens
et les moins naturels , est admise
u n i v e r s e l l e m e n t . Celle des cotylédonés en
mono et dicotylédonés l'est également . Les
seules différences consistent dans quelques
d é l i m i t a t i o n s un peu diversement fixées
par les divers autetirs, qui n'en conservent
pas moins les mêmes rapports entre les
mêmes êtres; c'est aussi dans les titres divers
a u x q u e l s ils a dme t l e n t q t i e l q u e s groupes
bien moins larges, exceptionnels pour leur
s t r u c t u r e et leur port. Mênie remarque
pour la division des cryptogames en cellulaires
et vasculaires, sans axe ou axifères.
La diversité des caractères et des termes
employés par les botanistes classificateurs
s e r t même à conf i rmer l'unité de leurs vues,
loin de l'infirmer. S'ils sont tous arrivés à
peu près aux mêmes résultats par des voies
d i f f é r e n t e s , s'ils ont trouvé les mêmes rapports
au moyen d'organes divers ou d'une
même partie considérée sous divers points
d e vue, c'est que ces rapports existent réellemetit
dans la nature, qu'ils se fondent
|l]i ;
. i L
- /li
sur un ensemble de coîidiiions cjui, s'enc
i i a î n a n t conslamment entre elles, emprunt
e n t à cet accord nécessaire une force
q u ' e l l e s n'auraient pas isolées. C'est pourquoi
, en parlant plus haut de la subordin
a t i o n des caractères, nous avons insisté
sur cette considération que leur haute valeur
ne s'apprécie pas seulement par leur
c o n s t a n c e , mais en même temps parcelle
d e leur combinaison avec plusieurs autres,
combinaison qui détermine un certain degré
d ' u n i t é dans l'ensemble de l'organisation.
A u s s i , M. Schleiden, appliquant à cette
recherche des rapports généraux le puissant
i n s t r u m e n t dont il s'est souvent si heureus
e m e n t servi, l'organogènie, c'est à-dire
Tétude du développement des organes depuis
leur première apparition , a-t-il été
conduit par elle aux mêmes divisions du
r è g n e végétal. Chaque plante a son comm
e n c e m e n t dans une cellule (spore ou grain
d e pollen); ces cellules ont été formées
dans une cellule-rnère qui persiste en les
r e n f e r m a n t , ou qui disparaît en les laissant
l i b r e s et nues. De là une première division
en atigiosporées et gymnosporées.La cellule
n u e se développe libre et indépendante, ou
bien pour ce développement elle a besoin
d e pénétrer une autre cellule qui exerce sur
elle une certaine influence ; action mutuelle
q u ' o n connaît sous le nom de fécondation :
les gymnosporées se distinguent donc en
aganiiques et gamiques. Or, les angiosporées
répondent précisément-auxThallophytes
d ' E n d l i c h e r , les Angiosporées agamiquesàses
Corrnophytes cryptogames, les gamiques (I)
auxCotylédonées. L'étude du développement
progressif de celles-ci le conduit ensuite à
l e u r partage en Monocotylédonées et Dicotylédonées.
Passons maintenant, dans cette comparaison
des systèmes naturels , aux divisions
s e c o n d a i r e s , et principalement à celles des
Dicotylédonées, qui comprennent la grande
m a j o r i t é des Phanérogames. Ici, beaucoup
moins d'accord entre les systèmes, et cepend
a n t , dans presque tous, quoiqu'on ait sou •
(i) M, S'iileiclcn admi't ici une clistinrlion qui lui est
propre, relie (les [>laiites athalamigues ei tkalamif/ues; les
premières ropoiicicut .mx Rhizorarpées , ou les deux c-iUilcs
ou masses lie cclluies fécondantes se réunissent lioi s do la
plante-mcre , les secondes aux végétaux llonières , où ces
int'tnes cellules se rciMiisseut et roumipiiceiit a se déveloj>per
Sur nn poiiil fixe de la pl;Milc-riiére.
vent at taqué les principes des deux Jussieu,
j e retrouve l'emploi de la position relative
des organes de la fécondation , et celui des
modifications de Tenveloppe florale. Les
uns, avec Bernard , donnent le pas au premier
caractère sur le second ; les autres ,
avec Antoine-Laurent , au second sur le prem
i e r . ils leur a t t r ibuent moins de constance,
u n e valeur moins élevée , mais n'en trouvent
pas d'autres à subst i tuer, et si même
ils rejet tent tout à fai t l 'un, c 'estpour adopter
l ' a u t r e .
Les limites dans lesquelles nous sommes
obligés de nous renfermer ne nous ont pas
permis de pousser plus loin l'exposition des
systèmes , et de les suivre dans leurs divisions
ultérieures. Nous aurions vu que plus
elles s'abaissent, plus ils présentent de
divergences, et c'est leur comparaison portée
sur ce point qui les fait paraître si diff
é r e n t s . Cependant en a r r ivant à leur terme,
aux familles mêmes , nous retrouvons bieii
plus d'uniformité. La plupart des auteurs
les constituent à peu près de même, soit,
q u ' i l s les admettent plus larges , soit qu'ils
les multiplient en les f ract ionnant ; ce sont
à peu près les mêmes associations de genres.
C'est donc dans l'ordre de ces familles qu'ils
v a r i e n t surtout , ainsi que dans leur groupement
en classes ou alliances. Ce sont des
combinaisons en voie de formation, et encore
loin de leur point de fixité. Si elics
l ' a v a i e n t atteint, il n'y a pas de douic
q u ' e l l e s conduiraient à l'établissement d'un
système général et généralement adopté :
c'est la pensée de Robert Brown ; c'était
celle de Linné, qui croyait que des familles
une fois établies se déduirait leur arrangement
naturel (l). Malgré ces dissentiments,
il y a déjà un assez bon nombre de ces
classes reconnues, comme on peut s'en convaincre
en les voyant répétées dans les divers
systèmes.
P l u s i e u r s naturalistes ont admis une
chaîne des êtres telle que, partant du corps
le plus brut , elle se termine à celui qui est
le plus parfaitement organisé , et que le
premier se trouve lié au dernier par une
s u i t e de chaînons intermédiaires représent
a n t tous les degrés successifs de l'organisa-
(t-) « Classes nulliis propono, sed solos ordiiics ; de/ectis or~
dinibus, deia in classicis luhor ait facilis Litm., Chus,
¡¡lait t.
G