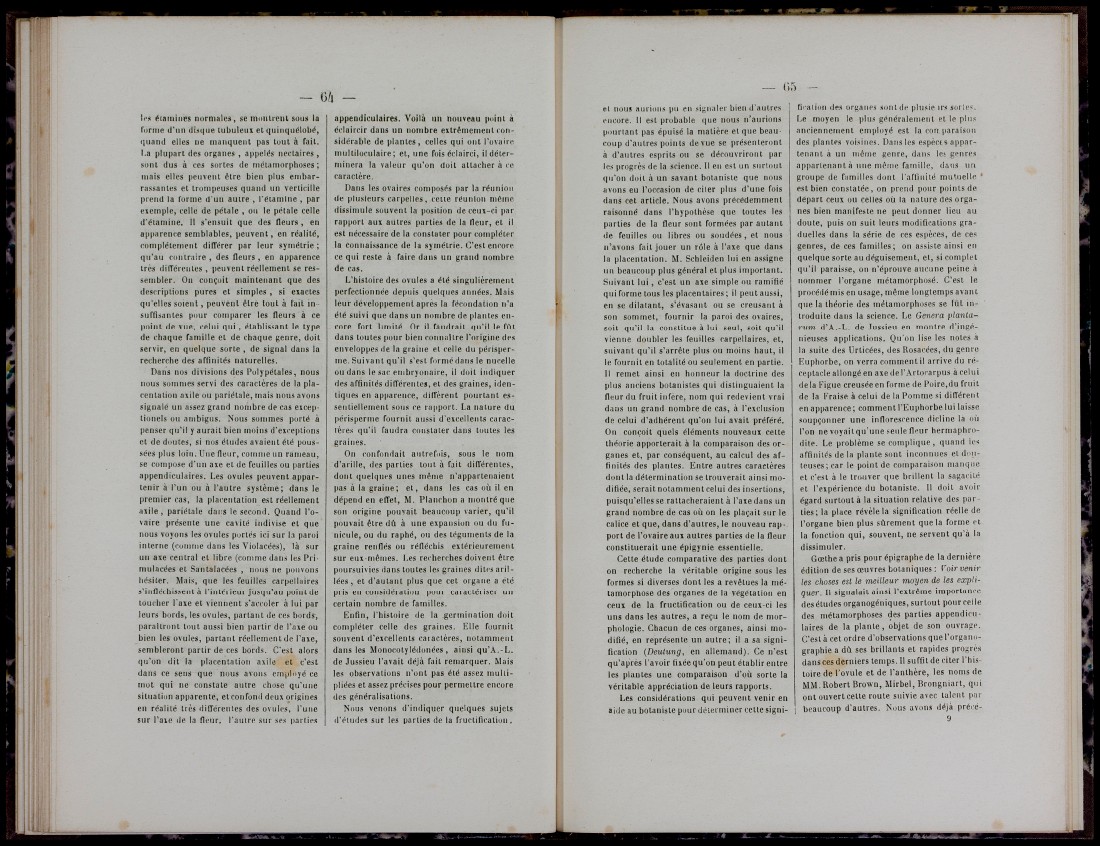
h)
i '
y: !
it'S ëiainiiies normales, se tnoiilrenl sous lu
forme d'un disque lubuleux et quiiiquélobé,
quand elles ne nianquetil pas Lout à fait.
La plupart des organes , appelés nectaires,
sont dus à ces sortes de înétarnorphoses ;
mais elles peuvent être bien plus embarrassantes
et trompeuses quand un verticille
prend la forme d'un autre , Tétamine , par
exemple, celle de pétale , ou le pétale celle
d'étamine. Il s'ensuit que des fleurs , en
apparence semblables, peuvent, en réalité,
complètement différer par leur symétrie ;
q u ' a u contraire, des fleurs, en apparence
très dilTérenles , peuvent réellement se ressembler.
On conçoit maintenant que des
descriptions pures et simples , si exactes
qu'elles soient , peuvent être tout à fait in -
suffisantes pour comparer les fleurs à ce
point de vue, celui qui , établissant le type
de chaque famille et de chaque genre, doit
servir, en quelque sorte , de signal dans la
recherche des affinités naturelles.
Dans nos divisions des Polypétales, nous
nous sommes servi des caractères de la placentation
axile ou pariétale, mais nous avons
signalé un assez grand nombre de cas exceptionels
ou ambigus. Nous sommes porté à
penser qu'il y aurai t bien moins d'exceptions
et de doutes, si nos études avaient été poussées
plus loin. Une fleur, comtïie un rameau,
se compose d'un axe et de feuilles ou parties
appendiculaires. Les ovules peuvent appartenir
à l'un ou à l'autre système; dans le
premier cas, la placentaLion est réellement
a x i l e , pariétale dai:s le second. Quand l'ovaire
présente une cavité indivise et que
nous voyons les ovules portés ici sur I:» paroi
interne (comme dans les Violacées), là sur
un axe central et libre (comme dans les Primulacées
et Santalacées , nous ne pouvons
hésiter. Mais, que les feuilles carpellaires
s'infléchissent à Tintérieur jusqu'au point de
loucher l'axe et viennent s'accoler à lui par
leurs bords, les ovules, parlant de ces bords,
paraîtront tout aussi bien partir de l'axe ou
bien les ovules, parlant réellement de l'axe,
sembleront partir de ces bords. C'est alors
qu'on dit !a placentation axile et c'est
dans ce sens que nous avons employé ce
mot qui ne constate autre chose qu'une
situation apparente, etconfond deux origines
en réalité très différentes des ovules, l'une
sur l'axe de la fleur, Tauire sur ses parties
appendiculaires. Voilà un nouveau point à
éclaircir dans un nombre extrêmement considérable
de plantes, celles qui ont l'ovaire
multiloculaire; et, une fois éclairci, il déterminera
la valeur qu'on doit attacher à ce
caractère.
Dans les ovaires composés par la réunion
de plusieurs carpelles, cette réunion même
dissimule souvent la position de ceux-ci par
rapport aux autres parties de la fleur, et il
est nécessaire de la constater pour compléter
la connaissance de U symétrie. C'est encore
ce qui reste à faire dans un grand nombre
de cas.
L'histoire des ovules a été singulièrement
perfectionnée depuis quelques années. Mais
leur développement après la fécondation n'a
été suivi que dans un nombre de plantes encore
fort limité. Or il faudrait qu'il le fiit
dans toutes pour bien connaître l'origine des
enveloppes île la graine et celle du périsperme.
Suivant qu'il s'est formé dans le nucelle
ou dans le sac enibryonaire, il doit indiquer
des affinités différentes, et des graines, identiques
en ap()arence, diffèrent pourtant essentiellement
sous ce ra[)port. La nature du
périsperme fournit aussi d'excellents caractères
qu'il faudra constater dans toutes les
graines.
On confondait autrefois, sous le nom
d'arille, des parties tout à fait difl'érentes,
dont quelques unes même n'appartenaient
pas à la graine; et, dans les cas où il en
dépend en effet, M. Planchón a montré que
son origine pouvait beaucoup varier, qu'il
pouvait être dû à une expansion ou du funicule,
ou du raphé, ou des téguments de la
graine renflés ou réfléchis extérieurement
sur eux-mêmes. Les recherches doivent être
poursuivies dans toutes les graines dites ariîlées,
et d'autant plus que cet organe a été
pris en considération pour caractériser un
certain nombre de familles.
Enfin, l'histoire de la .germination doit
compléter celle des graines. Elle fournit
souvent d'excellents caractères, notamment
dans les Monocotylédonées, ainsi qu'A.-L.
de Jussieu l'avait déjà fait remarquer. Mais
les observations n'ont pas été assez muUipliées
et assez précises pour permettre encore
des généralisations.
Nous venons d'indiquer quelques sujets
d'éludés sur les parties de la fructification,
H nous auritms pu en signaler bien d'autres
(Micore. il est probable que nous n'aurions
pourtant pas épuisé la matière et que beaucoup
d'autres points devue se présenteront
à d'autres esprits ou se découvriront par
les progrès de la science. Il en est un surtout
qu'on doit à un savant botaniste que nous
avons eu Poccasion de citer plus d'une fois
dans cet article. Nous avons précédemment
raisonné dans Phypothèse que toutes les
parties de la fleur sont formées par autant
de feuilles ou libres ou soudées, et nous
n'avons fait jouer un rôle à l'axe que dans
la placentation. M. Schleiden lui en assigne
un beaucoup plus général et plus important.
Suivant lui , c'est un axe simple ou ramifié
qui forme tous les placentaires ; il peut aussi,
en se dilatant, s'évasant ou se creusant à
son sommet, fournir la paroi des ovaires,
soit qu'il la constitue à lui seul, soit qu'il
vienne doubler les feuilles carpellaires, et,
suivant qu'il s'arrête plus ou moins haut, il
le fournit en totalité ou seulement en partie.
Il remet ainsi en honneur la doctrine des
plus anciens botanistes qui distinguaient la
fleur du fruit infère, nom qui redevient vrai
dans un grand nombre de cas, à l'exclusion
de celui d'adhérent qu'on lui avait préféré.
On conçoit quels éléments nouveaux cette
théorie apporterait à la comparaison des organes
et, par conséquent, au calcul des affinités
des plantes. Entre autres caractères
d o n t i a détermination se trouverai t ainsi modifiée,
serai tnotammentcelui des insertions,
puisqu'elles se rattacheraient à l'axe dans un
grand nombre de cas où on les plaçait sur le
calice et que, dans d'autres, le nouveau rapport
de Povaireaux autres parties de la fleur
constituerait une épigynie essentielle.
Cette étude comparative des parties dont
on recherche la véritable origine sous les
formes si diverses dont les a revêtues la métamorphose
des organes de la végétation en
ceux de la fructification ou de ceux-ci les
uns dans les autres, a reçu le nom de morphologie.
Chacun de ces organes, ainsi modifié,
en représente un autre; il a sa signification
{Deutung, en allemand). Ce n'est
qu'après Pavoir fixéequ'on peut établir entre
les plantes une comparaison d'où sorte la
véritable appréciation de leurs rapports.
Les considérations qui peuvent venir en
aide au botaniste pour déierminer cette signification
des organes sont de plusie irs sorte-;.
Le moyen le plus généralement et le plus
anciennement employé est la coaparaisoïi
des plantes voisines. Dans les espèces appartenant
à un iTiême genre, dans le^ genres
appartenant à une même famille, dans un
groupe de f;imilles dont l'affinité mutuelle '
est bien constatée, on prend pour points de
départ ceux ou celles où la nature des organes
bien manifeste ne peut donner lieu au
doute, puis on suit leurs modifications graduelles
dans la série de ces espèces, de ces
genres, de ces familles; on assiste ainsi eti
quelque sorte au déguisement, et, si complet
qu'il paraisse, on n'éprouve aucune peine à
nommer Porgane métamorphosé. C'est le
procédémis en usage, même longtemps avant
que la théorie des métamorphoses se fût introduite
dans la science. Le Genera plantarum
d'A.-L. de Jussieu en montre d'ingénieuses
applications. Qu'on lise les notes à
la suite des Urticées, des Rosacées, du genre
Euphorbe, on verra comment il arrive du réceptacle
allongé en axe de PAr tocarpus à celui
delà Figue creusée en forme de Poire,du fruit
de la Fraise à celui de la Pomme si différent
e n a p p a r e n c e ; commentPEuphorbelui laisse
soupçonner une inflorescence dicline la où
l'on ne v o y a i t q u ' u n e seulefleur hermaphrodite.
Le problème se compl ique, quand le^
affinités de la plante sont inconnues et douteuses;
car le point de comparaison manque
et c'est à le trouver que brillent la sagacité
et l'expérience du botaniste. Il doit avoir
égard surtout à la situation relative des parties;
la place révèle la signification réelle de
Porgane bien plus sûrement que la forme cl
la fonction qui, souvent, ne servent qu'à la
dissimuler.
Goethe a pris pour épigraphe de la dernière
édition de ses oeuvres botaniques : l^oir venir
les choses est le meilleur moyen de les expliquer.
Il signalait ainsi l'extrême importance
des études organogéniques, surtout pour celle
des métamorphoses des parties appendiculaires
de la plante, objet de son ouvrage.
C'est à cet ordre d'observations que Porganiigraphie
a dû ses brillants et rapides progrès
dans ces dernier s temps. Il suffit de citer l'histoire
de Povule et de Panthère, les noms de
MM. Rober t Brown, Mirbel, Brongniart, qin
ont ouvert cette route suivie avec talent par
beaucoup d'autres. Nous avons déjà préoé-
9