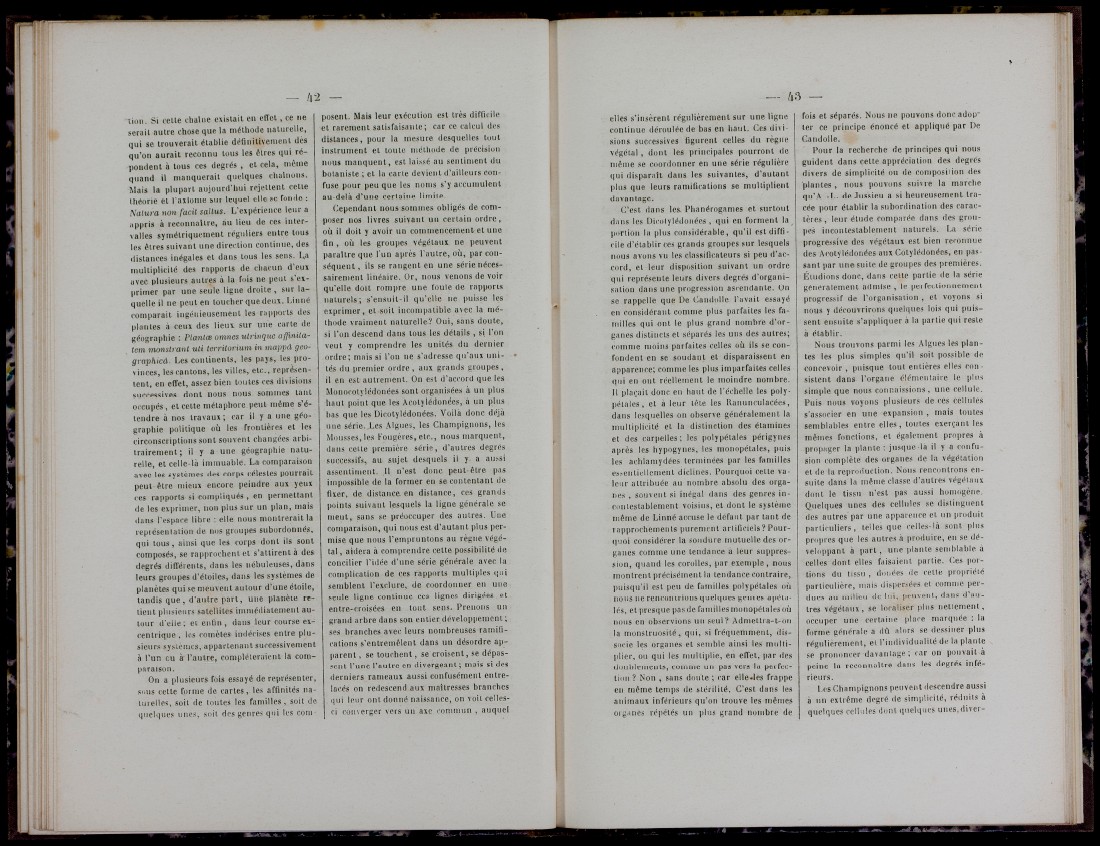
/ri
! I
lion. Si celle cliatne exislail en ctTci, ce ne '
serait autre chose que la inéihotle natmelle,
qui se trouverait établie définitivement dès
qu'on aurait reconnu tous les êtres qui répondent
à tous ces degrés , et cela, même
quand il manquerait quelques chaînons.
Mais la plupart aujourd'hui rejettent cetie
théorie et l'axiome sur lequel elle se fonde :
Natura ÍÍOH facit sallus. L'expérience leur a
appris à reconnaître, au lieu de ces intervalles
symétriquement réguliers entre tous
les êtres suivant une direction continue, des
distances inégales et dans tous les sens. Ua
multiplicité des rapports de chacun d'eux
avec plusieurs autres à la fois ne peut s'exprimer
par une seule ligne droite , sur laquelle
il ne peut en toucher que deux. Linné
comparait ingénieusement les rapports des
plantes ceux des lieux sur une carte de
géographie : Plantoe omnes uiritiquc affinUatem
ynonstrant uti territoriujn in mappâ geographicâ.
Les continents, les pays, ies provinces,
les cantons, les villes, etc., représent
e n t , en effet, assez bien toutes ces divisions
successives dont nous nous sommes tant
occupés, et celle métaphore peut même s'étendre
à nos travaux; car il y a une géographie
politique où les frontières et les
circonscriptions sont souvent changées arbit
r a i r e m e n t ; il y a une géographie naturelle,
et celle-là immuable. La comparaison
avec les systèmes des corps célestes pourrait
peut être mieux encore peindre aux yeux
res rapports si compliqués, en permettant
de les exprimer, non plus sur un plan, mais
dans l'espace libre : elle nous montrerait la
repiéseniaiion de nos groupes subordonnés,
qui tous, ainsi que les corps dont ils sont
composés, se rapprochent et s'attirent à des
degrés diiTérents, dans les nébuleuses, dans
leurs groupes d'étoiles, dans les systèmes de
planètes qui se meuvent autour d'une étoile,
tandis que , d'autre part, une planète retient
plusieurs satellites immédiatement autour
d'elle; et enfin, dans leur course exc
e n t r i q u e , les comètes indécises entre plusieurs
sysiènics, appar tenant successivement
à l'un ou à l'autre, compléteraient la comparaison.
On a plusieurs fois essayé de représenter,
sous cette forme de cartes, les affinités naturelles,
soit de toutes les familles, soit de
quelques unes, soit des genres qui les com -
posent. Mais leur exécution est très difficile
et rarement satisfaisaiiie; car ce calcul des
distances, pour la mesure desquelles tout
instrument et toute méthode de précision
nous manquent, est laissé au sentiment du
botaniste ; et la carie devient d'ailleurs confuse
pour peu que les noms s'y accumulent
au-delà d'une certaine limite.
Cependant nous sommes obligés de composer
nos livres suivant un certain ordre,
où il doit y avoir un commencement et une
fin , où les groupes végétaux ne peuvent
paraître que Tun après l'autre, où, par conséquent
, ils se rangent en une série nécessairement
linéaire. Or, nous venons de voir
qu'elle doit rompre une foule de rapports
n a t u r e l s ; s'ensuit-il qu'elle ne puisse les
exprimer, et soit incompatible a\ec la méthode
vraiment naturelle? Oui, sans doute,
si l'on descend dans tous les détails , si l'on
veut y comprendre les unités du dernier
ordre; mais si l'on ne s'adresse qu'aux unités
du premier ordre, aux grands groupes ,
il en est autrement. On est d'accord que les
Monocotylédonées sont organisées à un plus
haut point que les Acoiylédonées, à un plus
bas que les Dicotylédonées. Voilà donc déjà
u[ie série. Les Algues, les Champignons, les
Mousses J e s Fougères, etc., nous marquent,
dans celte première série, d'autres degrés
successifs, au sujet desquels il y a aussi
assentiment. 11 n'est donc peut-être pas
impossible de la former en se contentant de
fixer, de dislance, en distance, ces grands
points suivant lesquels la ligne générale se
meut, sans se préoccuper des autres. Une
comparaison, qui nous est d'autant plus permise
que nous l'empruntons au règne végétal
, aidera à comprendre celte possibilité de
concilier l'idée d'une série générale avec la
complication de ces rapports multiples qui
semblent l'exclure, de coordonner en utie
seule ligne continue ces lignes dirigées et
entre-croisées en tout sens. Prenons un
grand arbre dans son entier développement ;
ses branches avec leurs nombreuses ramifications
s'entremêlent dans un désordre apparent
, se touchent , se croisent, se dépassent
l'une l'autre en divergeant ; mais si des
derniers rameaux aussi confusément entrelacés
on redescend aux maîtresses branches
qui leur ont donné naissance, on voit cellesci
converger vers un axe commun , auquel
— k
elles s'insèrent régulièrement sur une ligne
continue déroulée de bas en haut. Ces divisions
successives figurent celles du règne
végétal, dont les principales pourront de
même se coordonner en une série régulière
qui disparaît dans les suivantes, d'autant
plus que leurs ramifications se multiplient
davantage.
C'est dans les. Phanérogames et surtout
dans les Dicotylédonées, qui en forment la
ponion la plus considérable, qu'il est difficile
d'établir ces grands groupes sur lesquels
nous avons vu les classificateurs si peu d'accord,
et leur disposition suivant un ordre
qui représente leurs divers degrés d'organisation
dans une progression ascendante. On
se rappelle que De Candolle l'avait essayé
en considérant comme plus parfaites les familles
qui ont le plus grand nombre d'organes
distincts et séparés les uns des autres;
comme moins parfaites celles où ils se confondent
en se soudant et disparaissent en
apparence; comme les plus imparfaites celles
qui en ont réellement le moindre nombre.
H plaçait donc en haut de l'échelle les polypéiales,
et a leur lêie les Ranunculacées,
dans lesquelles on observe généralement la
multiplicité et la distinction des étamines
et des carpelles; les polypéiales périgynes
après les hypogynes, les monopétales, puis
ies achlamydées terminées par les familles
essentiellement diciines. Pourquoi cette valeur
attribuée au nombre absolu des organes
, souvent si inégal dans des genres inconiesiablement
voisins, et dont le système
même de Linné accuse le défaut par tant de
rapprochements purement artificiels ? Pourquoi
considérer la soudure mutuelle des organes
comme une tendance à leur suppression,
quand les corolles, par exemple, nous
montrent précisément la tendance contraire,
puisqu'il est peu de farïiilles polypéiales où
nous ne rencontrions quelques genres apétales,
et presque pas de familles monopétales où
nous en observions un seul? Admettra-t-on
la monstruosité, qui, si fréquemment, dissocie
les organes et semble ainsi les multi-
|)iier, ou qui les multiplie, en effet, par des
doublements, comme un pas vers la perfection
? Non , sans doute ; car elle-les frappe
en même temps de stérilité. C'est dans les
atiimaux inférieurs qu'on trouve les mêmes
organes répétés un plus grand nombre de
fois et séparés. Nous ne pouvons donc adopter
ce principe énoncé et appliqué par De
Candolle.
Pour la recherche de principes qui nous
guident dans cette appréciation des degrés
divers de simplicité ou de composition des
p l a n t e s , nous pouvons suivre la marche
q u ' A . - L . de Jussieu a si heureusement tracée
pour établir la subordination des caract
è r e s , leur étude comparée dans des groupes
incontestablement naturels. La série
progressive des végétaux est bien reconnue
des Acotylédonées aux Cotylédonées, en passant
par une suile de groupes des premières.
Étudions donc, dans celte partie de la série
généralement admise , le perfectionnement
progressif de l'organisation, et voyons si
nous y découvrirons quelques lois qui puissent
ensuite s'appliquer à la partie qui reste
à établir.
Nous trouvons parmi les Algues les plantes
les plus simples qu'il soit possible de
concevoir, puisque tout entières elles consistent
dans l'organe élémentaire le plus
simple que nous connaissions, une cellule.
Puis nous voyons plusieurs de ces cellules
s'associer en une expansion , mais toutes
semblables entre elles, toutes exerçant les
mêînes fonctions, et également propres à
propîiger la plante : jusque- l à il y a confusion
complète des organes de la végétation
et de la reproduction. Nous rencontrons ensuite
dans la même classe d'autres végétaux
dont le tissu n'est pas aussi homogène.
Quelques unes des cellules se distinguent
des autres par une apparence et un produit
particuliers, telles que celles-là sont plus
propres que les autres à produire, en se développant
à part, une plante semblable à
celles dont elles faisaient partie. Ces portions
du tissu , douées de celte propriété
particulière, mais dispersées et comme perdues
au milieu de lui, peuvent, dans d'autres
végétaux, se localiser plus nettement,
occuper une certaine place marquée : la
forme générale a dû alors se dessiner plus
régulièrement, et l'iiulividualilé de la plante
se prononcer davantage; car on pouvait à
peine la reconnaître dans les degrés inférieurs.
Les Chnmpignons peuvent descendre aussi
à un extrême degré de simplicité, réduits à
quelques cellules dont (luelques unes,diver