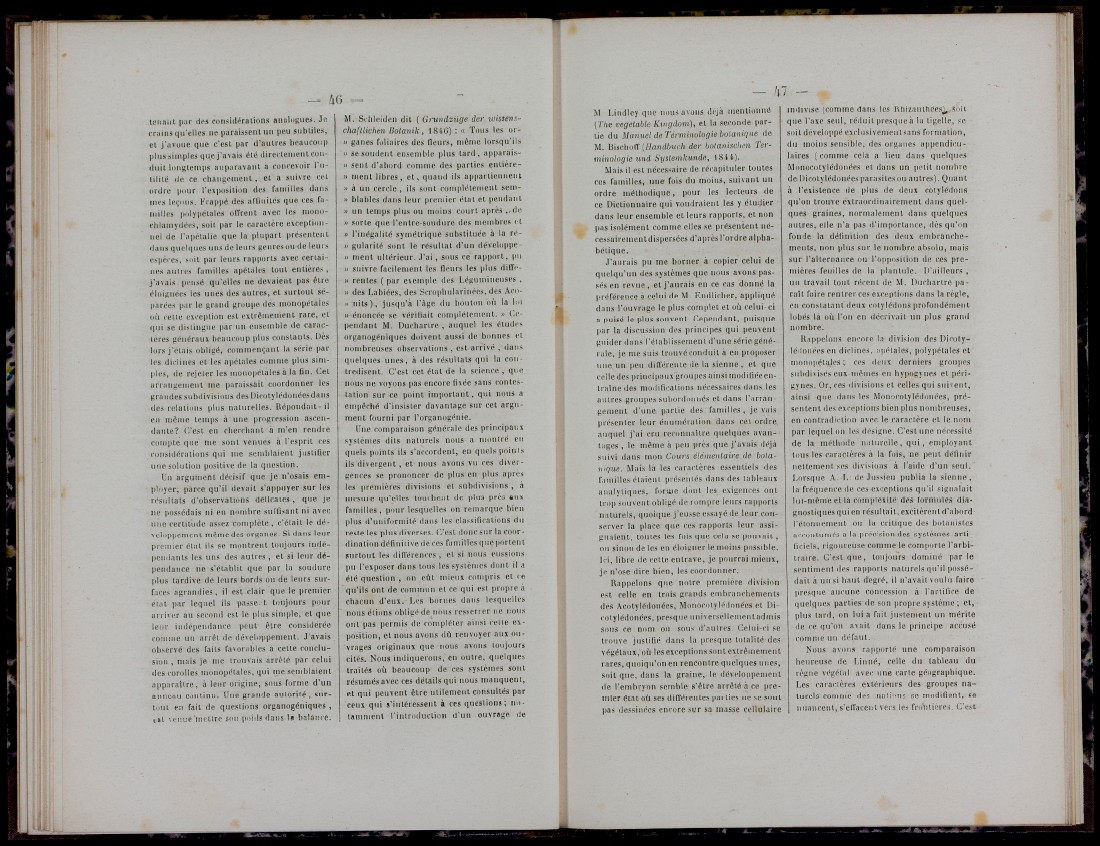
/ i G —
h i
[ i
teiiiUU lies eonsîdéraLions anal()j;iies. Jo
rraiiis qu'elles lie paraissent un peu subliles,
et j'avoue que c'esl par d'autres beauconj)
plus simples que j 'avai s été direrleiuent conduit
longtemps auparavant à conrevoir l'utilité
(le ce chaiiyeinenl, et a suivre cet
ordre pour l'exposition des faniilles dans
nu's leçDus. Frappé des affinités que ces ramilles
[)oly[)èLales oiirent avec les monochlamydées,
soit par le caractère exceptionnel
de l'apétalie que la plupart présentent
dans quelijues uns de leurs genres ou de leurs
espèces, soit par leurs rapports avec certaines
autres familles apétales tout entières,
j ' a v a i s pensé qu'elles ne devaient pas être
éloitinées les unes des autres, et surtout séparées
par le grand groupe des inonopétales
où cetie exception est extrêmement rare, et
(}ui se disiingue par un ensemlile de caractères
généraux beaucoup plus coiistants. Des
lurs j'étais obligé, commençant la série par
les diriines et les apétales comme plus sini-
[)les, de rejeter les monopétales à la fin. Cet
arrangement me paraissait coordonner les
grandes subdivisions des Dicotylédonéesdans
des relations plus naturelles. Répondait-il
en même temps à une progression ascendante?
("est en cherchant à m'en rendre
compte que nie sont venues à l'esprit ces
considérations qui me semblaient justifier
une solution positive de la question.
Un argument décisif que je n'osais em-
])loyer, parce qu'il devait s'appuyer sur les
résultais d'observations délicates, que je
ne possédais ni en nombre suffisant ni avec
uïie certitude assez complète, c'était ie dé-
\eloppement rnêmedes organes. Si dans leur
premier état ils se montrent toujours indépendants
les uns des autres, et si leur dépendance
ne s'établit que par la soudure
plus tardive de leurs bords ou de leurs surfaces
agrandies, il est clair que le premier
état par lequel ils passe, t toujours pour
arriver au second est le plus simple, et que
ItMir indépendance peut être considérée
comme un arrêt de développement. J'avais
observé des faits faxorables à cette conclusion
, mais je me trouvais arrêté par celui
des corolles monopétales, qui me semblaient
apparaître, à leur origine, sous forme d'un
anneau continu. Une grande autorité, surtout
en fait de questions organogéniques ,
t s t ^eiiue mettre son poids dans ia balance.
M. Schleiden dit ( Grundsiige der lOisseTi:^"
chafUichtn Bolanik, 1840)) : « Tous les orj)
ganes foliaires des fleurs, même lorsqu'ils
» se soudent ensemble plus tard, apparais-
» sent d'abord comme des parties entière-
» ment libres, et, quand ils appartiennent
)) à un cercle, ils sont complètement setn-
)) blables dans leur premier état et pendant
» un temps plus ou moins court après
» sorte que l'entre-soudure des membres et
0 l'inégalité symétrique substituée à la ré-
» gularité sont ie résultat d'un développe-
>) rnent ultérieur. J'ai , sous ce rapport, pu
» suivre facilement les Heurs les plus dillV'-
)> rentes ( par exemple des Légumineuses ,
» des Labiées, des Scropbularinées, des Àco-
» ni ts) , jusqu'à l'Age du bouton où la loi
» énoncée se vérifiait complètement. » Cependant
M. Duchartre , auquel les études
organogéniques doivent aussi de bonnes et
nombreuses observations , est arrivé , datis
quelques unes, à des résultats qui la contredisent.
C'est cet état de la science , que
nous ne voyons pas encore fixée sans contestation
sur ce point important, qui nous a
empêché d'insister davantage sur cet argument
fourni par Torganogénie.
Une comparaison générale des principaux
systèmes dits naturels nous a montré en
quels points ils s'accordent, en quels points
ils divergent , et nous avons vu ces divergences
se prononcer de plus en plus après
les premières divisions et subdivisions , à
mesure qu'elles touchent de plus près aux
f a m i l l e s , pour lesquelles on remarque bien
plus d'uniformité dans les classifications du
reste les plus diverses. C'est donc sur la coordination
définitive de ces familles que portent
surtout les dilTérences, et si nous eussions
pu l'exposer dans tons les systèmes dont il a
été question , on eût mieux compris et (e
qu'ils ont de connnun et ce qui est propre à
chacun d'eux. Les bornes dans lesquelles
nous étions obligé de tious resserrer ne nous
ont pas permis de compléter ainsi cette exposition,
et nous avons dû renvoyer aux ouvrages
originaux que nous avons toujours
cités. Nous indiquerons, en outre, quelques
traités où beaucoup de ces systèmes sont
résumés avec ces détails qui nous rnanquen t,
et qui peuvent être utilement consultés par
ceux qui s'intéressent à ces questions; notamment
l'introduction d'un ouvrnge de
M Lindley que iu)usavons déjà mentionné
(The vegetable Ktiigdom), et la seconde partie
du Manuel de Terminologie botanique de
M. BiscliofT{i/ana6uc/i der botanischen Terminologie
und Systemkunde, 1844).
Mais il est nécessaire de récapituler toutes
ces familles, une fois du moins, suivant un
ordre méthodique, pour les lecteurs de
ce Dictionnaire qui voudraient les y étudier
dans leur ensemble et leurs rapports, et non
pas isolément comme elles se présentent nécessairementdispersées
d'après l'ordre alphabétique.
J ' a u r a i s pu me borner à copier celui de
quelqu'un des systèmes que nous avons passés
en revue, et j 'aurais en ce cas donné la
préférence à celui de M. Endlicher, appliqué
dans Touvrage le plus complet et où celui-ci
a puisé le plus souvent. Cependant, puisque
par la discussion des principes qui peuvent
guider dans rétablissement d'une série générale,
j e me suis trouvé conduit à en proposer
une, un peu dilTérenie de la sienne, et que
celle des principaux groupes ainsi modifiéeentraîne
des modifications nécessaires dans les
autres groupes subordonnés et dans Tarrangement
d'une partie des familles, je vais
présenter leur énumération dans cet, ordre
auquel j'ai cru reconnaître quelques avantages
, le même à peu près que j'avais déjà
suivi dans mon Cours élénienlaire de bolatiique.
Mais là les caractères essentiels des
Timilles étaient présent.és dans des tableaux
analytiques, forwe dont les exigences ont
trop souvent obligé de rompre leurs rapports
naturels, quoique j^eusse essayé de leur conserver
la place que ces rapports leur assignaient,
toutes les fois que cela se pouvait,
ou sinon de les en éloigner le moins possible.
Ici, libre de celte entrave, je pourrai mieux,
j e n'ose dire bien, les coordonner.
Rappelons que notre première division
est celle en trois grands embranchements
des Acotylédonées, Monocotylédonées et Dicotylédonées,
presque universellernentadmis
sous ce nom ou sous d'autres. Celui-ci se
trouve justifié dans la presque totalité des
Yégétaux;où les exceptions sont extrêmement
rares, quoiqu'on en rencontre quelques unes,
soit que, dans la graine, le développement
de l'embryon semble s'être arrêté à ce premier
état où ses différentes parties ne se sont
pas dessinées encore sur sa masse cellulaire
indivise (comme dans les Rhizanthées¿, soit
que l'axe seul, réduit presque à la tigelle, se
soit développé exclusivemeutsans formation,
du moins sensible, des organes a[)pendiculaires
(comme cela a lieu dans quelques
Monocotylédonées et dans un ()etit nombre
de Dicotylédonées parasites ou autres). Quant
à l'existence de plus de detix cotylédons
qu'on trouve extraordinairement dans quelques
graines, normalement dans quelques
autres, elle n'a pas d'importance, dès qu'on
fonde la définition des deux embranchements,
non plus sur le nombre absolu, mais
sur ralternance ou l'opposition de ces premières
feuilles de la plantule. D'ailleurs ,
un travail tout récent de M. Duchartre paraît
faire rentrer ces exceptions dans la règle,
en constatant d e u x cotylédons profondément
lobés là où l'on en décrivait un plus grand
nombre.
Rappelons encore la division des Dicotylé'Ionées
en diclines, apétales, polypétales et
monopétales; ces deux derniers groupes
subdivisés eux-Tïiêtnes en hypogynes et périgynes.
Or, ces divisions et celles qui suivent,
ainsi que dans les Monocotylédonées, présentent
des exceptions bien plus nombreuses,
en contradiction avec le caractère et le nom
par lequel on les désigne. C'est une nécessité
de la méthode naturelle, qui, employant
tous les caractères à la fois, ne peut définir
nettement ses divisions à l'aide d'un seul.
Lorsque A.-Í.. de Jussieu publia la sienne,
la fréquence de ces exceptions qu'il signalait
lui-même et la complexité des formules diagnostiques
qui en résultait, excitèrent d'à bordréionnement
ou la critique des botanistes
accoutumés a la i)réc'sion des systèmes arti -
ficiels, rigoureuse comme le comporte l'arbitraire.
C'est que, toujours dominé parle
sentiment des rapports naturels qu'il possédait
à un si haut degré, il n'avait voulu faire
presque aucune concession à l'artifice de
quelques parties de son propre système ; et,
plus tard, on lui a fait jiisteiïient un mérite
de ce qu'on avait dans le principe accusé
comme un défaut.
Nous avons rajjporté une comparaison
heureuse de Linné, celle du tableau du
règne végétal avec une carte géographique.
Les caractères extérieurs des groupes naturels
comme des tiaîîons se modifient, se
nuancetit, s'elTacenl vers les froniières. C'est
ri JL_