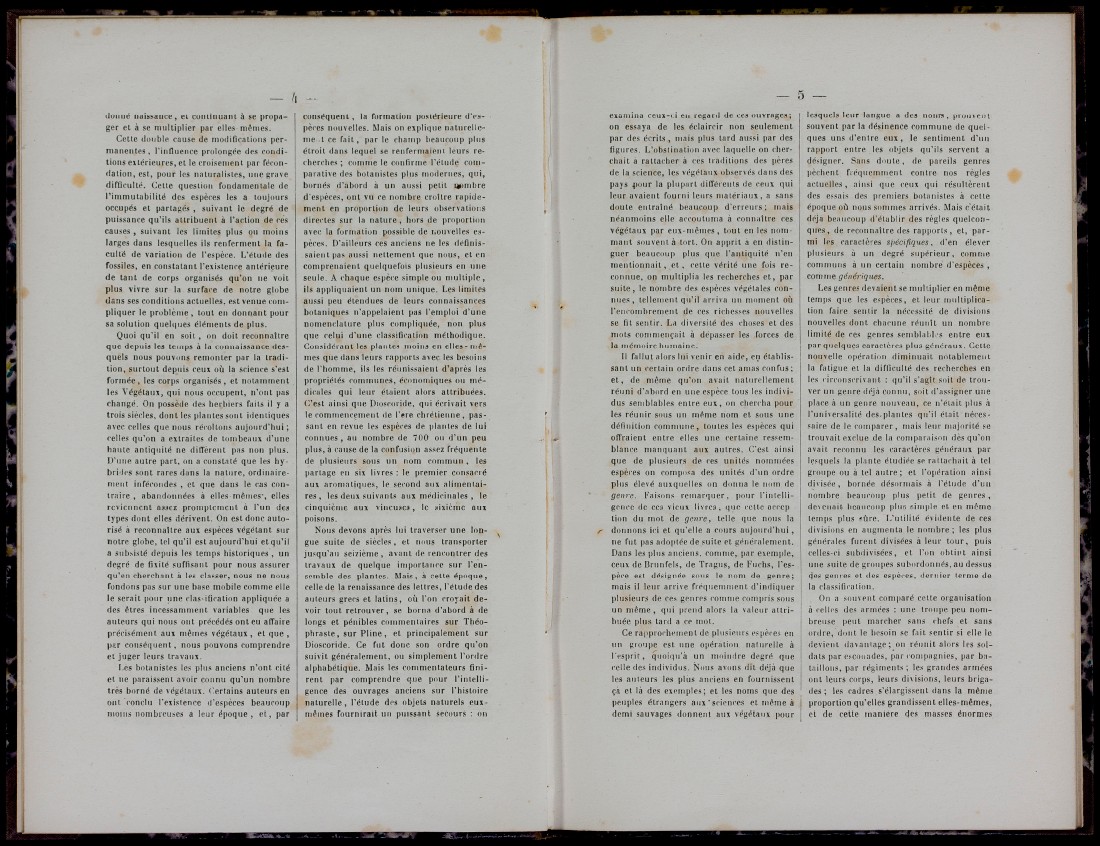
il -
donné naissance, ei continuant à se propager
et à se multiplier par elles mêmes.
Cette double cause de modificatious permanentes,
Tinfluetice prolongée des conditions
eitérieures, et le croisement par fé<'ondation,
est, pour les naturalistes, une grave
difficulté. Cette question fondamentale de
rimmutabilité des espèces les a toujours
occupés et partagés , suivant le degré de
puissance qu'ils attribuent à Paction de ces
causes, suivant les limites plus ou moins
larges dans lesquelles ils renferment la faculté
de variation de Tespèce. L'étude des
fossiles, en constatant l'existence antérieure
de tant de corps organisés qu'on ne voit
plus vivre sur la surface de notre globe
dans ses conditions actuelles, est venue compliquer
le problèiiie , tout en donnant pour
sa solution quehjues éléments de plus.
Quoi qu'il en soit, on doit reconnaître
que depuis les temps à la connaissance desquels
nous pouvons remonter par la tradition,
surtout depuis ceux où la science s'est
formée, les corps organisés, et notamment
les Végétaux, qui nous occupent, n'ont pas
changé. On possède des herbiers faits il y a
trois siècles, dont les plantes sont identiques
avec celles que nous récoltons aujourd'hui ;
celles qu'on a extraites de tombeaux d'une
haute antiquité ne diÎVèrent pas non plus.
D'une autre part, on a constaté que les hybri'Jes
sont rares dans la nature, ordinairement
infécondes , et que dans le cas contraire
, abandonnées à elles mêmes*, elles
reviennent assez promptement à l'un des
types dont elles dérivent. On est donc autorisé
à reconnaître aux espèces végétant sur
notre globe, tel qu'il est aujourd'hui et qu'il
a sub.sisté depuis les temps historiques, un
degré de fixité suffisatit pour nous assurer
qu'en cherchant à les classer, nous ne nous
fondons pas sur une base mobile comme elle
le serait pour une classification appliquée a
des êtres incessamment variables, que les
auteurs qui nous ont précédés ont eu affaire
précisément aux mêmes végétaux, et que ,
par conséquent, nous pouvons comprendre
et juger leurs travaux.
I.es botanistes les plus anciens n'ont cité
et ne paraissent avoir connu qu'un nombre
très borné de végétaux. C.ertains auteurs en
ont conclu l'existence d'espèces beaucoup
moins nombreuses à leur époque j et, par
conséquent, la formation postérieure d'espèces
nouvelles. Mais on explique natureileme
.t ce fait, par le champ beaucoup plus
étroit dans lequel se renfermaient, leurs recherches
; comme le confirme l'étude comparative
des botanistes plus lïioderiies, qui,
bornés d'abord à un aussi petit ni>mbre
d'espèces, ont vu ce nombre croître rapidement
en proportion de leurs observations
directes sur la nature, hors de proportiots
avec la forrïiatioii possible de nouvelles espèces.
D'ailleurs ces anciens ne les défitiissaientpas
aussi nettement que nous, et en
comprenaient quelquefois plusieurs en une
seule. A chaque espèce simple ou multiple,
ils appliquaient un nom unique. Les limites
aussi peu étendues de leurs connaissances
botaniques n'appelaient pas l'emploi d'une
nomenclature plus compliquée, non plus
que celui d'une classification méthodique.
Considérant les plantes moins en elles-mêmes
que dans leurs rapports avec les besoins
de l'homme, ils les réunissaient d'après les
propriétés communes, économiques ou médicales
qui leur étaient alors attribuées.
C/est ainsi que Dioscoride, qui écrivait vers
le commencement de l'ere chrétienne, passant
en revue les espèces de [)lantes de lui
connues , au nombre de 700 ou d'un peu
plus, à cause de la confusion assez fréquente
de plusieurs sous un nom commun , les
partage en six livres : le premier consacré
aux aromatiques, le second aux alimentaires
, les deux suivants aux médicinales , le
cinquième aux vineuses, le sixième aux
poisons.
Nous devons après lui traverser une longue
suite de siècles, et nous transporter
jusqu'au seizième , avant de rencontrer des
travaux de quelque importance sur l'ensemble
des plantes. Mais, à cette époque,
celle de la renaissance des lettres, l'étude des
auteurs grecs et latins, où l'on croyait devoir
tout retrouver, se borna d'abord à de
longs et pénibles commentaires sur Théophraste,
sur Pline, et principalement sur
Dioscoride. Ce fut donc son ordre qu'on
suivit généralement, ou simplement l'ordre
alphabétique. Mais les commentateurs finirent
par comprendre ^le pour l'intelligence
des ouvrages anciens sur l'histoire
naturelle, l'étude des objets naturels euxmêmes
fournirait un puissant secours : on
examina ceux-ci en regard de ces ouvrages;
on essaya de les éclaircir non seulement
par des écrits , mais plus tard aussi par des
figures. L'obstination avec laquelle on cherchait
à rattacher à ces traditions des pères
de la science, les végétaux observés dans des
pays 4)our la plupart différents de ceux qui
leur avaient fourni leurs matériaux, a sans
doute entraîné beaucoup d'erreurs; mais
néanmoins elle accoutuma à connaître ces
végétaux par eux-mêmes, tout en les nom^
mant souvent à tort. On apprit a en distinguer
beaucoup plus que l'antiquité n'en
mentionnait, et, cette vérité une fois reconnue,
on multiplia les recherches et, par
s u i t e , le nombre des espèces végétales connues,
tellement qu'il arriva un moment où
l'encombrement de ces richesses nouvelles
se fit setitir. La diversité des choses et des
mots commençait à dépasser les forces de
la mémoire humaine.
Il fallut alors lui venir en aide, en établissant
un certain ordre dans cet amas confus ;
e t , de même qu'on avait naturellement
réuni d'abord en une espèce tous les individus
semblables entre eux, on chercha pour
les réunir sous un même nom et sous une
définition comnuine, toutes les espèces qui
offraient entre elles une certaine ressemblance
manquant aux autres. C'est ainsi
que de plusieurs de ces unités nommées
espèces on composa des unités d'un ordre
plus élevé auxquelles on donna le nom de
genre. Faisons remarquer, pour l'intelligence
de ces vieux livres, que cette acception
du mot de genre, telle que nous la
donnons ici et qu'elle a cours aujourd'hui,
ne fut pas adoptée de suite et généralement.
Dans les plus anciens, comme, par exemple,
ceux de Brunfels, de Tragus, de Fuchs, l'espèce
est désignée sous le nom de genre;
mais il leur arrive fréquemment d'indiquer
plusieurs de ces genres comme compris sous
un même, qui prend alors la valeur attribuée
plus tard a ce mot.
Ce rapprocbement de plusieurs espèces en
un groupe est une opération naturelle à
l'esprit, quoiqu'à un moindre degré que
celle des individus. Nous avons dit déjà que
les auteurs les plus anciens en fournissent
çà et là des exemples; et les noms que des
peuples étrangers aux'sciences et même à
demi sauvages donnent aux végétaux pour
lesquels leur langue a des nonB, prouveiU
souvent par la désinence commune de quelques
uns d'entre eux, le sentiment d'un
rapport entre les objets qu'ils servent a
désigner. Sans doute, de pareils genres
pèchent fréquemment contre nos règles
actuelles, ainsi que ceux qui résultèrent
des essais des prertiiers botiuiistes à celte
époque où nous sommes arrivés. Mais c'était
déjà beaucoup d'établir des règles quelconques,
de reconnaître des rapports, et, parmi
les caractères spécifiques, d'en élever
plusieurs à un degré supérieur, comme
communs à un certain ïiornbre d'espèces ,
com m e gén ériques.
Les genres devaient se multiplier en même
temps que les espèces, et leur multiplication
faire sentir la nécessité de divisions
nouvelles dont chacune réunît un nombre
limité de ces genres semblald^'s entre eux
par quelques caractères plus généraux. Cette
nouvelle o[)ération diminuait notablement
la fatigue et la difficulté des recherches en
les circonscrivant : qu'il s'agît soit de trouver
un genre déjà connu, soit d'assigner uiïe
place à un genre nouveau, ce n'était plus à
l'universalité des^plantes qu'il était nécessaire
de le comparer, mais leur majorité se
trouvait exclue de la comparaison dès qu'on
avait reconnu les caractères généraux par
lesquels la plante étudiée se rattachait à tel
groupe ou à tel autre; et l'opération ainsi
divisée, bornée désormais à l'étude d'un
nombre beaucoup plus petit de genres ,
deNenait beaucoup plus simple et en même
temps plus ^ûre. L'utilité évidente de ces
divisions en augmenta le nombre; les plus
générales furent divisées à leur tour, puis
celles-ci subdivisées, et l'on obtint ainsi
une suite de groupes subordonnés, au dessus
des genres et des espèces, dernier terme de
la classification.
On a souvent comparé cette organisation
à cellos des armées : une troupe peu nombreuse
peut marcher sans chefs et sans
ordre, dont le besoin se fait sentir si elle le
devient davantage; ou réunit alors les soldats
par escouades, par compagnies, par bataillons,
par régiments; les grandes armées
ont leurs corps, l^eurs divisions, leurs brigades
; les cadres s'élargissent dans la même
proportion qu'elles grandissent elles-mêmes,
et de cette înanière des masses énormes