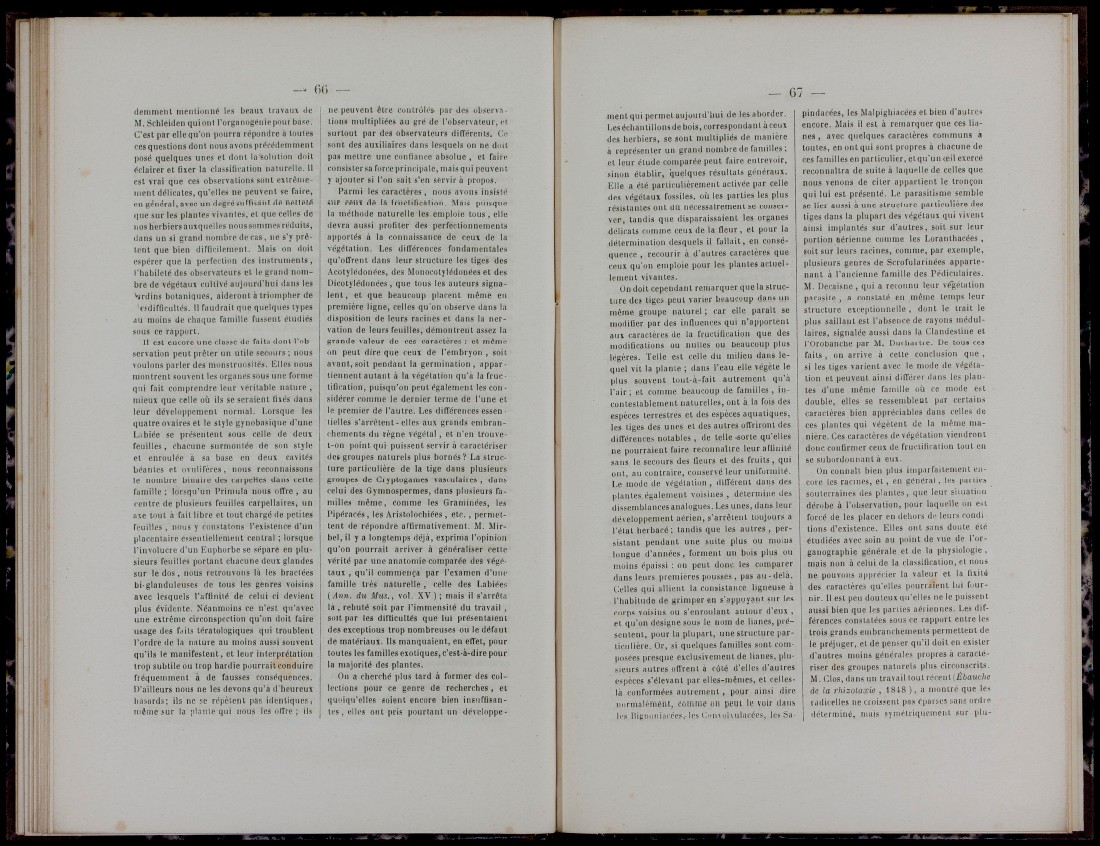
•im - w
!
r>(i
(leniment inenlionné les beaux travaux de
M. Schleiden quioi i i l'organogéniepoui base.
C'est par elle qu'on pourra répondre à toutes
ces questions dont nous avons précédemment
posé quelques unes et dont la solution doit
éclairer et fixer la classiûcalion naturelle, il
est vrai que ces observations sont extrênietiient
délicates, qu'elles ne peuvent se faire,
en général,avec un degrésuffisant de netteté
(lue sur les plantes vivantes, et que celles de
nos herbiersauxquelles nonssonunesréduits,
dans un si grand nombre de cas, ne s'y prêtent
que bien difficilement. Mais on doit
espérer que la perfection des instruments,
l'habileté des observateurs et le grand nombre
de végétaux cultivé aujourd'hui dans les
Wrdins botaniques, aideront à triompher de
•i'idifficultés. Il faudrait que quelques types
AU moins de chaque famille fussent étudiés
sous ce rapport.
Il est encore une classe de faits dont l'observation
peut prêter un utile secours ; nous
voulons parler des monstruosités. Elles nous
montrent souvent les organes sous une forme
qui fait comprendre leur véritable nature ,
mieux que celle où ils se seraient fixés dans
leur développement normal. Lorsque les
quatre ovaires et le style gynobasique d'une
L;ibiée se présentent sous celle de deux
feuilles, chacune surmontée de son style
et enroulée à sa base en deux cavités
béantes et ovulifères, nous reconnaissons
le nombre binaire des carpeHes dans cette
famille; lorsqu'un Primula nous offre, au
centre de plusieurs feuilles carpellaires, un
axe tout à fait libre et tout chargé de petites
feuilles , nous y constatons l'existence d'un
placentaire essentiellement central ; lorsque
l'involucre d'un Euphorbe se sépare en plusieurs
feuilles portant chacune deux glandes
sur le dos, nous retrouvons là les bradées
bi-glanduleuses de tous les genres voisins
avec lesquels l'affinité de celui ci devient
plus évidente. Néanmoins ce n'est qu'avec
une extrême circonspection qu'on doit faire
usage des faits tératologiques qui troublent
Tordre de la nature au moins aussi souvent
qu'ils le manifestent, et leur interprétation
trop subtile ou trop hardie pourrait conduire
fréquemment à de fausses conséquences.
D'ailleurs nous ne les devons qu'à d heureux
hasards; ils ne se répètent pas identiques,
même sur la plante qui nous les oiïre ; ils
ne peuvent être contrôlés- par des observations
multipliées au gré de l'observateur, et
surtout par des observateurs différents. Ce
sont des auxiliaires dans lesquels on ne doit
pas mettre une confiance absolue, et faire
consister sa force principale, mais qui peuvent
y ajouter si l'on sait s'en servir à propos.
Parmi les caractères, nous avons insisté
sur ceux de la fructification. Mais puisque
la méthode naturelle les emploie tous, elle
devra aussi profiter des perfectionnements
apportés à la connaissance de ceux de la
végétation. Les différences fondamentales
qu'oiïrent dans leur structure les tiges des
Acotylédonées, des Monocotylédonées et des
Dicotylédonées, que tous les auteurs signal
e n t , et que beaucoup placent même en
première ligne, celles qu'on observe dans ia
disposition de leurs racines et dans la nervation
de leurs feuilles, démontrent assez la
grande valeur de ces caractères : et même
on peut dire que ceux de l'embryon , soit
avant, soit pendant la germination, appartiennent
autant à la végétation qu'à la fructification,
puisqu'on peut également les considérer
comme le dernier terme de l'une et
le premier de l'autre. Les différences essen
tielles s'arrêtent - elles aux grands embranchements
du règne végétal, et n'en trouvet
on point qui puissent servir à caractériser
des groupes naturels plus bornés? La structure
particulière de la tige dans plusieurs
groupes de Cryptogames vasculaires, dans
celui des Gymnospermes, dans plusieurs familles
même, comme les Graminées, les
Pipéracés, les Aristolochiées, etc., permettent
de répondre affirmativement. M. Mirbel,
i l y a longtemps déjà, exprima l'opinion
qu'on pourrait arriver à généraliser cette
vérité par une anatomie comparée des végétaux
, qu'il commença par l'examen d'une
famille très naturelle , celle des Labiées
{Ann. du Mus,, vol. XV) ; mais il s'arrêta
là , rebuté soit par l'immensité du travail ,
soit par les difficultés que lui présentaient
des exceptious trop nombreuses ou le défaut
de matériaux. Ils manquaient, en effet, pour
toutes les familles exotiques, c'est-à-dire pour
la majorité des plantes.
On a cherché plus tard à former des collections
pour ce genre de recherches , et
quoiqu'elles soient encore bien insuffisantes,
elles ont pris pourtant un développe-
G 7
ment qui permet aujourd'hui de les aborder.
Les échantillonsdebois, correspondant ùceux
des herbiers, se sont multipliés de manière
à représenter un grand nombre de familles ;
et leur étude comparée peut faire entrevoir,
sinon établir, quelques résultats généraux.
Elle a été particulièrement activée par celle
des végétaux fossiles, où les parties les plus
résistantes ont dû nécessairement se conserver,
tandis que disparaissaient les organes
délicats comme ceux de la fleur, et pour la
détermination desquels il fallait, en conséquence
, recourir à d'autres caractères que
ceux qu'on emploie pour les plantes actuellement
vivantes.
On doit cependant remarquer que la structure
des tiges peut varier beaucoup dans un
même groupe naturel ; car elle paraît se
modifier par des influences qui n'apportent
aux caractères de la fructification que des
modifications ou nulles ou beaucoup plus
légères. Telle est celle du milieu dans lequel
vit la plante ; dans l'eau elle végète le
plus souvent tout-à-fait autrement qu'à
l ' a i r ; et comme beaucoup de familles , incontestablement
naturelles, ont à la fois des
espèces terrestres et des espèces aquatiques,
les tiges des unes et des autres offriront des
différences notables, de telle ^sorte qu'elles
ne pourraient faire reconnaître leur affinité
sans le secours des fleurs et des frui ts, qui
ont, au contraire, conservé leur uniformité.
Le mode de végétation , difl'érenl dans des
plantes également voisines , détermine des
dissemblances analogues. Les unes, dans leur
développement aérien, s'arrêtent toujours a
rétat herbacé; tandis que les autres , persistant
pendant une suite plus ou moins
longue d'années, forment un buis plus ou
moins épaissi : on peut donc les comparer
dans leurs premières pousses, pas au-delà.
Celles qui allient la consistance ligneuse à
l'habitude de grimper en s'appuyant sur les
corps voisins ou s'enroulant autour d'eux ,
et qu'on désigne sous le nom de lianes, présentent,
pour la plupart, une structure particulière.
Or, si quelques familles sont composées
presque exclusivement de lianes, plusieurs
autres ofl'rent à côté d'elles d'autres
espèces s'élevant par elles-mêmes, et celleslà
conformées autrement, pour ainsi dire
normalement, comme on peut le voir dans
les ni&;ni)niarces, les (^^n^oí^uIacées, les Sapindacées,
les Malpighiacées et bien d'autres
encore. Mais il est à remarquer que ces lianes,
avec quelques caractères communs à
toutes, en ont qui sont propres à chacune de
ces familles en particulier, etqu'un oeil exercé
reconnaîtra de suite à laquelle de celles que
nous venons de citer appartient le tronçon
qui lui est présenté. Le parasitisme semble
se lier aussi à une structure particulière des
tiges dans la plupart des végétaux qui vivent
ainsi implantés sur d'autres, soit sur leur
portion aérienne comme les Loranthacées ,
soit sur leurs racines, comme, par exemple,
plusieurs genres de Scrofularinées appartenant
à l'ancienne famille des Pédiculaires.
M. Decaisne , qui a reconnu leur végétation
parasite, a constaté en même temps leur
structure exceptionnelle , dont le trait le
plus saillant .est l'absence de rayons médullaires,
signalée aussi dans la Clandestine et
rOrobanche par M. Duchartre. De tous ces
faits j on arrive à cette conclusion que,
si les tiges varient avec le mode de végétation
et peuvent ainsi différer dans les plantes
d'une même famille où ce mode est
double, elles se ressembleat par certains
caractères bien appréciables dans celles de
ces plantes qui végètent de la même manière.
Ces caractères de végétation viendront
donc confirmer ceux de fructification tout en
se subordonnant à eux.
On connaît bien plus iuiparfaitement encore
les racines, et , en général, les parties
souterraines des plantes, que leur siiuatidu
dérobe à l'observation, pour laquelle on est
forcé de les placer en dehors de leurs condì
tions d'existence. Elles ont s;ins doute été
étudiées avec soin au point de vue de l'organographie
générale et de la physiologie,
mais non à celui de la classification, et nous
ne pouvons apprécier la valeur et la fixité
des caractères qu'elles pourraient lui fournir.
Il est peu douteux qu'elles tie le puissent
aussi bien que les parties aériennes. Les différences
constatées sous ce rapport entre les
trois grands embranchements permettent de
le préjuger, et de penser qu'il doit en exister
d'autres moins générales propres à caractériser
des groupes naturels plus circonscrits.
M. Clos, dans un travail tout récent{£òawc7ie
de la rhizotaxie , 1848 ) , a montré que les
radicelles ne croissetit pas é[)arses sans ordre
déterminé, mais symétriquetnent mr plu-
J.: j . .