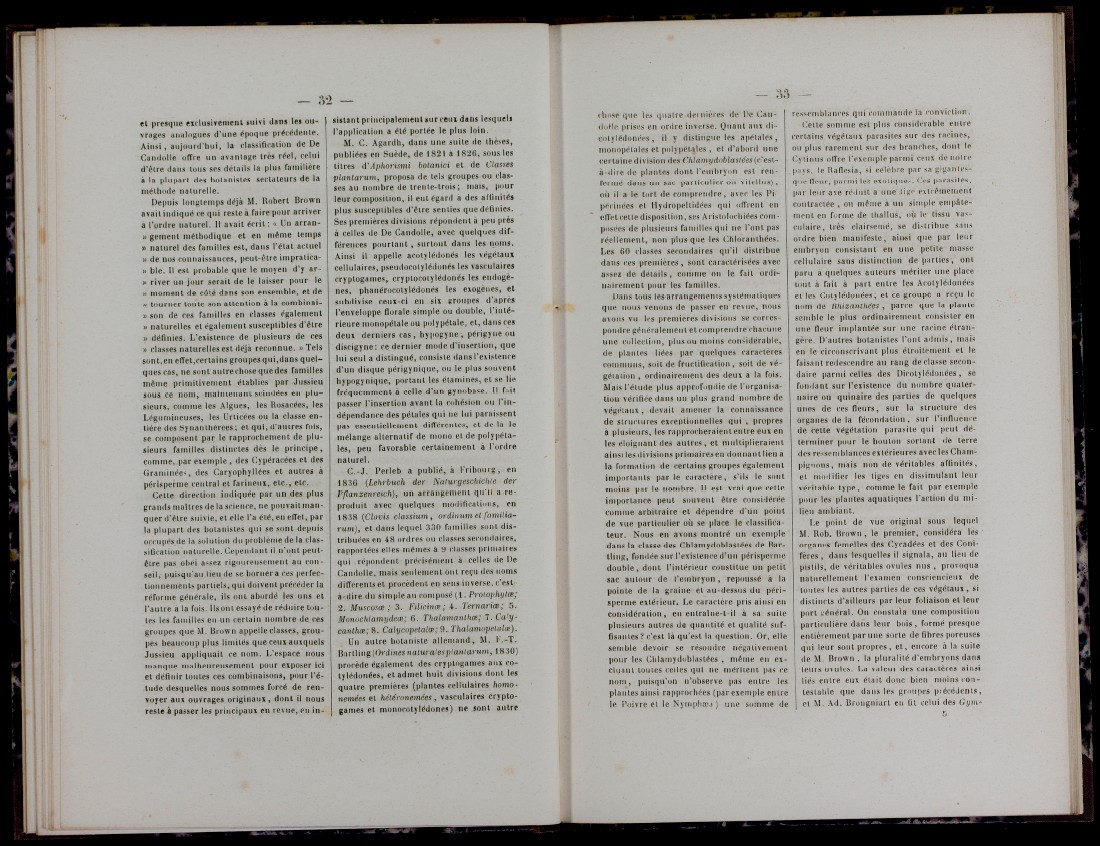
—
fUì —
e l presque exclusivement suivi dans les ou- |
vriiges analogues d'une époque précédente.
A i n s i , aujourd'hui, la classificaLion de De
Candolle onVe un avantage irès réel, celui
d ' ê t r e dans tous ses détails la plus familière
à la pluparl des botanistes sectateurs de la
méthode naturelle.
Depuis longtemps déjà M. Robert Brown
a v a i t i n d i q u é ce qui resteà faire pour arriver
a Tordre naturel. Il avait écrit: a Un arran-
)) g ement méthodique et en même temps
w naturel des familles est, dans Tétat actuel
)) de nos connaissances, peut-être impratica-
)> b le. Il est probable que le moyen d'y ar-
)) river un jour serait de le laisser pour le
» moment de côté dans son ensemble, et de
j> t o u r n e r toute son at tent ion à la combinaiï)
son de ces familles en classes également
» naturel les et également susceptibles d'être
)) définies. L'existence de plusieurs de ces
» classes naturelles est déjà reconnue. »Tels
s o n t , e n effet,certains groupes qui ,dans quelques
cas, ne sont aut rechosequedes familles
même primitivement établies par Jussieu
sous ce nom, maintenant scindées en plusieurs,
comme les Algues, les Rosacées, les
Légumineuses, les Urticées ou la classe ent
i è r e des Synanthérées; et qui, d'autres fois,
se composent par le rapprochenïent de plusieurs
familles distinctes dès le principe,
comme, par exemple , des Cypéracées et des
G r a m i n é e s des Caryophyllées et autres à
p é r i s p e r me central et farineux, etc., etc.
Cette direction indiquée par un des plus
g r a n d s maî tres de la science, ne pouvait manq
u e r d'être suivie, et elle l'a été, en eiïet, par
la plupart des botanistes qui se sont depuis
occupés de la solution du problème de la classiOcation
naturelle. Cependant il n'ont peutê
t r e pas obéi assez rigoureusement au conseil,
pui.squ'au lieu de se bort iera ces perfect
i o n n e m e n t s partiels, qui doivent précéder la
r é f o r m e générale, ils ont abordé les uns et
l ' a u t r e a la fois, l l sont essayé de réduire toutes
les familles en un certain nombre de ces
groupes que M. Brown appelle classes, groupes
beaucoup plus limités que ceux auxquels
J u s s i e u appliquait ce nom. L'espace nous
m a n q u e malheureusement pour exposer ici
e t définir toutes ces combinaisons, pour l'ét
u d e desquelles nous sommes forcé de renvoyer
aux ouvrages originaux, dont il nous
r e s t e à passer les principaux en revue, en ins
i s t a n t principalement surceux dans lesqucli
Tapplication a été portée le plus loin.
M. C. Agardh, dans une suite de thèses,
publiées en Suède, de 1821 à sous les
t i t r e s iVAphorisnii botanici et de Classes
planlarum, proposa de tels groupes ou classes
au nombre de trente-trois; mais, pour
leur composition, il eut égard à des amnités
plus susceptibles d'être senties que définies.
Ses premières divisions répondent à peu près
à celles de De Candolle, avec quelques différences
pourtant , surtout dans les noms.
Ainsi il appelle acotylédonés les végétaux
c e l l u l a i r e s , pseudocolylédonés les vasculaires
cryptogames, cryptocotylédonés les endogènes,
phanérocotylédonés les exogènes, et
subdivise ceux-ci en six groupes d'après
l'enveloppe florale simple ou double, l'intér
i e u r e monopétal e ou polypétale, et, dans ces
deux derniers cas, hypogyne, périgyne ou
d i s c i g y n e : ce dernier mode d'insertion, que
lui seul a dist ingué, consiste dans l'existence
d ' u n disque périgynique, ou le plus souvent
hypogynique, portant les étamines, et se lie
f r é q u e m m e n t à celle d'un gynobase. Il fait
passer l'insertion avant la cohésion ou l'indépendance
des pétales qui ne lui paraissent
pas essentiellement diiTérentes, et de là le
mélange alternatif de mono et de polypétales,
peu favorable certainement à l'ordre
n a t u r e l .
C . - J . Perleb a publié, à Fribourg, en
1 8 3 6 (Lehrbuch der Naturgeschichle der
rfianzenreich)j un arrangement qu'il a rep
r o d u i t avec quelques modificatiotis, en
1838 {Clovis classium, ordinum el familiar
rum), et dans lequel 330 familles sont dist
r i b u é e s en 48 ordres ou classes secondaires,
rapportées elles mêmes à 9 classes primaires
qui répondent précisément à celles de De
Candolle, mais seulement ont reçu des noms
d i f f é r e n t s et procèdent en sens inverse, c'està
- d i r e du simple au composé (1. Prolophytoe;
2. Muiicosoe ; 3. Filicinoe ; 4. Ternarioe ; 5.
Monochiamydeoe; 6. Thalomanthoe; 7. CaJycanthoe;
S. Calycopetaloe; 9. rhalamopelaloe).
Un autre botaniste allemand, Al. F.-T.
B'àri\wg{Ordinesnaturalesplanlarurn, 18 3 0 )
procède également des cryptogames aux cotylédonées,
et adme t huit divisions dont les
q u a t r e premières (plantes cellulaires homonemées
et héléronemées, vasculaires cryptogames
et monocotylédones) ne sont autre
c'ïiosf que les mialre dernières de De CanîIdHc
prises en or<ire inverse. Quant aux dic
o t y l é d o n é e s , il y distingüeles apétales,
monopétales et polypétales, et d'abord une
c e r t a i n e division des C'/i/am'i/dofeias/ee5(c'està
- d i r e de plantes dont Fembryim est renfermé
dans un sac particulier ou viteilus),
où il a le tort de comprendre, avec les Pi
p é r i n é e s et Hydropeltidées qui offrent en
effet cet t e disposi t ion, ses Aristolocliiées coîuposécs
de plusieurs familles qui ne l'ont pas
r é e l l e m e n t , non plus que les Chloranthées.
Les GO classes secondaires qu'il distribue
dans ces premières, sont caractérisées avec
assez de détails, comme on le fait ordi-^
n a i r e m e n t pour les familles.
Dans tous les a r r a n g eme n t s systématiques
que nous venons de passer en revue, nous
avons vu les premières divisions se correspondre
généralement et comprendr e chacune
u n e collection, plus ou moins considérable,
d e plantes liées par quelques caractères
comtnuns, soit de fructification, soit de végéiaiion
, ordinairement des deux à la fois.
jVlais r é i u d e plus approft)niiie de l'organisation
vérifiée dans un plus grand nombre de
v é g é t a u x , devait amener la connaissance
d e structures exceptionnelles qui , propres
à plusieurs, les rapprocheraient ent r e eux en
les éloignant des autres, et multiplieraient
ainsi les divisions primaires en donnant lieu à
la formation de certains groupes également
i m p o r t a n t s par le caractère, s'ils le sont
moins par le nombre. Il est vrai que cette
i m p o r t a n c e peut souvent être considérée
comme arbitraire et dépendre d'un point
d e vue particulier où se place le classificat
e u r . Nous en avons montré un exemple
dans la classe des Chlamydoblastées de Bart
l i n g , fondée sur l'existence d 'un périsperme
d o u b l e , dont l'intérieur constitue un petit
sac autour de l'embryon, repoussé à la
pointe de la graine et au-dessus du périsperme
extérieur. Le caractère pris ainsi en
c o n s i d é r a t i o n , en entraîne-t-il à sa suite
p l u s i e u r s autres de quantité et qualité suffisantes?
c'est là qu'est la question. Or, elle
semble devoir se résoudre négativement
pour les Chlamydoblastées , même en exc
l u a n i toutes celles qui ïie méritent pas ce
n o m , puisqu'on n'observe pas entre les
p l a n t e s ainsi rapprochées (par exempl e entre
le Poivre et le Nymphaî j ) une somine de
ressemblances qui coîiHnande la conviclioru
Cette sonune est plus considérable entre
c e r t a i n s végétaux parasites sur des racines,
ou plus rarement sur des branches, dont le
Cytihus offre l 'exemple panni ceux de noire
pays, le Uaflesia, si célèbre par sa giganlesqiie
Heur, parmi les exouques. i^cs parasites,
par leur axe réduit a une îiiic exlrêinemenî
c o n t r a c t é e , on même à un simple empâtement
en forme de thallus, où le tissu vasc
u l a i r e , très clairsemé, se distribue sans
o r d r e bien manifeste, ain^si que par leur
embryon consistant en une petite masse
c e l l u l a i r e sans distinction départies, ont
p a r u à quelques auteurs mériter une place
tout à fait à part entre les Acotylédonées
et les Cotylédonées; et ce groupe a reçu le
nom de [ihizanthées , parce que la plante
semble le plus ordinairement consister en
une fleur implantée sur une racine étrangère,
D'autres botanistes Pont admis, mais
en le circonscrivant plus étroitement et le
f a i s a n t redesceiulre au rang declasse second
a i r e parmi celles des Dirotylédonées, se
f o n d a n t sur l'existence du nombre quatern
a i r e ou quinaire des parties de quelques
unes de ces fleurs, sur la structure des
organes de la fécondation, sur l'influenre
d e cette végétation parasite qui peut dét
e r m i n e r pour le bouton sortant de terre
des ressemblances extérieures avecles Champ
i g n o n s , mais non de véritables affinités,
et modifier les tiges en dissimulant leur
v é r i t a b l e type, comme le fait par exemple
pour les plantes aquatiques Faction du milieu
ambiant.
Le point de vue original sous lequel
M. Rob. Brown, le premier, considéra les
organes femelles des Cycadées et des Conif
è r e s , datis lesquelles il signala, au lieu de
pistils, de véritables ovules nus , provoqua
n a t u r e l l e m e n t l'examen consciencieux de
toutes les autres parties de ces végétaux , si
d i s t i n c t s d'ailleurs par leur foliaison et leur
port général. On constata une composition
p a r t i c u l i è r e dans leur bois, formé presque
e n t i è r e m e n t par u n e sorte de fibres poreuses
qui leur sont propres, et, encore à la suite
d e M. Brown , la pluralité d'embryons dang
l e u r s ovules. La valeur des caractères ainsi
liés entre eux était donc bien moins cont
e s t a b l e que dans les groupes précédents,
ot M. Ad. Brongniart en fil celui des Gym