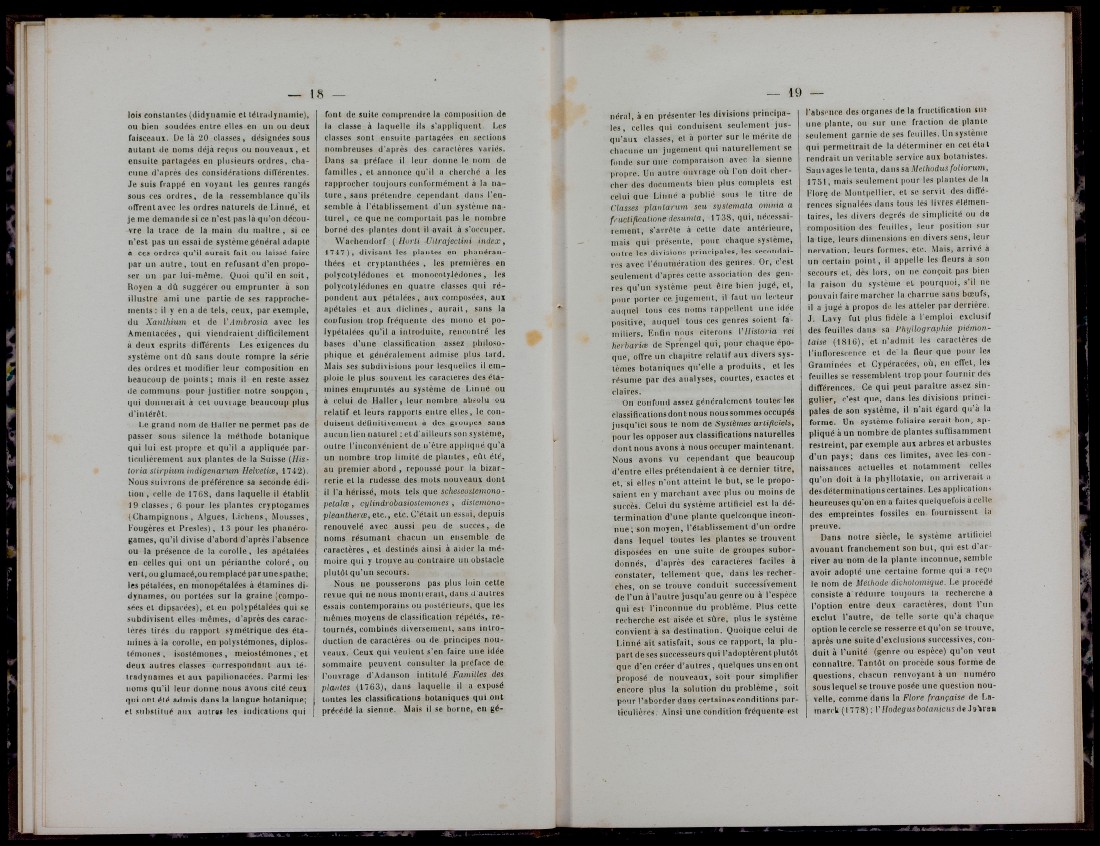
1 8
lois eonstanles (liidyiiainie et lëLradyiuniue),
ou bien soudées entre elles er» un ou deux
faisceaux. De là 20 classes, désignées sous
autant de noms déjà reçus ou nouveaux , et
ensuite partagées en plusieurs ordres, cha-
<Mi[ie (i'après des considérations dilVérentes.
J e suis frappé en voyant les genres rangés
sous ces ordres, delà ressemblance qu'ils
oiTrenlavec les ordres naturels de Linné, et
j e me demande si ce n'est pas là qu'on découvre
la trace de la main du maître , si ce
n'est pas un essai de système général adapte
à ces ordres qu'il aurait fait ou laissé faire
par un autre, tout en refusant d'en proposer
uti par lui-même. Quoi qu'il en soit,
Royen a dû suggérer ou emprunter à son
illustre ami une partie de ses rap[)rocliemenls
: il y en a de tels, ceux, par exemple,
du Xanthium et de VAnibrosia avec les
Amentacées, qui viendraient difficilement
à deux esprits différents Les exigences du
système ont dû sans doute rompre la série
des ordres et modifier leur composition en
beaucoup de points; mais il en reste assez
de communs pour justifier notre soupçon ,
qui donnerait à cet ouvrage beaucoup plus
d ' i n t é r ê t .
Le grand nom de Haller ne permet pas de
passer sous silence la méthode botanique
qui lui est projtre et qu'il a appliquée particulièrement
aux plantes de la Suisse (Historia
stirphim indigenarum Flelvetioe, 1742).
Nous suivrons de préférence sa seconde édition
, celle de 1768, dans laquelle il établit
3 9 classes, 6 pour les plantes cryptogames
(Champignons, Algues, Lichens, Movjsses,
Fougères et Presles), 13 pour les phanérogames,
qu'il divise d'abord d'après l'absence
ou la présence de la corolle, les apétalées
en celles qui ont un périanthe coloré, ou
vert, ou g lumacé,ou remplacé par unespathe;
Icspétalées, en monopétalées à étamines didynames,
ou portées sur la graine (composées
et dipsacées), et en polypétalées qui se
subdivisent elles m ême s , d'après des caractères
tirés du rapport symétrique des étamines
à la corolle, en polystémones, diploslémones,
isostémones, meiostémones, et
deux autres classes correspondant aux tétradynames
et aux papilionacées. Parmi lesnoms
qu'il leur donne nous avons cité ceux
qui ont été a4Jmis dans la langue botanique;
et substiiué aux autr«« les indications qui
font de suite comprendre la composition de
la classe à laquelle ils s'appliquent Les
classes sont ensuite partagées en sections
nombreuses d'après des caractères variés.
Dans sa préface il leur donne le nom de
familles , et annonce qu'il a cherché a les
rapprocher toujours conformément à la nat
u r e , sans prétetidre cependant dans l'ensemble
à l'établissement d'un système nat
u r e l , ce que ne comportait pas le nombre
borné des plantes dont il avait à s'occuper.
Wachendorf - ( Horti -Ullrajectini index,
1 7 4 7 ) , divisant les plantes en phanéranthées
et cryptanthées , les premières en
polycotylédones et monocotyJédones, les
polycotylédones en quatre classes qui répondent
aux pétalées, aux coirsposées, aux
apétales et aux diclines, aurait, sans la
confusion trop fréquente des nu)no et polypétalées
qu'il a introduite, rencontré les
bases d'une classification assez philosophique
et généralement admise plus tard.
Mais ses subdivisions pour lesquelles il emploie
le plus souvent les caractères des étamines
empruntés au système de Linné ou
à celui de Haller, leur nombre absolu ou
relatif et leurs rapports entre elles, le conduisent
définitivement à des groupes sans
aucun lien naturel : e td'ai l leur s son système,
outre l'inconvénient de n'être appliqué qu'a
un nombre trop limité de plantes, eût été,
au premier abord , repoussé pour la bizarrerie
et la rudesse des mots nouveaux dont
il l'a hérissé, mots tels que scfieseostemonopetaloe
, cylindrobasiostemones , distemonopleantheroe,
etc., etc. C'était un essai, depuis
renouvelé avec aussi peu de succès, de
noms résumant chacun un ensemble de
c a r a c t è r e s , et destinés ainsi à aider la mémoire
qui y trouve au contraire un obstacle
plutôt qu'un secours.
Nous ne pousserons pas plus loin cette
revue qui ne nous montrerait, dans d'autres
essais contemporains ou postérieurs, que les
mêuies moyens de classification répétés, retournés,
combinés diversement, sans introduction
de caractères ou de principes nouveaux,
Ceux qui veulent s'en faire une idée
sommaire peuvent consulter la préface de
l'ouvrage d'Adanson intitulé Familles des
plantes (1763), dans laquelle il a exposé
toutes les classifications botaniques qui ont
précédé la sienne. Mais il se borne, en gé-
19
néral, à en présenter les divisions principal
e s , celles qui conduisent seulement jusqu'aux
classes, et à porter sur le mérite de
chacune un jugement qui naturellement se
fonde sur une comparaison avec la sienne
propre. Un autre ouvrage où l'on doit chercher
des documents bien p^us complets est
celui que Linné a publié sous le titre de
Classes platitarwn seu systemala omnia a
fractip,catione desumta, 1738, qui, nécessairement,
s'arrête à cette date antérieure,
niais qui présente, pour chaque système,
outre les divisions principales, les secondaires
avec l'énumératiou des genres. Or, c'est
seulement d'après celte association des genres
qu'un système peut êire bien jugé, et,
pour porter ce jugement, il faut un lecteur
auquel tous ces noms rappellent une idée
positive, auquel tous ces genres soient familiers.
Enfin nous citerons VHistoria rei
herbarioe de Sprengel qui, pour chaque époque,
oflre un chapitre relatif aux divers systèmes
botaniques qu'elle a produits, et les
résume par des analyses, courtes, exactes et
claires.
On confond assez généralement toutes les
classifications dont nous nous sommes occupés
jusqu'ici sous le nom de Systèmes artificiels,
pour les opposer aux classifications naturelles
dont nous avons à nous occuper maintenant.
Nous avons vu cependant que beaucoup
d'entre elles prétendaient à ce dernier titre,
et, si elles n'ont atteint le but, se le proposaient
en y marchant avec plus ou moins de
succès. Celui du système artificiel est la détermination
d'une plante quelconque inconnue;
son moyen, l'établissement d'un ordre
dans lequel toutes les plantes se trouvent
disposées en une suite de groupes subordonnés,
d'après des caractères faciles à
constater, tellement que, dans les recherches,
on se trouve conduit successivement
de Pun à l 'autre jusqu'au genre ou à l'espèce
qui est l'inconnue du problème. Plus cette
recherche est aisée et sûre, plus le système
convient à sa destination. Quoique celui de
Linné ait satisfait, sous ce rapport, la plupart
de ses successeurs qui l'adoptèrent plutôt
que d'en créer d'autres, quelques uns en ont
proposé de nouveaux, soit pour simplifier
encore phis la solution du problème, soit
pour l'aborder dans certaines conditions par-
Itculières. Ainsi une condition fréquente est
l'absonce des organes de la fructification sut
une plante, ou sur une fraction de plante
seulement garnie de ses feuilles. Un système
qui permettrait de la déterminer en cet étal
rendrait un vériiable service aux botanistes.
Sauvages le tenta, dans sâ Methodus foliorum,
1 7 5 1 , mais seulement pour les plantes de la
Plore de Montpellier, et se servit des difi'érences
signalées dans tous les livres élémentaires,
les divers degrés de simplicité ou de
composition des feuilles, leur position sur
la tige, leurs dimensions en divers sens, leur
nervation, leurs formes, etc. Mais, arrivé à
un certain point, il appelle les fleurs à son
secours et, dès lors, on ne conçoit pas bien
la raison du système et pourquoi, s'il ne
pouvait faire marcher la charrue sans boeufs,
il a jugé à propos de les atteler par derrière.
J . Lavy fut plus fidèle à remploi exclusif
des feuilles dans sa Phyllographie piémontaise
(1816), et n'admit les caractères de
l'inflorescence et de'la fleur que pour les
Graminées et Cypéracées, où, en effet, les
feuilles se ressemblent trop pour fournir des
différences. Ce qui peut paraître asnez singulier,
c'est que, dans les divisions principales
de son système, il n'ait égard qu'à la
forme. Un système foliaire serait bon, appliqué
à un nombre de plantes suffisamment
restreint , par exempl e aux arbres et arbustes
d'un pays; dans ces limites, avec les connaissances
actuelles et notamment celles
qu'on doit à la phyllotaxie, oti arriverait a
des déterminat ions certaines. Les applications
heureuses qu'on en a faites quelquefois à celle
des empreintes fossiles m fournissent la
preuve.
Dans notre siècle, le système artificiel
avouant franchement son but, qui est d'ar -
river au nom de la plante inconnue, semble
avoir adopté une certaine forme qui a reçu
le nom de Méthode dichotomique. Le procédé
consiste à réduire toujours la recherche à
Poption entre deux caractères, dont l'un
exclut l'autre, de telle sorte qu'à chaque
option le cercle se resserre et qu'on se trouve,
après une suite d'exclusions successives, conduit
à Punité (genre ou espèce) qu'on veut
connaître. Tantôt on procède sous forme de
questions, chacun renvoyant à un numéro
sous lequel se trouve posée une question nouvelle,
comme dans la Flore française de Lam
a rck ( 1 7 7 8 ) ; VHodegus botanic us de J s ' ira u
ftm