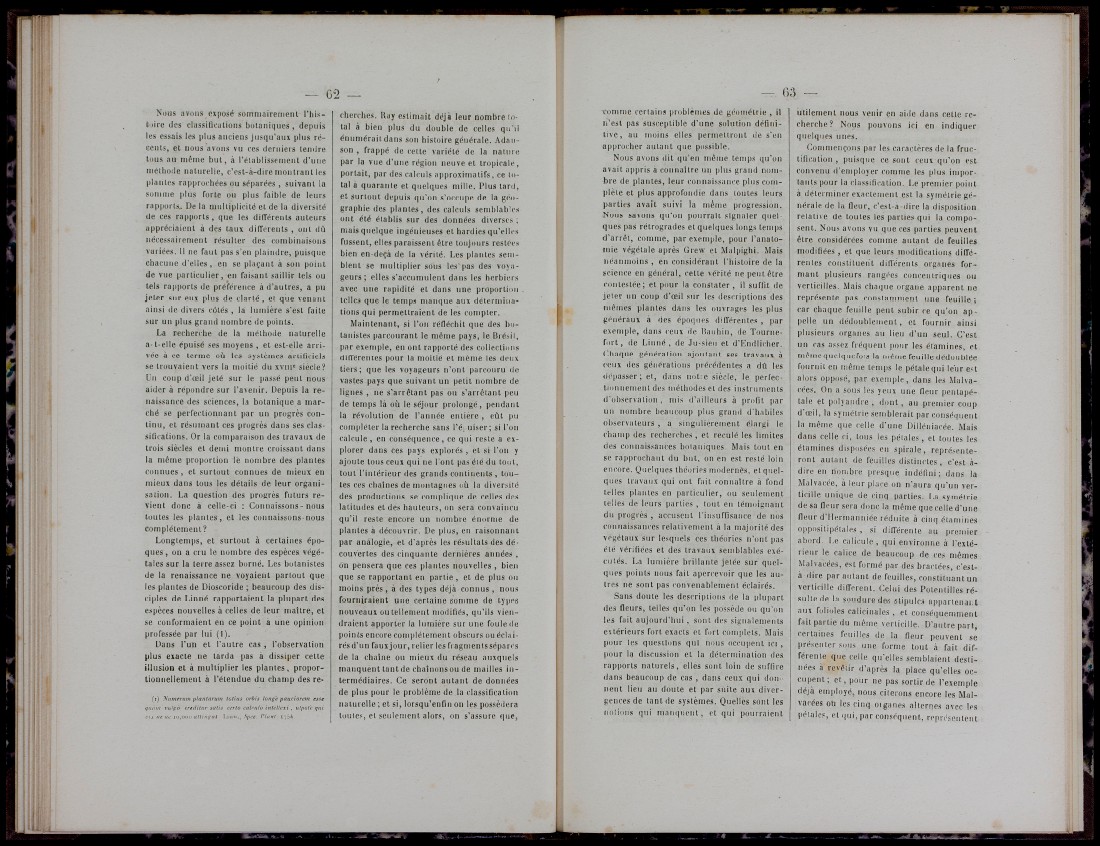
G 2 0 3
Nous avons exposé sornniaireriienl l'hisi
' t i r e des classificaLions botaniques, depuis
les essais les plus anciens jusqu'aux plus réc
e n t s , et nous avons vu ces derniers teniire
t o u s au même but, à rélabl issement d'une
ï u é t h o i l e naturelle, c'est-à-dire montrantles
p l a n t e s rapprochées ou séparées , suivant la
s o m m e plus Torte ou plus faible de leurs
r a p p o r t s . . De la multiplicité et de la diversité
d e ces rapports, que les diiiérenls auteurs
a p p r é c i a i e n t à des taux didcrents , ont dû
n é c e s s a i r e m e n t résulter des combinaisons
v a r i é e s . Il ne faut pas s'en plaindre, puisque
c h a c u n e d'elles, eu se plaçant à son point
d e vue particulier, en faisant saillir tels ou
t e l s rapports de préférence à d ' a u t r e s , a pu
j e t e r sur eux plus de clarté, et que venant
a i n s i de divers côtés , la lumière s'est faite
s u r un plus graïul nombr e de points.
La recherche de la méthotle naturelle
a - t - e l l e épuisé ses moyens , et est-elle arrivée
à ce ternie oii les systèmes artificiels
se trouvaient vers la moitié du xvui® siècle?
Un coup d'oeil jeté sur le passé peut nous
a i d e r à répondre sur l'avenir. Depuis la ren
a i s s a n c e des sciences, la botanique a marché
se perfectionnant par un progrès cont
i n u , et résumant ces progrès dans ses class
i f i c a t i o n s . Or la comparaison des travaux de
t r o i s siècles et demi montre croissant dans
la même proportion lé nombre des plantes
c o n n u e s , et surtout connues de mieux en
m i e u x dans tous les détails de leur organis
a t i o n . La question des progrès futurs rev
i e n t donc à celle-ci : Connaissons-nous
t o u t e s les plantes, et les connaissons-nous
c o m p l è t e m e n t ?
L o n g t e m p s , et surtout à certaines époq
u e s , on a cru le nombr e des espèces végét
a l e s sur la terre assez borné. Les botanistes
d e la renaissance ne voyaient partout que
les plantes de Dioscoride ; beaucoup des disciples
de Linné rapportaient la plupart des
espèces nouvelles à celles de leur maître, et
s e conformaient en ce point à une opinion
p r o f e s s é e par lui ( I ) .
Dans l'un et l'autre cas, l'observation
p l u s exacte ne tarda pas à dissiper cette
i l l u s i o n et à multiplier les plantes^ proport
i o n n e l l e m e n t à l'étendue du champ des re-
(t) TVitmerum piantaruni totius orbis longe paxiciorein esse
qiu'iii vu>f;ò creditur satis certo calcalo intellexi , ìitpofc qui
l'ij. eie ne nj,ooo atliiigat l.iim., .V/xr. Plant 1754
c h e r c h e s . Ray estimait déjà leur nombr e lotal
à bien plus du double de celles qu'il
é n u m é r a i t dans son histoire générale. Adanson
, frappé de cette variété de la nature
p a r la vue d'une région neuve et tropicale,
p o r t a i t , par des calculs approximat i fs, ce iota}
a qua r ant e et quelques mille. Plus tard,
e t surtout depuis qu'on s'occupe de la géog
r a p h i e des plantes, des calculs semblables
o n t été établis sur des données diverses ;
mais que lque ingénieuses et hardies qu'elles
f u s s e n t , elles paraissent être toujours restées
b i e n en-deçà de la vérité. Les plantes semb
l e n t se nuïltiplier sous les'[)as des voyag
e u r s ; elles s 'accumulent dans les herbiers
avec une rapidité et dans une proportion
t e l l e s que le temps manque aux déterminat
i o n s qui permettraient de les compter.
M a i n t e n a n t , si l'on réiléchit que des bot
a n i s t e s parcourant le m ême pays, le Brésil,
p a r exemple, en ont rapporté des collections
d i i î é r e n t e s pour la moitié et m ême les deux
t i e r s ; que les voyageurs n'ont parcouru de
v a s t e s pays que suivant un petit nombr e de
ligties , ne s^arrêtant pas ou s'arrêtant peu
d e temps là où le séjour prolongé, pendant
la révolution de l'année entière, eût pu
c o m p l é t e r la recherche sans Té; uiser ; si l'on
c a l c u l e , en conséquence, ce qui reste a exp
l o r e r dans ces pays explorés , et si l'on y
a j o u t e tous ceux qui ne l'ont pas été d u tout,
t o u t l'intérieur îles grands cont inent s , toutes
ces chaînes de montagnes où la diversité
des productions se compl ique de celles des
l a t i t u d e s et des hauteurs, on sera convaincu
q u ' i l reste encore un nombre énorme de
p l a n t e s à découvrir. De plus, en raisonnant
p a r analogie, et d'après les résul tat s des déc
o u v e r t e s des c inquant e dernières années ,
o n pensera que ces plantes nouvelles , bien
q u e se rappor tant en partie , et de plus ou
m o i n s près , à des types déjà connus , nous
f o u r n i r a i e n t une certaine somme de typt^s
n o u v e a u x ou tel lement modifiés, qu'ils viend
r a i e n t apporter la lumière sur une foule de
p o i n t s encore compl è t ement obscurs ou éclair
é s d ' u n f auxjour , rel ier les f r a gme n t s sépares
d e la chaîne ou mieux du réseau auxquels
m a n q u e n t tant de chaînonsou de mailles int
e r m é d i a i r e s . Ce seront autant de données
d e plus pour le problème de la classification
n a t u r e l l e ; e t si, lorsqu'enf i n on les possédera
t o u t e s , et seulement alors, on s'assure que.
c o m m e certains problèmes de géométrie , il
n ' e s t pas susceptible d'une solution définit
i v e , au moins elles permettront (ie s'en
a p p r o c h e r autant que possible.
Nous avons dit qu'en même temps qu'on
a v a i t appris à conna î t r e un plus grand nomb
r e de plantes, leur connaissance plus comp
l è t e et plus approfondie dans toutes leurs
p a r t i e s avait suivi la même progression.
Nous savons qu'on pourrait signaler quelq
u e s pas rétrogrades et que lque s longs tenips
d ' a r r ê t , comme, par exemple, pour l'anatom
i e végétale après Grew et Malpighi. Mais
n é a n m o i n s , en considérant l'histoire de la
s c i e n c e en général, cette vérité ne peut être
c o n t e s t é e ; et pour la constater, il suffit de
j e t e r un coup d'oeil sur les descriptions des
m ê m e s plantes dans les ouvrages les plus
g é n é r a u x à des époques diiTérentes , par
e x e m p l e , dans ceux de Hanhin, de Tournef
o r t , de Linné, de Ju>sieu et d'Endlicher.
(Chaque génération ajoutant ses travaux à
r e u x des générations précédentes a dû les
d é p a s s e r ; et, dans notîe siècle, le perfect
i o n n e m e n t des méthodes et des instruments
d ' o b s e r v a t i o n , mis d'ailleurs à profit par
u n nombre beaucoup plus grand d'habiles
o b s e r v a t e u r s , a singulièrement élargi le
c h a m p des recherches, et reculé les limites
des connaissances boianiqnes. Mais tout en
se rapprochant du but, on en est resté loin
e n c o r e . Quelques théories modernus , et quelq
u e s travaux qui ont fait connaître à fond
t e l l e s plantes en particulier, ou seulement
t e l l e s de leurs parties, tout en témoignant
d u progrès , accusent l'insuffisance de nos
c o n n a i s s a n c e s relativement à la majorité des
v é g é t a u x sur lesquels ces théories n'ont pas
é t é vérifiées et des travaux semblables exéc
u t é s . La lumière brillante jetée sur quelq
u e s points nous fait apercevoi r que les aut
r e s ne sont pas convenablement éclairés.
S a n s doute les descriptions de la plupart
des fleurs, telles qu'on les possède ou qu'on
l e s fait aujourd'hui , sont des signalements
e \ t é r i e u r s fort exacts et fort complets. Mais
p o u r les questions qui nous occupent ici ,
p o u r la discussion et la détermination des
r a p p o r t s naturels, elles sont loin de suffire
d a n s beaucoup de cas , dans ceux qui donn
e n t lieu au doute et par sùite aux diverg
e n c e s de tant de systèmes. Quelles sont les
n o l i o n s qui manquent, et qui pourraient
u t i l e m e n t nous venir en aide dans cette rec
h e r c h e ? Nous pouvons ici en indiquer
q u e l q u e s unes.
C o m m e n ç o n s par les caractères de la fruct
i f i c a t i o n , puisque ce sont ceux qu'on est
c o n v e n u d'employer comme les plus import
a n t s pour la classification. Le premier point
à déterminer exactement est la symétri e gén
é r a l e de la fleur, c'est-a-dire la disposition
r e l a t i v e de toutes les parties qui la compos
e n t . Nous avons vu que ces parties peuvent
ê t r e considérées comme autant de feuilles
m o d i f i é e s , et que leurs modifications différ
e n t e s constituent dillërents organes form
a n t plusieurs rangées concentriques ou
v e r t i c i l l e s . Mais chaque organe apparent ne
r e p r é s e n t e pas constamment une feuille;
car chaque feuille peut subir ce qu'on app
e l l e un dédoublement, et fournir ainsi
p l u s i e u r s organes au lieu d'un seul. C'est
u n cas assez fréquent pour les étamines, et
m ê m e q u e l q u e f o i s la niêriie feui l l e dédoublée
f o u r n i t en nsême temps le pétale qui leur est
a l o r s opposé, par exemple, dans les Malvacées.
On a sous les yeux une fleur pentapét
a l e et polyandre , dont , au premier coup
d ' oe i l , la symét r i e semblerai t par conséiïuent
la même que celle d'une Dilléniacée. Mais
d a n s celle ci, tous les péiales, et toutes les
é t a m i n e s disposées en spirale, repré.senter
o n t autant de feuilles distinctes, c'est àd
i r e en nombre presque indéfini; dans la
Malvacée, à leur piace on n'aura qu'un vert
i c i l l e unique de cinq parties. La symétrie
d e sa fleur sera donc la même quecelled'une
fleur d'Hermanniée réduite à cinq étamines
o p p o s i t i p é t a l e s , si différente au premier
a b o r d , [.e calicule , qui environne à l'extér
i e u r le calice de beaucoup de ces mêmes
Malvacées, est formé par des bractées, c'està
(lire par aut ant de feuilles, const i tuant un
v e r t i c i l l e different. Celui des Potentilles rés
u l t e de la soudure des stipules appartenaiit
aux folioles calicinales , et conséqueniment
f a i t par t i e du même verticille. D'autre part,
c e r t a i n e s feuilles de la fleur peuvent se
p r é s e n t e r sous une forme tout à fait diff
é r e n t e que celle qu'elles semblaient desti-^
nées à revêtir d'après la place qu'elles occ
u p e n t ; et , pour ne pas sortir de l'exemple
d é j à employé, nous citerons encore les Malvacées
ou les cinq oiganes alternes avec les
p é t a l e s , et qui , par conséquent , reprcscntent
4111^'