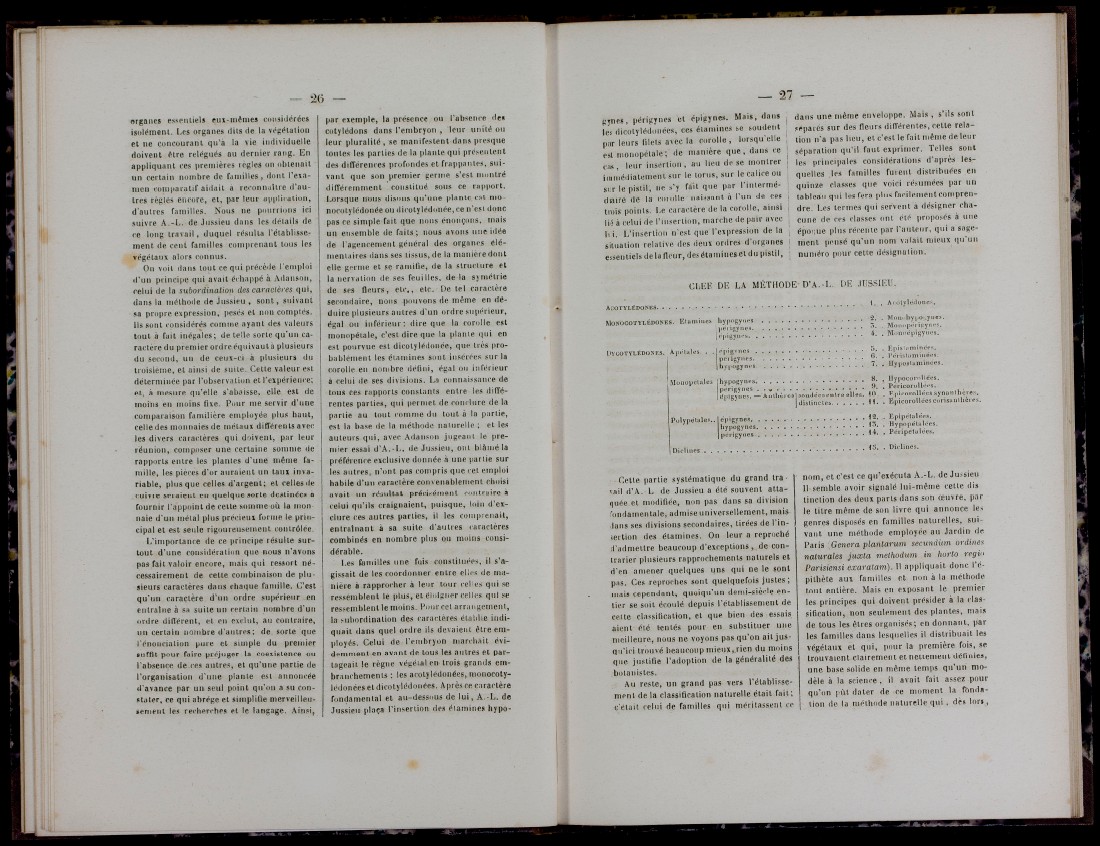
2(>
organes essentiels rux-inénies considérées
i s o l é m e n t . Les organes dits de la véjiétalion
e t ne concourant qu'a la vie individuelle
doivent ilie relégués au dernier rang. En
a p p l i q u a n t ces i)remières règles on obtenait
u n certain nombre de familles, dotit Texan
i e n coniiuiratif aidait à reconnaître d'aut
r e s règles encore, et, par leur application,
d ' a u t r e s familles. Nous ne pourrions ici
s u i v r e A.-L. de Jussieu dans les détails de
ce long travail, duquel résulta l'établissement
de cent familles comprenant tous les
végétaux alors connus.
On voit dans tout ce qui précède l'emploi
d ' u n principe (jui avait éch.'ippé à Adanson,
celui de la subordination des caractères qui,
dans la méthode de Jussieu , sont, suivant
sa propre expression, pesés et non comptés,
lis sont considérés comme ayant des valeurs
t o u t à fait inégales; de telle sorte qu'un car
a c t è r e du premier ordre équivaut à plusieurs
d u second, un de ceux-ci à plusieurs du
troisième» et ainsi de suite. Cette valeur est
d é t e r m i n é e par l'observation et l'expérience;
el, à mesure qu'elle s'abaisse, elle est de
moins en moins fixe. Pour me servir d'une
comparaison familière employée plus haut,
celle des monnaies de métaux différents avec
les divers caractères qui doivent, par leur
r é u n i o n , composer une certaine somme <ie
r a p p o r t s entre les plantes d'une même fam
i l l e , les pièces d'or auraient un taux invar
i a b l e , plus que celles d'argent ; et cellesde
c u i v r e seraient en quelquesorte destinées à
f o u r n i r l'appoint de cette somme où la mon
naie d'un nïéial plus précieux forme le principal
et est seule rigoureusement contrôlée.
L ' i m p o r t a n c e de ce principe résulte surt
o u t d'une considération que nous n'avons
pas fait valoi r encore, mais qui ressort néc
e s s a i r e m e n t de cette combinaison de plus
i e u r s caractères dans chaque famille. C'est
q u ' u n caractère d'un ordre supérieur en
e n t r a î n e à sa suite un ceriain nombre d'un
o r d r e différent, et en exclut, au contraire,
u n c e r t a i n nombre d'autres ; de sorte que
TénonciaLion pure et simple du premier
s u f f i t pour faire préjuger la coexistence ou
l ' a b s e n c e de ces autres, et qu'une partie de
l ' o r g a n i s a t i o n d'une plante est annoncée
d ' a v a n c e par un seul point qu'on a su cons
t a t e r , ce qui abrège et simplifie merveilleus
e m e n t les recherches et le langage. Ain.'tij
par exemple, la présence ou l'absence des
cotylédons dans l'embryon , leur unité ou
leur pluralité, se manifestent dans presque
t o u t e s les parties de la plante qui présentent
des différences profondes et frappantes, suiv
a n t que son premier germe s'est montré
d i f f é r e m m e n t constitué sous ce rapport.
Lorsque nous disons qu'une plante est mon
o c o t y l é d o n é e o u dicotylédonée,ce n'est donc
pas ce simpl e fait que nous énonçons, mais
u n ensemble de faits; nous avons une idée
d e l'agencement général des organes élém
e n t a i r e s dans ses tissus, de la mani è r e dont
elle ginine et se ramifie, de la structure et
la nervation de ses feuilles, de la symétrie
d e ses fleurs, etc., etc. De tel caractère
secondaire, nous pouvons de même en déd
u i r e plusieurs autres d'un ordre supérieur,
égal ou inférieur: dire que la corolle est
monopètale, c'est dire que la piaule qui en
est pourvue est dicotylédonée, que très prob
a b l e m e n t les étamines sont insérées sur la
corolle en nombre défini, égal ou inférieur
à celui de ses divisions. La connaissaiu*e de
tous ces rapports constants entre les différ
e n t e s parties, qui permet de conclure de la
p a r t i e au tout comme du tout à la partie,
est la base de la méthode naturelle ; et les
a u t e u r s qui, avec Adanson jugeant le premier
essai d'A.-L. de Jussieu, ont blâmé la
p r é f é r e n c e exclusive donnée à une partie sur
les autres, n'ont pas compris que cet emploi
habile d'uiï caractère convenableittent choisi
avait un résultat précisément contraire à
celui qu'ils craignaient, puisque, loin d'exc
l u r e ces autres parties, il les comprenait,
e n t r a î n a n t à sa suite d'autres caractères
combinés en nombre plus ou moins consid
é r a b l e .
Les familles une fuis constituées, il s'agissait
de les coordonner entre elles de man
i è r e à rapprocher à leur tour celles qui se
r e s s e m b l e n t le plus, et éloigner celles qui se
r e s s e m b l e n t le moins . Pourcet arrangement,
la Mihordination des caractères établie indiq
u a i t dans quel ordre ils devaient être employés.
Celui de l'embryon marchait évid
e m m e n t en avant de tous les aut res et partageait
le règne végétal en trois grands emb
r a n c h e m e n t s : les acotylédonées, monocotyl
é d o n é e s e t d i c o t y l é d o n é e s . Aprèscec;iractère
f o n d a m e n t a l et au-dessous de lui, A.-L. de
J u s s i e u plaça l'inseriion des éiamines hypo-
27
g y n e s , périgynes et épigynes. Mais, dans
les dicotylédonées, ces éumine s se soudent
par leurs filets avec la corolle, lorsqu'elle
est monopétale; de manière que, dans ce
c a s , leur insertion, au lieu de se montrer
iuHuédiatement sur le torus, sur le calice ou
sur le pistil, ne s'y fait que par l'interméd
i a i r e de la corolle naissant à l'un de ces
trois points. I.e caractère de la corolle, ainsi
lié à celui de l'insertion, marche de pair avec
Ini. L'insertion n'est que l'expression de la
s i t u a t i o n relative des deux ordres d'organes
essentiels de la f leur , des é t ami n e s et du pistil,
dans une uiême enveloppe. Mais , s'ils sont
sépares sur des fleurs dilTérentes, cette relation
n'a pas lieu, et c'est le fait m ême de leur
s é p a r a t i o n qu'il faut exprimer. Telles sont
les principales considérations d'après lesq
u e l l e s les familles fuient distribuées en
q u i n z e classes que voici résumées par un
t a b l e a u qui les fera plus faci lement comprend
r e . Les termes qui servent a désigner chac
u n e de ces classes ont été proposés à une
époque plus récente par l 'auteur, qui a sagem
e n t pcïisé qu'un nom valait mieux qu'un
n u m é r o pour cette désignation.
CLEF DE LA MÉTHODE D'A.-L. DE JiJSSlEU.
1. . AcotyledoMcs.
4. . Miinitepigyiies.
UYCOTYLÉDONES. • Apf'iules. . .
Muao^éUiles
Polypélales..
Diclines . .
j.erigyi
d[,igyu.'s.
rpigvncs . - • EpisUimince.s.
pe.i.y..es • l'ér.slamme.s.
hYPOgyn.s . Hyposl.minues.
hy.po^ynes • Hypocornlle.s
pLlgynes ^ • PencoruUo.-s.
é|)igynes. — Anthères s ô u d é e s e n l r e elles. 10. . Epicorollécs synanthère.s.
d i s t i n c l e b H. . Epicorolleescorisanlheies.
. Epipeto e.s.
hypogynes • Hypopetaloes.
perigynes • P^^np^talees.
15. . DicUnes.
C e t t e partie systématique du grand travail
d'A. L de Jussieu a été souvent attaquée
et modifiée, non pas dans sa division
f o n d a m e n t a l e , admise univer sel lement , mais^
d a n s ses divisions secondaires, tirées de l'ins
e r t i o n des étamines. On leur a reproché
d ' a d m e t t r e beaucoup d'exceptions, de cont
r a r i e r plusieurs rapprochement s naturels et
d ' e n amener quelques uns qui ne le sont
pas. Ces reproches sont quelquefois justes ;
mais cependant, quoiqu'un demi-siècle ent
i e r se soit écoulé depuis l'établissement de
c e t t e classification, et que bien des essais
a i e n t été tentés pour en substituer une
m e i l l e u r e , nous ne voyons pas qu'on ait jusq
u ' i c i trouvé beaucoup mieux, rien du moins
q u e justifie l'adoption de la généralit é des
b o t a n i s t e s .
Au reste, un grand pas vers l'établissem
e n t de la classification naturelle était fait;
c ' é t a i t celui de familles qui méritassent ce
nom, et c'est ce qu'exécut a A.-L. de Ju?sieu
Il semble avoir signalé lui-même cette dis
t i n c t i o n des deux parts dans son oeuvre, par
le titre même de son livre qui annonce les
genres disposés en familles naturelles, suiv
a n t une méthode employée au Jardin de
Paris [Genera plantarum secundum ordines
naluraîes juxta meihodum in horto regii^
Parisiensi exaralam). 11 a p p l i q u a i t donc l'ép
i t h è t e aux familles et non à la méthode
t o u t entière. Mais en exposant le premier
les principes qui doivent présider à la class
i f i c a t i o n , non seulement des plantes, mais
d e tous les êtres organisés; en donnant , par
les familles dans lesquelles il distribuait les
végétaux et qui, pour la première fois, se
t r o u v a i e n t clairement et n e t t ement définies,
u n e base solide en même temps qu'un modèle
à la science, il avait fait assez pour
q u ' o n put dater de ce moment la fondat
i on de la méthode naturelle qui , dès lor$,
• 'T'
J J l