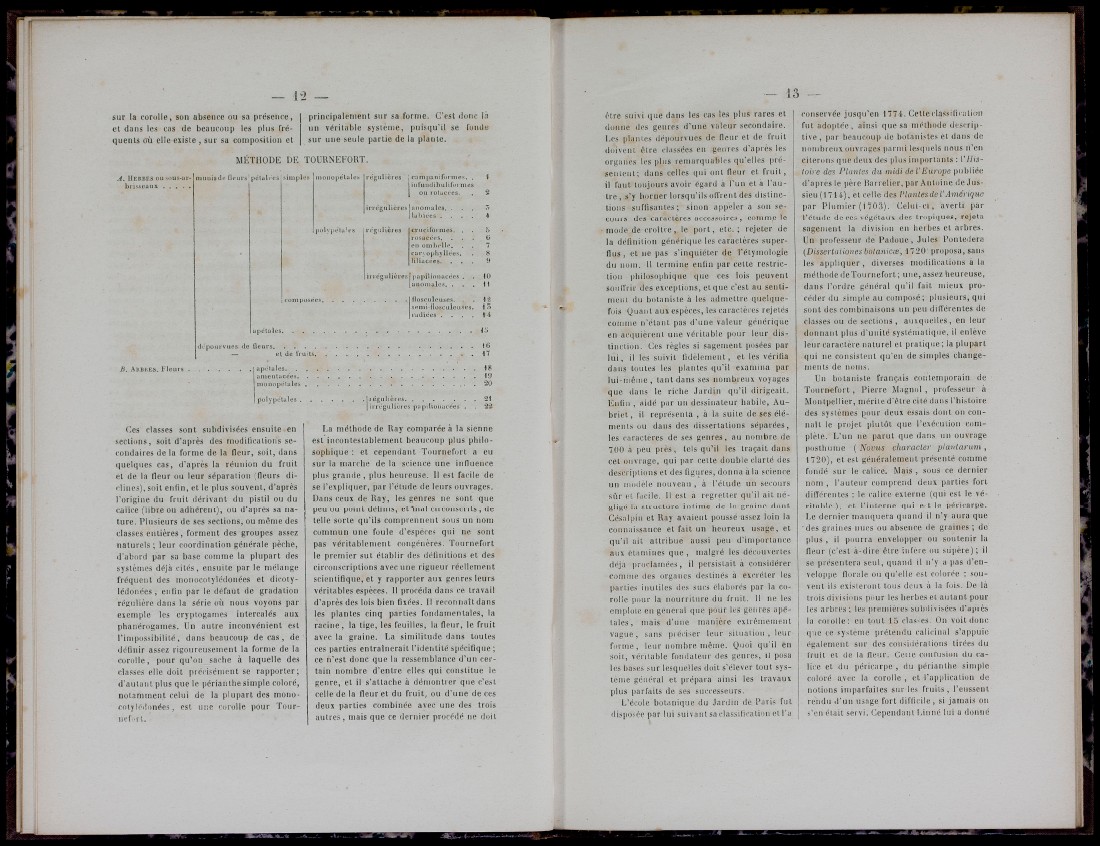
1 2 — 13
s u r la eorolie, son absence ou sa présence,
e t dans les cas de beaucoup les plus fréq
u e n t s où elle existe , sur sa composition et
p r i n c i p a l e m e n t sur sa forme. C'est ¡ionc
u n véritable système, puisqu'il se iuude
s u r une seule partie de la plante.
MÉTHODE DE TOURNEFORT.
A . HERBF.S on áous-ítrbrisseuiix
nuiuisde flours'pétalt'cs sinipies nionopelules régulières campaniformes. .
infundibulifoj nies
ou rolucces.
polypoUi'i^s
irrégiilières
régulières
irrdguJières
anomales. .
labiees .
Griiciiornies. .
rosacees.
en onil)elie.
car\ ophyllées.
liliiicees. . .
jiapiliniuicees .
auomuies. .
1
2
5
4
0
7
8
9
10
11
compasees. ílosculeu:áes. . .
senii-ílosculeuses. 15
l'iidie'es . . . . 14
a pel
dí'poiirvues de fleurs^
— el de fruits.
B. Aubbes. Fleurs . . . apc'Iaies
amentacees
monopélales
pülypL'laÍes .
Ces classes sont subdivisées ensuite en
s e c t i o n s , soit d'après des modifications sec
o n d a i r e s de la forme de la fleur, soit, dans
«luelques cas, d'après la réunion du fruit
e t de la fleur ou leur séparation {fleurs dic
l i n e s ) , soit enfin, et le plus souvent , d'après
l ' o r i g i n e du fruit dérivant du pistil ou du
calice (libre ou adhérent), ou d'après sa nat
u r e . Plusieurs de ses sections, ou même des
classes entières, forment des groupes assez
n a t u r e l s ; leur coordination générale pèche,
d ' a b o r d par sa base comme la plupart des
systèmes déjà cités, ensuite par le mélange
f r é q u e n t des monocotylédonées et dicoiyl
é d o n é e s , enfin par le défaut de gradation
r é g u l i è r e dans la série où nous voyons par
e x e m p l e les cryptogames intercalés aux
p h a n é r o g a m e s . Un autre inconvénient est
TimpossibiliLé, dans beaucoup de cas, de
d é f i n i r assez rigoureusement la forme de la
c o r o t i e , pour qu'on sache à laquelle des
classes elle doit précisénient se rapporter;
d ' a u t a n t plus que le périanthe s impl e coloré,
n o t a m m e n t celui de la plupart des monoc
o t y l é d o n é e s . est une ctirolle pour Tourn
e i - i l.
17
18
le'gulières
irrcguliùres pupiUonacees . . 22
La méthode de Ray comparée à la sienne
est iucontestableuient beaucoup plus philos
o p l i i i j u e : et cependant Tournefort a eu
s u r la marche de la science une influence
plus g rande, plus heureuse. Il est facile de
s e l 'expliquer, par l'étude de leurs ouvrages.
Dans ceux de Ray, les genres ne sont que
peu ou point définis, et "ïnal circonscrits , de
t e l l e sorte qu'ils comprennent sous u n nom
c o m m u n une foule d'espèces qui ne sont
pas véritablement congénères. Tournefort
le premier sut établir des définitions et des
c i r c o n s c r i p t i o n s avec une rigueur réellement
s c i e n t i f i q u e , et y rapporter aux genres leurs
v é r i t a b l e s espèces. Il procéda dans ce travail
d ' a p r è s des lois bien fixées. Il reconnaît dans
les plantes cinq parties fondamentales, la
r a c i n e , la tige, les feuilles, la fleur, le fruit
avec la graine. La similitude dans toutes
ces parties entraînerait l'identité spécifique ;
ce n'est donc que la ressemblance d'un cert
a i n nombre d'entre elles qui constitue le
g e n r e , et il s'attache à démontrer que c'est
celle de la fleur et du fruit, ou d'une de ces
deux parties combinée avec une des trois
a u t r e s , mais que ce dernier procédé ne doit
^ t r e suivi que dans les cas les plus rares et
d o n n e des genres d'une valeur secondaire.
Les pliuiies dépourvues de ficur et de fruit
d o i v e n t ótre classées eu genres d'après les
o r g a n e s les plus remarquables qu'elles [)rés
e n i e n t ; dans celles qui ont fleur et fruit,
il faut toujours avoir égard à l'un e t à l'aut
r e , s'y borner lorsqu'ils ofl'rent des distinctions
suffisantes; sinon appeler à son secours
des caractères accessoires, comme le
mode de croî tre, le port, etc.; rejeter de
la définition générique les caractères superflus
^ et ne pas s'inquiéter de Fétymologie
d u nom. Il termine enfin par cette restriction
philosophique que ces lois peuvent
s o u í í r i r des exceptions, et q u e c'est au sentiment,
du botaniste à les admettre quelquefuis
Quant aux espèces, les caractères rejetés
cornine n'étant pas d 'une valeur générique
en acquièrent une véritable pour leur dist
i n c t i o n . Ces règles si sagement posées par
l u i , i! les suivit fidèlement, et les vérifia
d a n s toutes les plantes qu'il examina par
l u i - m ê m e , tant dans ses nombreux voyages
q u e dans le riche Jardin qu'il dirigeait.
E n f i n , aidé par un dessinateur habile, Aub
r i e t , il représenta , à la suite de ses élém
e n t s ou dans des dissertations séparées,
les caractères de ses genres, au nombre de
7 0 0 à peu près, tels qu'il les traçait dans
cet ouvrage, qui par cette double clarté des
d e s c r i p t i o n s et des figures, donna ài a science
u n i!u)(ièle nouveau , à l'étude un secours
s û r et facile, il est à regretter qu^il ait négligé
la structure intime de la graine dont
Gésalpin et Ray avaient poussé assez loin la
c o n n a i s s a n c e et fait un heureux usage, et
q u ' i l ait attribué aussi peu d'importance
aux étamines que, malgré les découvertes
déjà j)roclamées, il persistait à considérer
c o i ï u n e des organes destinés à excréter les
p a r t i e s inutiles des sucs élaborés par la corolle
pour la nourriture du iruit. 11 ne les
cm[)loie eu général que pour les genres apét
a l e s , mais d'une manière extrêmement
v a g u e , sans préciser leur situalion , leur
f o r m e , leur nombre même. Quoi qu'il en
s o i t , véritable fondateur des genres, il posa
les bases sur lesquelles doit s'élever tout syst
è m e général et prépara ainsi les travaux
plus parfaits de ses successeurs.
L'école botanique du Jardin de l^aris fut
disposée par lui suivantsa classification et l'a
conservée jusqu'en 1774. Getleclassiiicalifrn
f u t adoptée, ainsi que sa méthode descriptive
, par beaucoup de botanistes et dans do
n o m b r e u x o u v n i g e s parmi les(|uels nous n'en
c i t e r o n s que deux des plus impor tant s : Vliisloh'e
des Plantes du midi de l'Europe publiée
d ' a p r è s le père Rarrel ier, par Antoine de Jussieu
(1714) , et celle des Plantes de l'Amérique
p a r Plumier (1703). Celui-ci, averti par
l ' é t u d e de ces végétaux des tropiques, rejeta
s a g e m e n t la division en herbes et arbres.
Un professeur de Padoue, Jules Pontedera
{Dissertationes bolanicoe, 1720' proposa, sans
les appliquer, diverses modifications à la
m é t h o d e d eTourne for t ; une, assez heureuse,
d a n s l'ordre général qu'il fait mieux procéder
du simple au composé; plusieurs, qui
s o n t des combinaisons un peu dilTérentes de
classes ou de sections, auxquelles, en leur
d o n n a n t plus d'uni t é systérnatique, il enlève
l e u r caractère naturel et pratique ; la plupart
qui ne consistent qu'en desimpies changem
e n t s de noms.
Un botaniste français contemporain de
T o u r n e f o r t , Pierre M;ignol , professeur à
M o n t p e l l i e r , méri t e d 'êt r e cité dans l'histoire
des systèmes pour deux essais dotit on conn
a î t le projet plutôt que l'exécution comp
l è t e . L'un ne parut que dans un ouvrage
p o s t h u m e { Novus characler planiaruni,
1 7 2 0 ) , et est généralement présenté comme
f o n d é sur le calice. Mais, sous ce dernier
n om , l'auteur comprend deux parties fort
diiTcrentes : le calice externe (qui est le vér
i t a b l e ) , et l'interne qui e:tle péricarpe.
Le dernier maïujuera quand il n'y aura que
' d e s graines nues ou absence de graines ; de
p l u s , il pourra envelopper ou soutenir la
fleur (c'est à-dire être iniére ou siipère); il
se présentera seul, quand il n'y a pas d'enveloppe
florfile ou qu'elle est colorée : souvent
ils existeront tous deux à la fois. De là
t r o i s divisions pour les herbes et aut ant pour
les a rbres; les premières subdivisées d'après
la corolle: eu tout I b classes. On voit donc
q-ic ce système prétendu caliciual s'aiipuie
é g a l e m e n t sur des considérations tirées du
f r u i t et de la fleur. Cette confusion du calice
et du péricarpe , du périanthe simple
coloré a.vec la corolle , et l'application de
n o t i o n s imparfaites sur les fruits, l'eussent
r e n d u d'un usage fort difficile, si jamai s on
s ' e n était servi. Cependant Linné lui a donné
mm