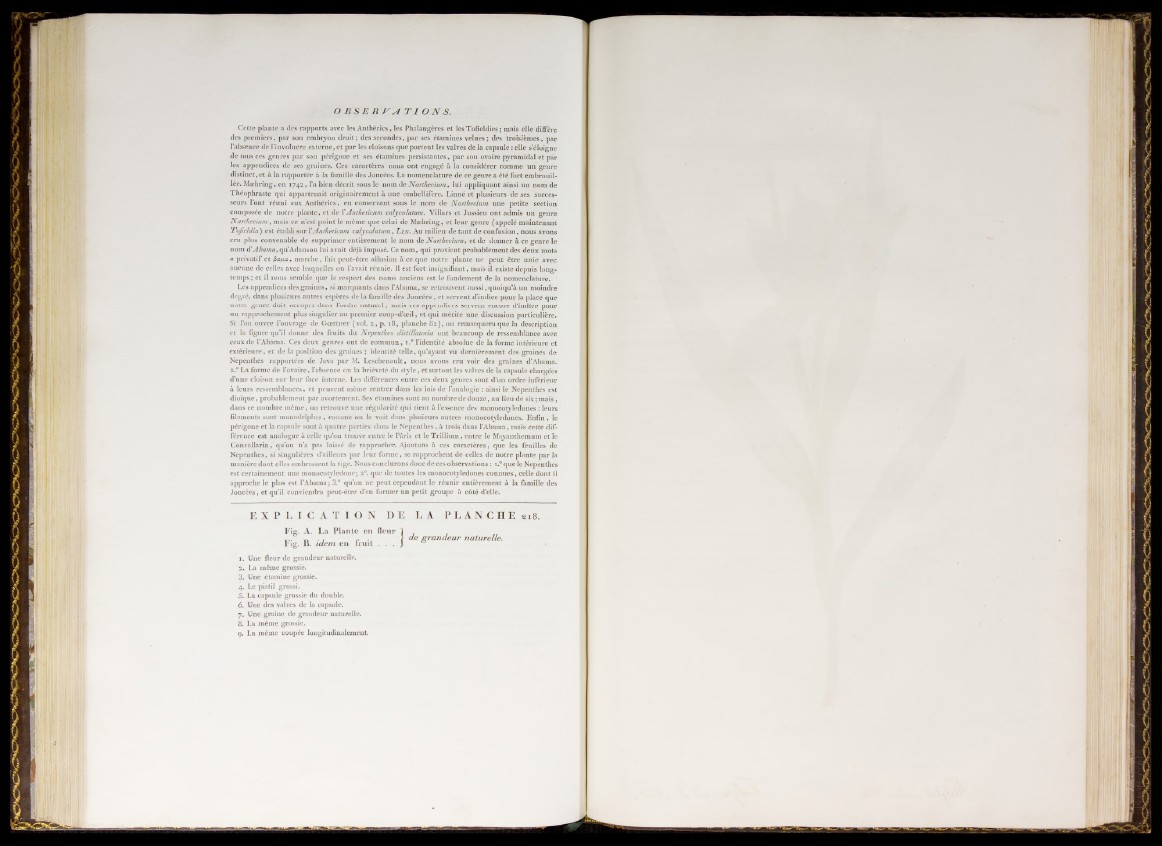
Cette plante a des rapports avec les Anthérics, les Phalangères et les Tofieldies ; mais elle diffère
des premiers, par son embryon droit; des secondes, par ses étamines velues; des troisièmes, par
l’absence de l’involucre externe, et par les cloisons que portent les valves de la capsule : elle s’éloigne
de tous ces genres par son périgone et ses étamines persistantes, par son ovaire pyramidal et par
les appendices de ses graines. Ces caractères nous ont engagé à la considérer comme un genre
distinct, et à la rapporter à la famille des Joncées. La nomenclature de ce genre a été fort embrouillée.
Mæhring, en 1742, l’a bien décrit sous le nom de Narthecium, lui appliquant ainsi un nom de
Théophraste qui appartenait originairement à une ombellifère. Linné et plusieurs de ses successeurs
l’ont réuni aux Anthérics, en conservant sous le nom de Narthecium une petite section
composée de notre plante, et de l’Anthericum calyculatum. Villars et Jussieu ont admis un genre
Narthecium, mais ce n’est point le même que celui de Mæhring, et leur genre (appelé maintenant
Tofieldia) est établi sur l’Anthericum calyculatum, L in . Au milieu de tant de confusion, nous avons
cru plus convenable de supprimer entièrement le nom de Narthecium, et de donner à ce genre le
nom à'Abama, qu’Adanson lui avait déjà imposé. Ce nom, qui provient probablement des deux mots
a. privatif et /Sa^a, marche, fait peut-être allusion à ce que notre plante ne peut être unie avec
aucune de celles avec lesquelles ou l’avait réunie. Il est fort insignifiant, mais il existe depuis longtemps
; et il nous semble que le respect des noms anciens est le fondement de la nomenclature.
Les appendices des graines, si marquants dans l'Abama, se retrouvent aussi, quoiqu’à un moindre
degré, dans plusieurs autres espèces de la famille des Joncées, et servent d’indice pour la place que
notre genre doit occuper dans l’ordre naturel ; mais ces appendices servent encore d’indice pour
un rapprochement plus singulier au premier coup-d’oeil, et qui mérite une discussion particulière.
Si l’on ouvre l’ouvrage de Goertner (vol. 2, p. 18, planche 82), on remarquera que la description
et la figure qu'il donne des fruits du Nepenthes distillatoria ont beaucoup de ressemblance avec
ceux de l’Abama. Ces deux genres ont de commun, i.° l’identité absolue de la forme intérieure et
extérieure, et de la position des graines ; identité telle,qu’ayant vu dernièrement des graines de
Nepenthes rapportées de Java par M. Leschenault, nous avons cru voir des graines d’Abama.
2.0 La forme de l’ovaire, l’absence ou la brièveté du style, et surtout les valves de la capsule chargées
d’une cloison sur leur face interne. Les différences entre ces deux genres sont d’un ordre inférieur
à leurs ressemblances, et peuvent même rentrer dans les lois de l'analogie : ainsi le Nepenthes est
dioïque, probablement par avortement. -Ses étamines sont au nombre de douze, au lieu de six ; mais,
dans ce nombre même, ou retrouve une régularité qui tient à l’essence des monocotyledones : leurs
filaments sont monadelphes, comme on le voit dans plusieurs autres monocotyledones. Enfin, le
périgone et la capsule sont à quatre parties dans le Nepenthes, à trois dans l’Abama, mais cette différence
est analogue à celle qu’on trouve entre le Paris et le Trillium, entre le Mayanthemum et le
Convallaria, qu’on n’a pas laissé de rapprocher. Ajoutons à ces caractères, que les feuilles de
Nepenthes, si singulières d’ailleurs par leur forme, se rapprochent de celles de notre plante par la
manière dont elles embrassent la tige. Nous conclurons donc de ces observations : i.° que le Nepenthes
est certainement une monocotyledone; 20. que de toutes les monocotyledones connues, celle dont il
approche le plus est l’Abama; 3.° qü’on ne peut cependant le réunir entièrement à la famille des
Joncées, et qu’il conviendra peut-être d’en former un petit groupe à côté d’elle.
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E 218.
Fig. A. v-,. 1, L. »a Plantep en fleur )\ de grandeur naturelle. Fig. B. idem en iruit . . . J 0
1. Une fleur de grandeur naturelle.
2. La même grossie.
3. Une étamine grossie.
4. Le pistil grossi.
5. La capsule grossie du double.
6. Une des valves de la capsule.
7. Une graine de grandeur naturelle.
8. La même grossie.
9. La même coupée longitudinalement.