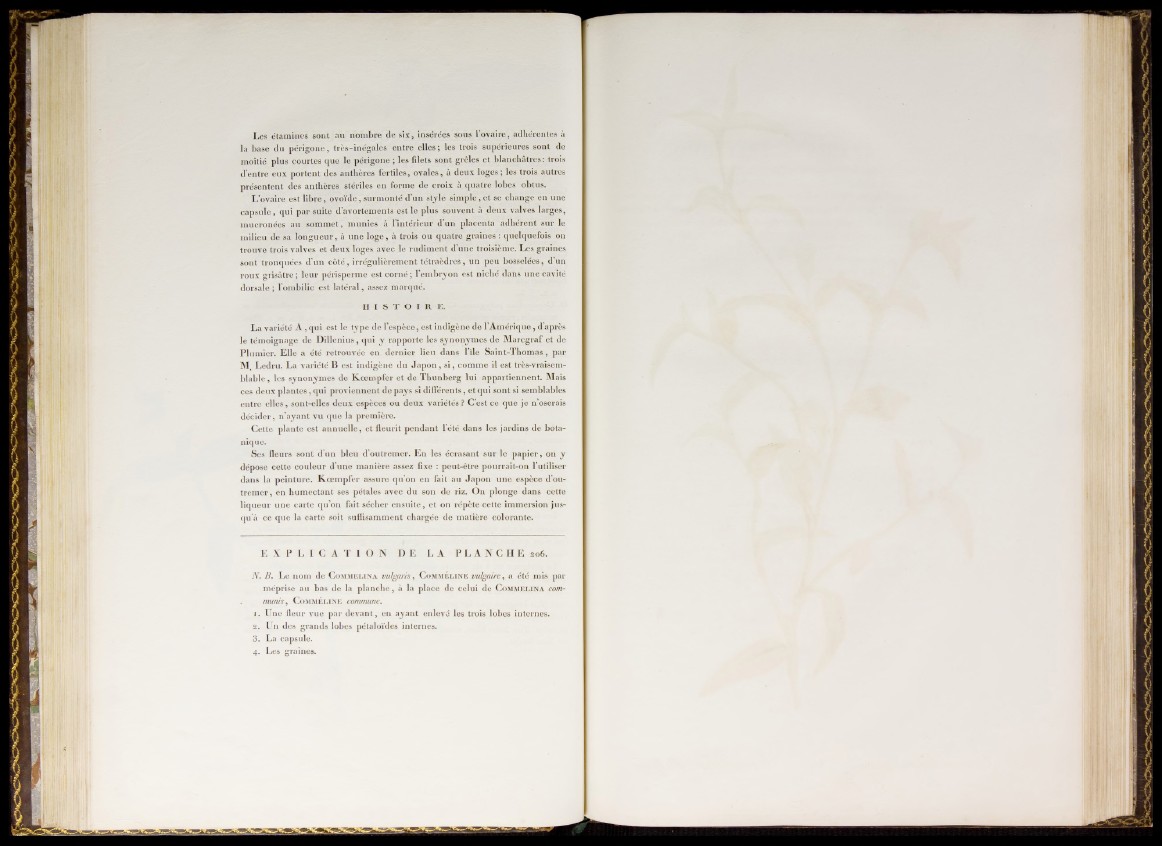
Les étamines sont au nombre de six, insérées sous l’ovaire, adhérentes à
la base du périgone, très-inégales entre elles; les trois supérieures sont de
moitié plus courtes que le périgone ; les filets sont grêles et blanchâtres: trois
d’entre eux portent des anthères fertiles, ovales, à deux loges; les trois autres
présentent des anthères stériles en forme de croix à quatre lobes obtus.
L ’ovaire est libre, ovoïde, surmonté d’un stylé simple, et se change en une
capsule, qui par suite d’avortements est le plus souvent à deux valves larges,
mucronées au sommet, munies à l’intérieur d’un placenta adhérent sur le
milieu de sa longueur, à une loge, à trois ou quatre graines : quelquefois on
trouve trois valves et deux loges avec le rudiment d’une troisième. Les graines
sont tronquées d’un côté, irrégulièrement tétraèdres, un peu bosselées, d’un
roux grisâtre ; leur périsperme est corné ; l’embryon est niché dans une cavité
dorsale ; l’ombilic est latéral, assez marqué.
H I S T O I R E .
La variété A , qui est le type de l’espèce, est indigène de l’Amérique, d’après
le témoignage de Dillenius, qui y rapporte les synonymes de Marcgraf et de
Plumier. Elle a été retrouvée en dernier lieu dans l’île Saint-Thomas, par
M. Ledru. La variété B est indigène du Japon, s i, comme il est très-vraisemblable
, les synonymes de Koempfer et de Thunberg lui appartiennent. Mais
ces deux plantes, qui proviennent de pays si différents, et qui sont si semblables
entre elles, sont-elles deux espèces ou deux variétés ? C’est ce que je n’oserais
décider, n’ayant vu que la première.
Cette plante est annuelle, et fleurit pendant l’été dans les jardins de botanique.
Ses fleurs sont d’un bleu d’outremer. En les écrasant sur le papier, on y
dépose cette couleur d’une manière assez fixe : peut-être pourrait-on l’utiliser
dans la peinture. Koempfer assure qu’on en fait au Japon une espèce d’outremer,
en humectant ses pétales avec du son de riz. On plonge dans cette
liqueur une carte qu’on fait sécher ensuite, et on répète cette immersion jusqu’à
ce que la carte soit suffisamment chargée de matière colorante.
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E 206.
N. B. Le nom de C om m e lin a vulgaris, C om m É lin e vulgaire, a été mis par
méprise au bas de la planche, à la place de celui de C om m e lin a commuais
^ C om m É lin e commune.
1. Une fleur vue par devant, en ayant enlevé les trois lobes internes.
2. Un des grands lobes pétaloïdes internes.
3. La capsule.