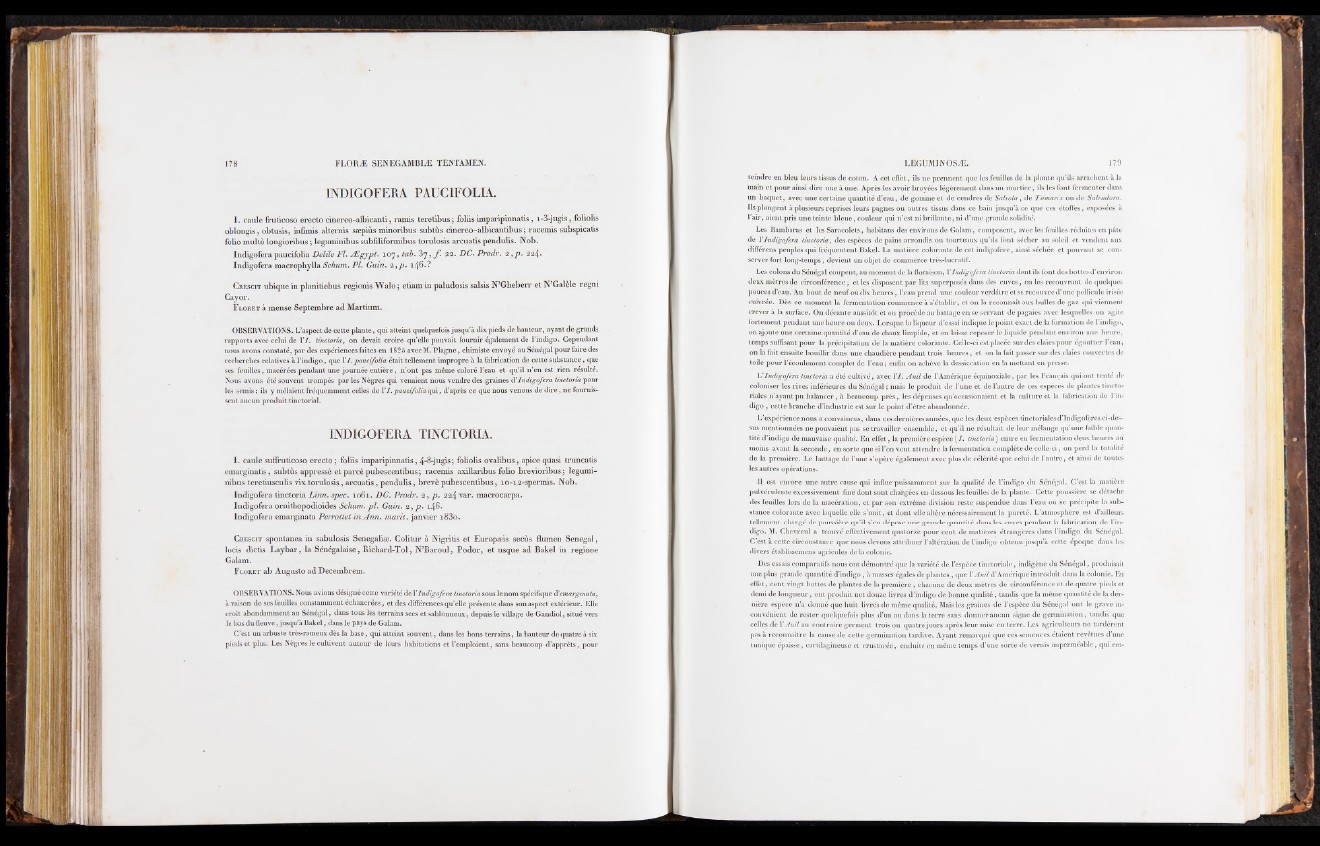
INDIGOFERA PAUCIFOLIA.
I. caule fi'uticoso erecto cinereo-albicanti, ramis teretibus; foliis imparipinnatis, i- 3-jugis, foliolis
oblongis, obtusis, infimis alternis sæpiùs minoribus subtùs cinereo-albicantibus ; racemis subspicatis
folio m ultô longioribus ; leguminibus subfîliformibus torulosis arcuatis pendulis. N ob.
Indigofera paucifolia Delile F l. Æ g y p t. 107 , tàb. Z'], f 22. D C . P rodr. 2 ,p . 224*
Indigofera macrophylla Schum . P l. G uin. 2 , p . 146.?
Crescit ubiqrie in planitiebus regionis W alo ; etiam in paludosis saisis N ’Gheberr et N ’Galèle regni
Cayor.
Floret à mense Septembre ad Martium.
OBSERVATIONS. L’aspect de cette plante, qui atteint quelquefois jusqu’à dix pieds de hauteur, ayant de grands
rapports avec celui de 1’/. tinctoria, on devait croire qu’elle pouvait fournir également de l’indigo. Cependant
nous avons constaté, par des expériences faites en 1825 avecM. Plagne, chimiste envoyé au Sénégal pour faire des
recherches relatives à l’indigo, que XI. paucifolia était tellement impropre à la fabrication de cette substance, que
ses feuilles, macérées pendant une journée entière, n’ont pas même coloré l’eau et qu’il n’en est rien résulté.
Nous avons été souvent trompés par les Nègres qui venaient nous vendre des graines d'Indigofera tinctoria pour
les semis ; ils y mêlaient fréquemment celles de XI. paucifolia qui, d’après ce que nous venons de dire, ne fournissent
aucun produit tinctorial.
INDIGOFERA TINCTORIA.
I. caule sufïruticoso erecto; foliis imparipinnatis, 4-8-jugis; foliolis ovalibus, apice quasi truncatis
emarginatis, subtùs appressè et parcè pubescentibus; racemis axillaribus folio brevioribus; leguminibus
teretiusculis vix torulosis, arcuatis, pendulis, brevè pubescentibus, 10-12-spermis. N ob.
Indigofera tinctoria L in n . spec. 1061. D C . Prodr. 2 , p . 224 var. macrocarpa.
Indigofera ornithopodioides Schum . p l. Guin. 2 , p . 146.
Indigofera emarginata Perrottet in A n n . m a rit. janvier i 83ô.
Crescit spontanea in sabulosis Senegaliæ. Colitur à Nigritis et Europæis secùs flumen Sénégal,
locis dictis L aybar, la Sénégalaise, Richard-Tol, N ’B aroul, Podor, et usque ad Bakel in regione
Galam.
F loret ab Augusto ad Decembrem.
OBSERVATIONS. Nous avions désigné cette variété de X Indigofera tinctoria sous le nom spécifique d’emarginata,
à raison de ses feuilles constamment échancrées, et des différences qu’elle présente dans son aspect extérieur. Elle
croît abondamment au Sénégal, dans tous les terrains secs et sablonneux, depuis le village de Gandiol, situé vers
le bas du fleuve, jusqu’à Bakel, dans le pays de Galam.
C’est un arbuste très-rameux dès la base, qui atteint souvent, dans les bons terrains, la hauteur de quatre à six
pieds et plus. Les Nègres le cultivent autour de leurs habitations et l’emploient, sans beaucoup d’apprêts , pour
teindre en bleu leurs tissus de coton. A cet effet, ils ne prennent que les feuilles dé la plante qu’ils arrachent à la
main et pour ainsi dire une à une. Après les avoir broyées légèrement dans un mortier, ils les font fermenter dans
un baquet, avec une certaine quantité d’eau, de gomme et de cendres de Salsola , de Tamarix ou de Salvadora.
Ils plongent à plusieurs reprises leurs pagnes ou autres tissus dans ce bain jusqu’à ce que ces étoffes, exposées à
l’air, aient pris une teinte bleue, couleur qui n’est ni brillante, ni d’une grande solidité.
Les Bambaras et les Saracolets, habitans des environs de Galam, composent, avec les feuilles réduites en pâte
de XIndigofera tincloria, des espèces de pains arrondis ou tourteaux qu’ils font sécher au soleil et vendent aux
différons peuples qui fréquentent Bakel. La matière colorante de cet indigofère, ainsi séchée et pouvant se conserver
fort long-temps, devient un objet de commerce très-lucratif.
Les colons du Sénégal coupent, au moment de la floraison, XIndigofera tinctoria dont ils font des bottes d’environ
deux mètres de circonférence ; et les disposent par lits superposés dans des cuves, en les recouvrant de quelques
pouces d’eau. Au bout de neuf ou dix heures, l’eau prend une couleur verdâtre et se recouvre d’une pellicule irisée
cuivrée. Dès ce moment la fermentation commence à s’établir, et on la reconnaît aux bulles de gaz qui viennent
crever à la surface. On décante aussitôt et on procède au battage en se- servant de pagaies avec lesquelles on agite
fortement pendant une heure ou deux. Lorsque la liqueur d’essai indique le point exact de la formation de l’indigo,
on ajoùte une certaine quantité d’eau de chaux limpide, et on laisse reposfer le liquide pendant environ une heure,
temps suffisant pour la précipitation de la matière colorante. Celle-ci est placée sur des claies pour égoutter l’eau ;
on la fait ensuite bouillir dans une chaudière pendant trois heures, et on la fait passer sur des claies couvertes de
toile pour l’écoulement complet de l’eau ; enfin on achève la dessiccation en la mettant en presse.
L’Indigofera tinctoria a été cultivé, avec XI. Anil de l’Amérique équinoxiale, par les Français qui ont tenté de
coloniser les rives inférieures du Sénégal ; mais le produit de l’une et -de l’autre de ces espèces de plantes tinctoriales
n'ayant pu balancer, à beaucoup près, les dépenses qu’occasionaient et la culture et la fabrication de l’indigo
, cette branche d’industrie est sur le point d’être abandonnée-
L’expérience nous a convaincus, dans ces dernières années, que les deux espèces tinctoriales d’Indigofères ci-des-
sus mentionnées ne pouvaient pas se travailler ensemble, et qu’il ne résultait de leur mélange qu’une faible quantité
d’indigo de mauvaise qualité. En effet, la première espèce ( /. tinctoria) entre en fermentation deux heures au
moins avant la seconde, en sorte que si l’on veut attendre la fermentation complète de celle-ci, on perd la totalité
de la première. Le battage de l’une s’opère également avec plus de célérité que celui de l’autre, et ainsi de toutes
les autres opérations.
Il est encore une autre cause qui influe puissamment sur la qualité de l’indigo, du Sénégal. C’est la matière
pulvérulente excessivement fine dont sont chargées en dessous les feuilles de la plante. Cette poussière se détache
des feuilles lors de la macération, et par son extrême division reste suspendue dans l’eau où se précipite la substance
colorante avec laquelle elle s’unit, et dont elle altère nécessairement la pureté. L’atmosphère est d’ailleurs
tellement chargé de poussière qu’il s’en dépose une grande quantité dans les cuves pendant la fabrication de l’indigo.
M. Chevreul a trouvé effectivement quatorze pour cent de matières étrangères dans l’indigo du Sénégal.
C’est à cette circonstance que nous devons attribuer l’altération de l’indigo obtenu jusqu’à cette époque dans les
divers établissemens agricoles de la colonie.
Des essais comparatifs nous ont démontré que la variété de l’espèce tinctoriale, indigène du Sénégal, produisait
une plus grande quantité d’indigo, à masses égales de plantes , que X Anil d’Amérique introduit dans la colonie. En
effet , cent vingt bottes de plantes de la première, chacune de deux mètres de circonférence et de quatre pieds et
demi de longueur, ont produit net douze livres d’indigo de bonne qualité, tandis que la même quantité de la dernière
espèce n’a donné que huit livres de même qualité. Mais les graines de l’espèce du Sénégal ont le grave inconvénient
de rester quelquefois plus d’un an dans la terre sans donner aucun signe de germination, tandis que
celles dè X Anil au contraire germent trois ou quatre jours après leur mise en terre. Les agriculteurs ne tardèrent
pas à reconnaître la cause de cette germination tardive. Ayant remarqué que ces semences étaient revêtues d’une
tunique épaisse, cartilagineuse et crustacée, enduite en même temps d’une sorte de vernis imperméable, qui em