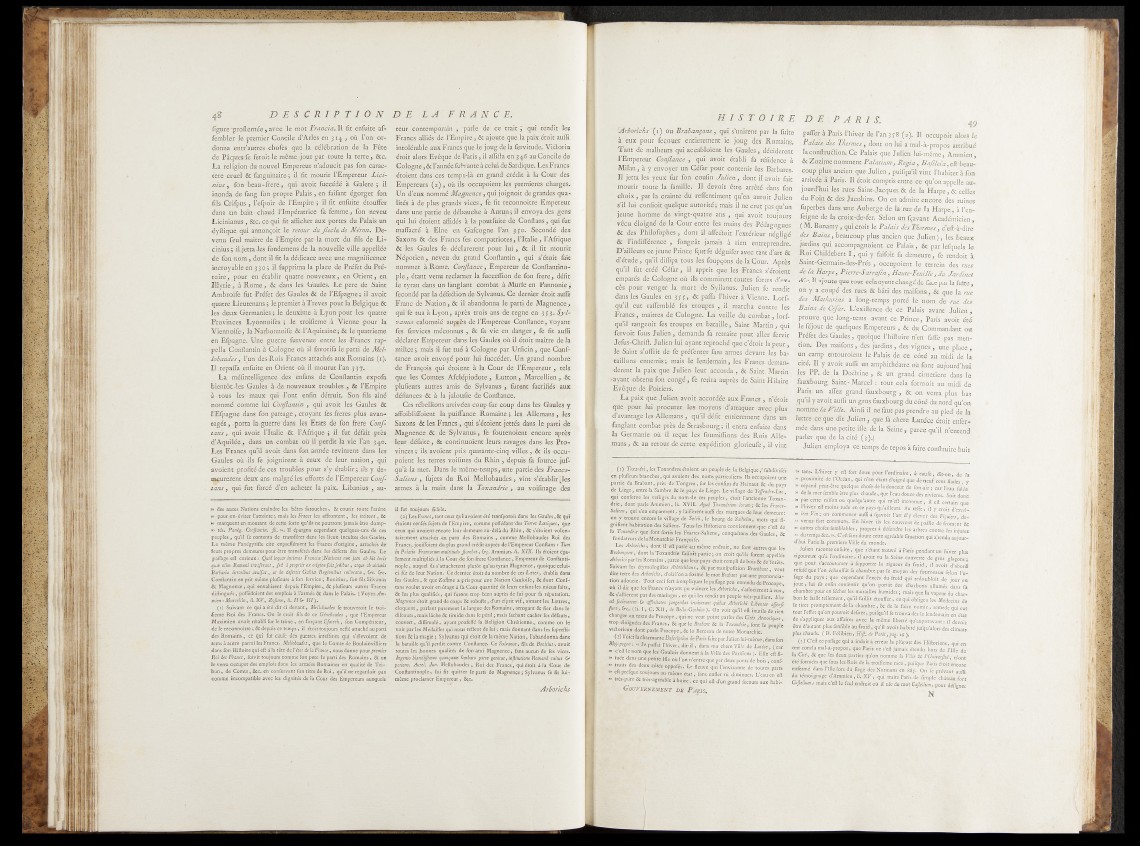
figure ‘profternée-* avec le mot Francia. Il fit ensuite' af-
fembler le ipremier' Co.aeïle d'Arles. en 3 14 , où Ton' ©r-
'ei^nna eatr’autres chofes que la célébration de la Fête
de Pâques.Te feroit le même.-j.ou<r par toute la terre , &c.
La religion-dn nouvel Empereur'n’adoucit pas, ,fon carac-
: tere cruel & fanguinairç; il fit mourir l’Empereur L lc i-
m u s , fon Jaçau -ire^g-^ -qui’ avoit fiagêillv ?Galere . ; il
inonda de fang’.fon propre Palais , en faifant égorger fon
. ^ éra'fià'i'Ee étouffer
dans u n • bain' chaud l’Impératrice fâ?fgpmê-.,; fon -neveu
Licinianus , &c. ce qui fit afficher aux portes du Palais un
dyfiique. qui annoncok le retour du
venu feul | ^ ffl.e^de^Eài|fite'-p^ ^la%mbE^M^mli^de%l^-
cinius-; il.jettadès .fondemens de la nouvelle ville appellée ‘
de foivnom | tdpnÉ S A la ÿêâièàce. avec une magnaficênee
incroyable en.3 30 ; il fupprima la place de Préfet du Prétoire^
pour en établir quatre "nouveaux} en •Orient,-, .en
Xiïyrifi Vfic >dânsUes IGâules.- 'L%4pe# ^ ^ ^ S a ir^
Ambr.oifîé ; fut Préfet :|ésf©â;gte'|ç d;e l'E^agnp*
quatre Lieutenans; le premier.à Trêves pour la Belgique &
les deux Germanies ;. le deuxime .à Lyon pgmr les quatre
Provinces Lyonnoifes *5- de troifieme .à Vienne fpour la
Viennoife j la Narbonn^iCe & TAquitaine'; & le quatrième
en Efpagne.- Une guerre furvenue encre les Francs rap-
pella Confîantin.1 Colôgne où il favorifa le parti de Mel~.
lobaudes} l’un “des--Rois Fr ânes attachés aux Romains (1).
IJ .repaiïa enfuite en Orient.oui il mourutd’an 337.
'5 L a ; méfintellig.ençe "des enfàns de-Gonfiantin .expofa.
bientôt .ies Gaules à-de,-nouveaux troubles & l ’Empire
1 1tous les maux qui l ’ont l'enfin détruit. Son fils aîné
nommé comme lui Conjlantiri , -qui avoit les Gaules &
llÉrpagne dans -fpn partagé,ÿçr^^^£^si^eres, plus; avan^
t-agés, .porta la^ uèrr^i^ps,. les ’Etats .de^fd n l^ |e^^?o^/&g
tons avoit l ’Italie >ê£r l^friqûe^;^SÆikdéfàitM.prè"s-
d /A^aiJ^,- dansi u n . com b âtrC ^^ ^è^dji Iji y^n^ n^l^Oi
L e s Francs qu’il..avoit dans fon, armée revinrent dans les
Gaules o à -ils fe joignirent .à ceux de leur na tion, qui
avo ien t profité de.ces troubles.pour s’ y établir.; ils y de?
zneurerent deux ans majoré,IgS: efforts de TEmpereur-f^z^
t a n s , qui fut forcé d’en acheter la paix. Libanius , ; au-?
«■ des auresdations craindre les bêtes farouches, &-^QUmAtbQ,tél'aréne,.
» pour-en .éviterl’atteinte ; mais les Eraocs les affrontent,' les icritentSc
« marquent en.mousapt de cette forte-qu’ils ne pourront jamais être dornp-
» tés.^Péié^.^hjkad^'JîL «è ll épargna cependant Quelques-uns de.ces
peuples ,>Q^r5fè3Ç&htenta de -tran*férer?dans^l*,.Iiëux‘ incultes,des Gaules,
Le'même Panégyriftc cité expréflement les Francs d’origine, arracHes'de ■
leurs propres demeures pour-être transférés dans les déferts des' Gauîes.lLc
paflàge eft curieux ;\QmdloqudrJévnàs^i^^ {N^ne^on'jdm. db liïsiàeis
guce oUm Rmaid.invtderaiU i Jedm0 ^^is^^ginefuis feiibus,' atque db ultimis
Barbant, linor'üi'usavidfas ,\ut in dëjeriis Gcâlia Regionibus çeüocatée
Conflantin en pat même plufieurs à fon fervice ; JBbnitius, fon fil's Silvja'n'u's’,
& Magnence, qui envahirent depuis l’Empire,' & plufieurs autres Francs
diftingués, poffédoieht des emplois à l’armée 8c dans le Palais. (Voyez Am-
mien-Marcellin, li. XV, Zofime, h. IlSr I/Z). ^
■ ■ (1) 'Suivant eefiqui a été dit ci devant, Mellobaudes fe trouveroijJe trpi-j
fiemey.Rofdee Æs/dé' ce Génebaudes , -que ^’Empereur :
Maximien avait rétabli fur le trône, en forçant Bfatech ,- fon Compétiteur,
de le reconnoître ; 8c depuis ce temps > il étoit toujours relié attaché au parti
des Romains ,: ce qui fut-cauïe ■des guerres inteftincs qui s’élevoient de
tems à autre parmi lesFrancs. Mellobaudes, que le Comte de Boulainvilliers
dans fon Hiftoire qui eft à la tête.dM^^&iflFrrtaçe-, nousdonne-po,ur premier
Moitiés Francsfuivit toujours comme fon pere
le v.erra occuper des(émplorsjda&'j les armées Romaines^ èn’ qualité de Txi-i
Iîuiï* de Comte, &tc. en confer^aQt fon; titre de Roi., qu’il-ne regardoit- pas
comme incompatible avec lés dignités dela Cour des.-Empereurs auxquels '
qiïl^ehdît’ lés
intolérable aux Franesrqaae -le jou g'de la fervitude. ViÉtorin
é to k alors Evêque d’e P a r is , il affiila .en 3^^ auCs'H^ïle de
îÉ o lo g r i^ & l’an n é e fu ^ n té
é to ientrdans\ces tcmps-là en giand crédit à k
Emperèiirs (2 ) , ôii
Un d’eux nommé Magnence , qui jo igno it de.grandes qua •
lités à de plus grands v ic e s , fe fit reconnoître Empereur
- dans une partie de débauche à À u tu n ; i l envo ya des'.gens
.maffacré
Saxons-. . l ’Afrique
îv[épotien, neveu d ^ g j^ ^ 0 ^ o h% b tâ n ^ qui ^éMith fe it
nommer à Rome. Confiance, Empereur de Conftantino-
p le , étant -venu, reclamer la fuccefiion de fon frere , défit
le , tyran; Murfe en
fécondé par la-^défe^^t^d)^^^^ ^ ^ ^ I ^ ^ M | é ^ it>auflït
'.Franc de il ^abandonna Ievpart| dQ ^ a g fié r ic^,
t*ÿoÀ i a‘brès*r^ ^ ^B ^!Éeé:êgne
• y d M p j fmpereur'^ônffâng^^@^ ^
^éclârerÆfepereur dans^les paître,^eda*'
itance, avoiEe'ffvô^é$^ ^ ^ M'ffuccéder.lÆyugrand Knombre'
e 'd e ^ ^ ^Q'^ ^ p i feétQient-r.ay ^ G ^ m de^Emp^^
que fe s i^ ^ ^ g s^ ^ oM S ^ o p e t , Lu ttqn ,v Marcellien y >6c
plufieurs autres amis de Sylvanus , furent facrifiés aux
^SIMâfi?^p t ^ l a . puiflance ^Rbmainei; -deS^All'eMaris -~^ies
Saxpns. & les. .
ifë .i -apiès--
•-leur M jM t ^ ^ÆoritinuQienl: dlprsÿ,ray^^7dahs,~J.es P ro -
ils occuterrés,*'
vo^^^idu Æ^Hfn^iclepuis^fâ^^^m^^pufig
qu’ à la mer. Dans le même-temps, une partie des Françs-
Sja^iens., t füjpts^u~ jR ô i: JJÆellQbaudM^ j■ fm^^^raMir-|lés
armes à la main dans la Toxandrie , au voifinage des
il fut toujours -gdèle^^^
(z) Les Francs, tant ceux quiavoient été tranfporte's dans les Gaules ,& qui
étoient cenfés fujets de l’Empire, comme poffifdant ’desTerres Loetiques, que
«cetfx ^i^av«jën%^core.léùr'demêt^eta^^àMuiRhin^|^^é^ieM£yolon^
tâijementjattàchés i a ipafti des Romains comme MreM’obaudes^ Roi des
Francs, jouiïïbient du plus grand crédit auprès de l’Empereur Conftans : Twn
hiPaiatio FrcmcorummukitMo Jlorebéify$&p> kmmhn. li.
Iement multipliés à la Cour de fon frere Confiance, Empereur de Conftanti-
nople, auquel ils s’attachèrent plutôt qu’au tyran Magnence, quoique celui-,
ci fut de'leuWNatïon^^Ëe/demrer 'étoit du nornbré?d^ces LOErç^,sëtabJisfdâns;
les Gaules j ’8c que Zofimè a pris pour une Natiori^Gaulbife,58e(lontèGQnf-5
tans voulut avoir-en otage à fa Cour quantitéde leurs enfans les fnieux* faits,’
& les plus qualifiés , qui furent trop >bièn;a3ptès dé'lui^pobr.Tà réputation.
Magnence étoit grandide corp’s & robufte ÿ.Q?â^B^^|^âünànt'le8-Lçttres
"éloquent^ parlant purement la langue des Romains, arrogant 8c fier dansvlè
difcours , maislâche 8c timide dans le péril ; mais/fàdiant -cacher fes défautsV
'couver?, fîffîmuféij ayant profelfé la Religion Chrétienne, comme on le
f^>î^ar'leilMédaiHesrqui-:nous refient de 'lui;,-mais donnant dans les fuperfli-
tions & la-magie ; Sylvanus qui étoit de la même Nation, ^abandonna dans
la bataille qu’il perdit contrerConfiance. Ce Sylvanus, fils de Bonitius > avoit
toutes les jbonhes qualités de fon ami, Magnencé, .fans aucun de fes vices.
Ingenio blandijjimus quanquam b'arbdro pâtre geriitus, inftitutione Romand cultus 6*
ipatutfs. Adret. Jun. ^Mellobaudes , ’zRdr des Francs, qui éfôit^à la Gbuç do
-Gonflant-ino,plc, lui fit quitter le parti de Magnence J Sylvanus fe fit lui-,
xnême^àclàmér Empereur ^ Sce.
Arborichi
1 1WÊËÊOEÊÊÊÈ oeÈ H K Ë Ê r K
^Mmo/içAs' '( i ) 1 .o û ^ rh b a n ç 'ô^ î, ;çâ^s |l^^TOW r MîjTüite'
^ eux p% l\ l'feeouer entièrement ie jo u g dles R©mains.
*Taiît' detfm^hëürs ‘
l ’Empereur Cb/z/^ayzÊ-e ‘qui - avoit établi fa réfidence à
M ia c i \ ■
I l jetta les y eu x fur fon- coufin .T/i/z’e/zQ étant i f a vait fait
mourir t©,uÈe la famille. I l devoit être arrêté dans fon
1 c h o ix , par la crainte11 ehi reffentiment qu’en auroit Julien
s il lu i eonfioit quelque autorité i mais il ne cmfr'pas^,u’i»
jeune h^mii^e ,de vingt-quatie aUs , qui avoit toujours
v écu éloigné de ia 'Cour entre les mains des Pédagogues
& des P hilo fop he s , dont il afFeâoit l’extérieisi'r négligé
& l ’indiSérekee , fongeât jamais a rien emi-epréndre.
■ Daiileurs ce jeune P rince feutfe déguifer avec tant d’arc &
d’é tu d e , qu’il diffipà fous fes foupçons de-la- Cour. Après
qu’ il fut c iéé s’ étoient
. ©ës iipëiUE;. v êf^ ë r ■. : fu fem fe |p | |» B |
1 dans les Gaulgst e a 3 y y 3 & pàffa - l ’h-iver- à Vienne. L o r f-
qu i l eut raffemblé fes î troupes il marcha contre les "1
F ranc s , maîcres de Çolbgrfe. L a veille du com b at, lo if-
qu’il rangeoit fes troupes en b ataille, Saint Martin 3 qui
jputtien:, demanda âlier îervir J
Ja^euÿ^ " i
le Saint s’offrit de fe présenter fans armes devant les b a- I
taillons ênnemis j mais l'e“ lendemain, les Francs de’piàn^
n |
• ayant obtenu fon congé 3 fe retira auprès de Saine Hilaire
Evêque de Poitiers.
• pai* qjie^ Julien,asvoit accordée aux Francs , n’étoit I
que pour lui procurer les moyens d’attaquer avec plus
d’avantage les Allemand, qu’il défît ^entièrement dans un
fangîaaat-combat près de Strasbourg; il entra enfuite dans
la Germanie où il reçut les- foumiflions des Rois Alle-
ràans ^ .ôt au retour de c§tte expédition- gl'orieufe 3 il vint’ I
m m ,
Vc i’1 1 | B ë | ■ 1 / ? 1 J
.coup plus ancien que Ju lien , puifqu-il vint l ’habiter à fon
a: ' 1 - 1 ' ’ - - 1 j B U ii
c ird’hui. les rues Saint-Jacques-ôt ie la H : j . f y j
I ’ l1' P°>n & des Jacobins. ( ) i en admire encoi - df ■ uines 1
: “ ' T‘ , - e .
r j i i , j , ^ y » L* i i- i
p V . K ^ ' j i
.-i*. r T * u , f
WMml ’ y . -.-i
1 r i *-1 j t i i ' ' ' ^ y ' r' <■
r - ;7 w & * y
I/; dlXï/lÇiï--. î
- .y ~:î r r y?)1- ^ J
B^r-üS'i£v11'K a tV i . 1’’ t o : 1,1 ' » I
r • Î J n ' i
V .- .’ V - ' J ® ? 'r l “ '.' * '> "I
“1 i v ' » i ‘ ,* W î
^ '1 * ’ i ;*Ùîî. '
*iî Ü’. i 1 ' i * j . f * i r z y S K r lTOr.‘!.'!i i ,
i , . . - 5 1,
Toxan'dres éfeiènt un .peuple de la Belgique fùbdivifés’.
|» lS f îe ü r s branches,Qui avôient des noms particuliers. Ils occupoient une
: partie du Brabant, près d'efTon^es^fur.lésçorifips.diïAaiMuU&ï^Éa^
de Liege, entr'ela Sambre & le ,pa^s de Liege. Le village’de Tejfender-Loo,
qui eonferve les veftiges du nom de ces peuples, étoit 1 ancienne Toxan-
'driê;;ddrit\'^mMM^î^^-l^XVII.T>jDM(f Toxandriam • lociûn^iébles Francs-
Safei,v qhi s’eu emparerent, y làifferent auffi des marques de leur demeure:
on ytrpuVe erioare le village de -SelcA, le bourg de Sa/Aeim, mots qui fi-
gnifient' ïrabititiôn des Saliens. Tous IesHiftoriens conviennent que c’eft de
■ Ia T’oxandn,e V e font fottis les Francs-Saliens, cônqùérâùs^^Gabïès, &
j: fondateurs delà Monarchie Françoife.
Les AAoric/w, dont il "eft-parlé^au même endroit, ne font .à'utres que 1^
Braianfonj, dont la Toxandric faifoit partie ; on croit qu’ils furent appelles
É0 r6ôrici par I^RffflainHjlarcé’qije’ leur pays étoit rempli de-bois & de'forêts.
Suivant les étym'olôgiftes Arbrlchbaniii^^tj^n^oMonfBrachlant veut
dire tcrrc desÆioric/ts, d’où l’on a formé le mot BraJaai par une prononciation
adoucie. Tout ceci fert à expliquer le paflàge peu- entendu deProcope,.
oQ il dit s’aflbeierent à eux •
3 ’» t « ^ « ages ’ ce4^b‘ ^s tendit un peuple tiès-puiflknt. Moi
ad .focieeaceml!& ■ 'afflnitates -jùngeftdas Untarmt quibus Arborichi Libenter àjfenji '
i/â«ç^,jSïc. £li^i^^^oçivy Jël, inutile::de%n'?
changer au texte de-Procèpe, qui ne veut/point parler ides \#ér.^rràorijuej,
•tropî^loi^^^s -^kncs i' 8c, qué.l^Braiàfft & ’ la Tox-anda^.f^^^ peuple
viftotieux dont' paile Procope, & le Berceau dê.’h&'t^ Monarchie., '
Voici% oharmante’DeJcripYién ie Paris faite par Julien lui même, dansfon
■ Myfopogon : « Je paflài l’hiver, dit-il, dkrîs ma chere Ville de Lwece, (car
» ceftlenom qbe-^^MpS'db'rirîènV^^^011 ©’'dëi'Pàrifi'ëÉV^^e eftfi-
* tüëe dans une petite Iflc ou l’on n’entre que par deux-ponts*de bois, conf-'
» ^ deU^^Af^o^fés:. ^ fleùve- qû^^^nne'îde toutes parts/’
=» ell prclque toujouis au même e'tat, fans enfler ni diminuer. L’eau en. eft.
» très-pure & trèsràgreablc àvboire, ce qui eft d’un gra'nd fecouts aux habià
à W ^ f a s i \
» .‘^'caufe ÿdMo^ÿde<’ 1È
» proximité deJ’Q ê ^ ^ g p ^ é f à ^ lC o ^ ^ ^ ^ ^ ^ c l^ f t â d e s , y
”/'rél^Q^P^^p:^qubf^ephb^^dbucèl^ae^^ ^ ^ P 1rÿr:î,^M|^'fi^
‘raybhJoàu^Iqu?autre'- qui m|eft inconnüé,! i f eft certaw Quer
ây^âiMi?S&Au^réfeil
" des Figuiprsyde*
\ :gj.
d'huUPari’s. Ia première Ville du1 monde.’^ 1
* ^ 0UV® à Paris‘‘Pendant un hiver plus
rigpnreux qu’a l’ordmaire, il avoit vu la Seine couverte de gros glaçons ;
que pour-s’accoutumer à fupporter la rigueur du froid, ifavoit'-d’àlor^
î qu©'ceperft^ei;M^^^^^4 1 ^Vr|a^Io^!âe1 jouF-'eA’
^ allumés Bàns 'fâ
( ^ambré^^u?ehféc^^^^|Me^^^üaè'i^‘ràais'que^lt'VàÉeurïdu''’cËar—
^b‘Ôhvle faîfit telleme’nt /qM f e l lit, étouffer, c^oe ^ ^ ÿ e '^M é à e c ïnM
^.the r prampfément,dëÆ^i0î|i;e| v o m i r , rejnedèqui eut
2'fout l’effet qu’ori-pouvoit defirer, puifqù’ilfe trouva dès le lendemain en état
de. s’appliquer aux affais^ ^ e c - ^ ev^ :.
être dîâüf?n^glu§i^»aia &oidi des climats
plus chauds. ( D. Félibicn,. H//?.' dè Paris, pag. ié );
(3) C’eft ce pairage qui a induit à erreur la plupart des Hiftoriens, qui en,
!ont coâclumal-à-proposj qite Paris ne s’ëffl^mals Vtëiidu hors de l’Ifle de-
|| Ciré, & que les deux parties qu on nomme la F7//e 8c l’Univerfité, n’ont
.étéformées que fous les Rois'dc I^oiftemê^e, puifque Pans éfbif encore
enferme' ^^ofman^|!^>88jî- o / fè ^révaul ÿuflf ^
■ dte tèm:bigh?ge d’Æmmien , Zi. XF, qui traite Raris ■ de^lirnpîe château fort
' Cajiett«/« ; majsAeft|^I'endroit 011 il ufe du mot Cajie/la/n, pour défigner
É ■