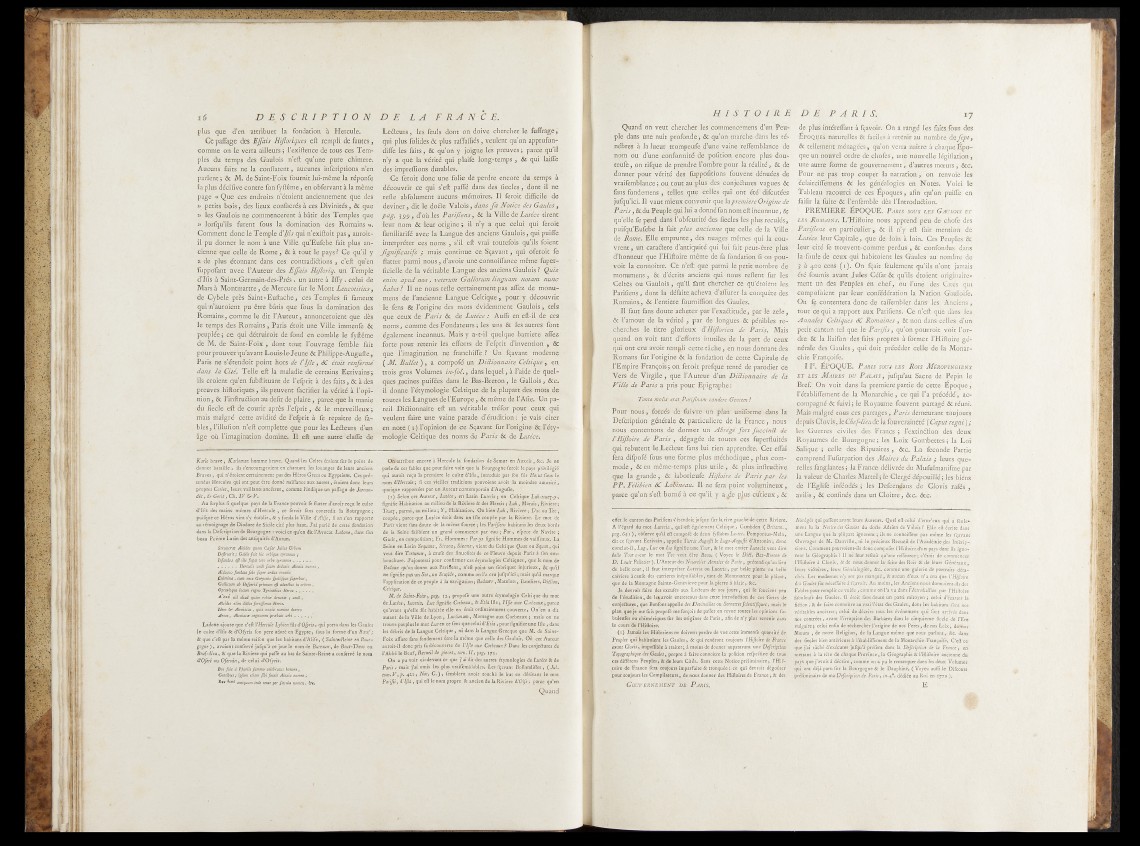
m m m m s u m m m m i
plus que
' d e fau teW
^ m m e i on lè ^pra^iHe^^lljëxifteaÆefQ^tQSSSS^ ^ ^ m ^
piles 7^ü ^ÆéimlsM ^ a© ^ . ofé
Auctifis!; ifus^ne là ^ M r a c ëÆ ^ ^ l^ ï ï^ l in l^ iuti'QyMnle ^
parlent ; ‘fie
3a plus d&cifive contr-e fon fyflême, en ©bfervant à la même
p a g e \ « ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t^ ^ ^ ^ .c ie rm ê toM tJ q u e ‘£de^
» petits b o is , des
» les Gallois ne ^commeneerent à ibâtir des ‘ Tèm|jjsffl|Jng
ftlfis qui n’ exiftoit [p,as^auroit£.
il pii donner le nom à une Ville quËufebe fait plû&âjnjl
^ ^ ^ ^ u ^ S ^ P ^ K ô tn e Y & ^ t ^ m e fp a y s ?M ê ^ o ^ ^
a 'd e ^ li^ ieEqanan a^Æ ^ TO ^ E ^ C T^ li^ S^ ^ I ^ ^ S w en^
ruppgjTant -avec l’Auteur ' des E fja is Hifloriqr un Temple
autre à Ifly., celui de
rM a r s ^ ^ ^ m M ^ p i dé^Hercufe.,fu^ ^ ! tC T i t ? j ^ ^ ^ / ^ ^
‘-.Saint: - E u fta che , çés Templësju^fàn^wc-'-
qui wi’âuroierit pu être bâtis qüe5^®u@a domination* des
le tempsp&ès Romains ^ iPa-ris ëtqit'une' Ville immenfe &
de M . '
Paris ne s’ étendoit po in t hors ïïà^^^^ÊiSC, étojtjîrénfttïM i
‘ dans. là Cité. T e l l e ‘eft la * 1'rîialadi‘è;cle certains E c riv ain s;■•;
ips croient qu en fu b ftitu ânt de l ’ efpiit à des faits , & à dek
preuves h iflo r iq u ^ J ils peuvent faerifier la v,érité a j ^ p ^
iiion f & -'Mnftiuââon au defir de p laire , parcq'que la manie"
-du fiecl'ë .eft de courir .après r e f p r ï t ,& le merveilleux 9
H jd^7#|jg fe-.|étte avidité de l’eîprit à fe repaître g a B i f i
bleV^^ l u f i o n j^ ^ c ^ p l e t t ^ q u e ' pduifl^ f f i^ ^ m ^ d iu a
âg e
L A F R A N C E -
n'y ‘ o t B R ' :
;deviqlM|ditUë’do£te‘ Valois j dans\Jl^ M MXc& des Gaules ,
pdg. 3%9'j d’oùïîëS'Pari/Çe/^ & 'la Vi>llèl de” Zz^ece tirent
lèùrjnom
familiariféi jjjffi
i^ ^ s :
enim àpuctpos j. veterum Gallorum linguam m tam mme
hahet ? Il ne nous refte certainement pas affêz de m'onû^
Jfle'dens ,
B | ^ ' ceux^defe^^^' ' Aialll
^ « &
- que
' t r o i ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ans.lequel^à^ail'd S d ^ ïïel| ;.
ques racines puifées dans le Ba s-Breto n, le G a llo is, ôcc.
reil<FH^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |^ r^M ^ tr'éM ^ p ^ ^G e uX y> .q ü iii,
veiderit .’■faire-.- uhe,^vMn^^arlEeî^(^^03Mw^ è.-vais^ citer
|gfiriîndt&.>QijAJfe^
■ Marié brave y-Karloman. homme;brâfe;^,Quand les Celtesétoient’fur le point-dé
donnec^pailie j ilss’encourageoient en'chantant Soe lQu^ïig^rae leurs anciens
Braves, qui njétojentfoeïtaiqement pas dès Héros; Grecs ou Egyptiens. Ges,.pre^
tendus Hercules..qui aDtmew^rê'donné'naiflanceaux autres^ étoient donc leurs
propres Caries, leurs Taillants ancêtres,- comme l,indiq.ueiun palTage de Jornun*
dès, de Getü, Ch. IF & V.
■■. Au fùrplus fijquerque' paysM|fla^rance'pouToitcfc'flatter d’avoir reçu le culte
■ d’Ilîs des mains mêmes d’Hercule , ce fêroit fans contredit la Bourgogne;
puifque ce Héros vint ^ ,étabfic*, -àc y fonda la Ville A'Æifej. fi on s’en rapporte:
au témoignage de Diodore de Sicile cité plus haut. J’ai parlé'de cette fondation
dans la Description de Bourgogne : voici.ce q^u’en dit l’AvScat Ladone, dans fon*
beau Poemeu^tin des antiquités d’Autun.
- - Scruxerat Alcides quant Coefar Julius Urbèm
' Dcjlruxit; Gallis fuie hic -obbtque. tyrannus -;. ■
ïnfandos; ajl ille fiigat toeo prie tyrannos . . . . . . ^ ’K
. . . • . . Hà-mlitmii füùm dabixit -Alêxia nrnén ,
■ S,. • Æduaco jùnâaia fplo Juftr arim'Tnoüûs
, (hdmwa.amwciGayonis fpolüfque fap'rlus,
GÆcum ab Hefperiâ primum tfi adveclus in orbem ,
Optaynq^ loann^np TyrwHits?Heroi . . . . . . .
Z -’ AW^â/iBd quàm robur dénotât ; uniè ,
_ • Alaiu olim diflus forcijjimui Héros.
‘ «m mm* téifa
^Arêit, -AUxiacx ctgnomenjreebuit utbi............’
Ladone ajoute que c’efl l’Hercule Lyhien fils d’Ofiris, qiii porta dans les'Gaules
le culte d/Ifis & d’Oïÿris fon.pere adoré en Egypte , lpuS la,;form'e d'un 'Bâuf;
Sc^que c’efl par la mem'e Miloh;'qu’é les hab^MS^Æîî^|('Sflinrr*Re//ie én ,BQürV
gagne)i avoient confervé jufqu’à ce jour le nom de Bureaux, de Bous-Tfoîo’si'qü-
Beùf-dieu, & que la Riviefe qui pafle au bas de Sainte-Reine a confervé le nom
i ’Oferi ou OJêrain, de celui d?Ofÿris. ^r|
.. C^fettribué encor||â|HqrculeJa fondation de i^pé
parle de ces fables que pour faire voirque la Bourgogne feroit lespays^privilégic
qui auroit reçu la première le culte'dMfis, introduit par fon Bis Hbiur fous le
nom à’Hercule ; fi ces vieilles traditions pouvoient avoir la moindre autorité ,
quoique rapportées par un Auteur contemporain d’Augufle.
- . (x) 'Seloncet-.Auteur, aLutécei* ien Latim üiittct/n’jr'enp 'Celtique iLult-rtoue^,
/fignifie Habitation au milieu de la Rivicre & des Marais ; Lu/t, Marais, Riviere;
- ^u^,pàrmî|^^™^^^^^.vHâbitatidn;\'^^^b?^TWM^OTRi^ér^liD^.Qif'Fèc.-^
feyiî^je.jvparcç'qu'e mot de
Paris 5viëBt: &S-âbùte. de .'la^^SmgTO^vré^E^i/FenrrhaBitans les -deujfr^rfls j
de la Seine fefëient un. grand commercé! par -eay ; Par, efpece de ®aÿir,é> ;.
Gwis, en compôfition ; Yi, Hommes : fîar^r:ffghifie Hommes de vaifleaux. La\
Seine en Latin Sequana, Sicana, Sienna, vient du Celtique; Quan ou Sçuan, qui
.veut, dire Torfûeu»,, ^cauf^ ^ ^^oficé^de ce Fleuve depuis Paris à fbn em-
'tbouchure. J’ajouterai pour confirmer ces étymologies Celtiques, que lé;nom.,dè
' BSdtùue qu’on donne, aux Pariflens^rféflïpqWfëun. *fpbfiqiuèt.'ihjurieux, 6c qu’il
né fignifie pas un Sot, un Stupide , comme d'n-l’a oru jufqu’ici.; mais^qulill marque
l ’application dé c’e!îpeiiple à la navigation ; Badawr, Matelots, Bateliers. Dislion.
• G ek i^ i^ y \
M.1 de Saint-Foix, pag. 1 1 propofè'une autre étymol'ogie ’Celtique du mot
de Lutéce, Lucetia., Luc fignifie Corbeau, & Etia Tfle 9 1*//Ze nu» Cirienu«, parce
qu’avant qu’elleïîtfç'hâbitéfe/elle en étoit ordinairement couverte, ©n’cn^âiffl
autant' de la Yiüè.'de Lyon, Lucdunum, Montagne aux Corbeaux-;;,vmàis;.qn me;
-trouve pas plus le mot Luc en ce fens que'celui d’Ætia, pour)fîgnifiér.une'iIifle, dans
les débris de la Langue Cel tique'?iniïdansHla Langue,Grecîliùévque M. de Saint-
Foix affure fans fondement être la même que
•auroit-il donc pris fâdecouverte de l’ I^le aux Corbeaux ? Dans lesconijeflures/dè
"l’Abbé le Beuf, Recueil de .pièces, tom.Ili pag. 'iyy. -,
•~ p n ? a pu voir ci-devant ce iquc j’ai dit des autres é'tymologips de Lutéce & de
Pans ; mais j’ai omis 'les plus vraifemblables. Lest fqavans Bollandiftcs , ( Jul.
tom.V,p. 4111 -Wor- C. ) , femblent 'savoir touché 'le >bût'entdérivant le mpt
Parifii, d’(ff«^a^efl'«ippmJpropfe,ât ancjende là Riyiete%‘d!0 (/êV pâjr'oè qu’en
? | H p
u> m.^ÊmÊmns d jy. r h r? és^
• f i e ;
Hébares à la lueur trompeufe'pWe iKanhe rëHeinblafice dèj
teufe , on rifque de prendre l’ombre pour- la réa lité , 6c de
j^ m f é ÿ f îa n c e es ôe.
fans fondemens , telles que celles qui ont été difeutées
Jufqu ici. I l vaut mieux c©nvenir
puifqu Èufe'bè la fait jp/«j rz/zei^/z/ze que celle de ia Ville ,
i'B’ë^^^r/E ilë fëmprùntëB^ ^nua 'g e^mêE^^ quilf^.GQ u^,
vrent5 un caraftere d’antiquité qui lü-rfait peut-êcr^mSsffl
d'Hqnneur que rHiftqi^e^m ^ ^ d ^ ^ a^ fo n ^ ^ ^ T O n l n a p i
^©it^l^honni^itre. vCe n’efl que parmi 'le petit
monumens 3 ôc d’écrits anciens qui nous relient fur les-|
Parifiens, dont la défaite acheva d’aiïiirer la conquête des
Romains j ôc l ’entiere foumiiïi on des Gaules.
M '£I l faut fans dT$âte acheter par rexa£ticude5 par le zele i ‘
WiïjM&Ê
■ M ais
quand on v©it tant d’eiïbrts i&îtillêsi'de la part de ceux
Romans fur Torigine ôc la fondation de cette Capitale de
1 Empiie François; on feroit prefque tent^ de parodier'ce
1 W& MBS
; Tant* molis er^aufuMm condere Gentem ! . •'
dey ■
qui rebutent le,Le£leur fans lui rien apprendre. Cec eflai ;
fera difpofé fous une forme plus méthodique, plus commode
, ôc en même-temps plus u t i le , ôc plus inftru&ive
que la1 grande^ & laborieufe -S^Zoir^.afe Przrzj^przr
P P . jFe7i3ie/i <&T io^i/zetzzt. Il-\ne fera point vohimâneux ,
parce q u o n s’eft borné à ce qu’il y a plus curieux y ôc
•iÆivpluæ^ërëirant' : 4%aûgp les?, failMoue des
É poqiîjcs. nature]les & faciles à retenir au nombre de7^/»^ >
^ &' v e r^ ^ à ||re
^ ^ ^ ùnMf^ y ë l uii^^®h|eUë\ régiïl’à t^ ^ ^
||mèi aù i ^ ^ m e ^ d e lg ^ ^ ^ ^m e h t0 d ’autres- m’oeur'S y i0 d&'‘.
-F^dcmp'er-la narration , on renvoie les
écl aif,ci^ ^ ^^pM-i'i,]^M^ ^ p iiQ^^ ‘ et^Bro’^esi^i. V'oicÜ fe?
Tab leau -racourci de ces É poques, afin qu’on puiffe en
faifir la fuite ôc l ’enfemble dès TlntroduÊtion.
f et
( d ê v^ o ^ ' des
Parl/îens en p articulier, ôc il n’ y eft fait mention de
la-foule de c eu x qui habicoient les Gaules au nombre de
5 à 4,00 cens ( 1 ) . On fçaic feulement qu’ ils n’ont jamais
été fournis avant Jules Céfar ôc qu’ils étoient originairement
un des Peuples en c h e f, ou l’une des Cités qui
O n fe contentera donc de rafiemb 1er dans les Anciens ,
petit canton tel que le P arifis, qu’on pourroit vo ir l ’ordre
ôc la liaifon des faits propres à former l ’Hiftoire g é nérale
des G au le s , qui doit précéder celle de la Monarchie
Françoife.
I I e. ÉPOQUE. P aru ' ^ ^^dri-w^iÈN^
et ,les Di7 jufqp’aii1 Sacre de Pépin lé',’
’ In ^MTOeM'èrë'paiitie vdéfpetté^ Ep'oçjjàg M
^^mM^nét&'ft^^^l&Ro^aà^é^fpiiyènt, p aixagé^A^éùrii^
'M â i^ ^ ^ g l^ t^ S çe^pàrt^ges
des
' comprend l ’ufurpation des Maires du P a la is ÿ leurs querelles
fanglantes; la France délivrée du Mufulmanirme par '
k v aleur
avilis^ ôc confinés dans unplfdî>tr<e,^ ôcc. ôcc. |
effet le canton des Parifîens s’étendoit jufque fur la rive gauche de cette Riviere.
A l’égard du mot Lutécia , quî <èft également Celtique, Gambden, .(Britann;,,
pog. i>41 ) ^ obfo^ë'qp^fofl^n^^é’de'délS^iyllabes LüTirc.1 EompSmus-Mela }-
dit ce fçàvint' Ecrivain , appelle Tunis /lugujli le Lugo-Augujli d’Antonin ; donc
'.conclut-:il, Lug, Luc ou Lu fignifie une Tour, & le mot entier,>Jjuteciflvveut dire
Wnle ' Tour 'jjcar le mot Tec veu't ^ire'^aju. ( Voyez le Di£F. Bas-Breton de
^^^Lw^FeZ/etièr^ L' Auteur iès lfôuvelles' Annaks de Paris, prétend'qu’au lieu
'd'e 'belle tour, il Faut interpréter Lutécia ou Lucetia, par b elle j) ierre'vbu' b.ell’e,'
carrière à cau^des ^rierek inépuifablcs,' tant de Montmartre pour le'plâtre,
que de la Montagne Sainte-Gcnevieve pour la pierre àsbâ’tjùf^®j|^^,
Je. devrois faire des exeufes aux LefteurS de nos jours, qui fe foupient peu
de l’érudition, de- le?- avoir entretenus dans cette introduiftion de ces Portes de
conjeÔùres, que Bonfons appelle des Devinailles' on- Sornettes feieniifiques ; mais'lej
plan qüq.je mefuis,propofé me forçqit- de pafier en revue toutes'les opinions Ta'-,
buleufes ou chimériques fur les origines de Paris ^tm’oe n’^^ l-rfevenir daris-
le cours^î^ftoire.
(i) Jamdiî^^Ëiflônens nfedqivént psrdre de: vue cette immenfëTq^itité 'de
Peuples quî-.Baoitoiqnt les Gaulés, ^^ÎMMaront; toujours l'Hijloire de France
{iedtdht G/bviJ, impolfibte à traiter; à moins de donner auparavant une Defcnption
typographique des Gaules, propre à faire connoitre là pofition relpcéÜYcjde tous
ces difFérens Peuples”, ISt^eleurs Cités. Sans cette Notice préliminaire, l’Hif-
^oire de France fera toujours imparfaite & tronquée-:, ce qui devroit dég'dflreH
pour toujours les Compilaftùrt i, de nous donner des, Hiftoires de France'1, & dés;,'
Hÿ.^OlJ^ERr/EMENT DE
iVÂb.E.cgésV,qui.'çafFent avant leurs Auteurs. Quelefl-célui d’entr’eux qui a feule^
« ment lu la Norice dés Gaulés, 'du 'doâe Adrien de Valois? Elle eft écrite dans;
une Langue?q^p^^m^r#igndrM^^^n&eoimoil^nt^pâs inême les fçavans
, Ouvrages de 1VI. Danville, ni le précieux Recueil de l’Académie des In fciÆp-
^^^^mrE^t^ottrroiém-ils donc^q^^ùipiHiflbitfcd’un' pays dont ils^igno,-.
renr lanGéogir^pliie 1 II ne leurrefloit qu’unq rtfllouroe ; c’çtoit de commencer
l’Hiftoire à Clovis, & de nous donner la1 faire'dgs Rois &de'iéurs Généraux,
leurs viâoires, leurs Généalogies, &c. comme une galerie'de portraits déta-
.rtcïicsî'ÎLes modernes n’y onc pas'mnrfuéy^ffÆr^^UX, n’a cru que VHiJloire
• dcS Gimles fut"néceflàirc à fçavoir. Au moins, les A-nciens nous donnoiènt-ils des
^ailp^oæ.reîhpHt c’eV^M^j^W^ekO'à‘i?â|^ ^ îs ’PfntroduÆfionfra^KHiTO^e
fubuleufè des Gaules.* PI éto'iç 'fans doute un parti mitoyen ; celui d’écarter la
,ifiâiô'n,-& de faire connoîtrejit&^fePétaCÎd^^auleSJxldn^KsîJîahitans^lSl^hhÿ“'
véûtables ancêtres ; celui de décrire tous les évenemens <qifM§nt arrivés dans
^ms>cô,nvtréês'jwra^ï?Mu^^m^ -B arbàrés>da‘fts'lfetcmqu'iemé,’fîèll^^l^rÀ
iv^eviée^ 'ôdutv£àfiffidè rechercher l’origine de^ nos Peres.ÿ de nos Loix, dè^nos
Moeurs , de notre Religion, de la Langue même,que n^us,ipaflpnsV<&c. dans
Mes^fiècles bien antérieurs à: l^tablillèment de la Monarchie Françoife. C’eft ce
-qiue j’ai? ;tâclié d’exécu t e j p fqu! à’ pr élent dans' 1^ Ljejffipttoifiderltt France ^ enT
niëttant à la tête de chaque Province, la Géographie & l’Hiftoire ancienne1 du '
pays que j’avois à décrire, comme on a pu le remarquer dans les, deux-. Volumes1-
âji^nt’ déjà pamf@^^mgogn& 8e le^DaÙpHiiîélt ( Voyez aufti le Difcours
‘préliminaire d e ma Defcription de Paus, în~ 40. dédiée au Roi en 177? ).
H B M i