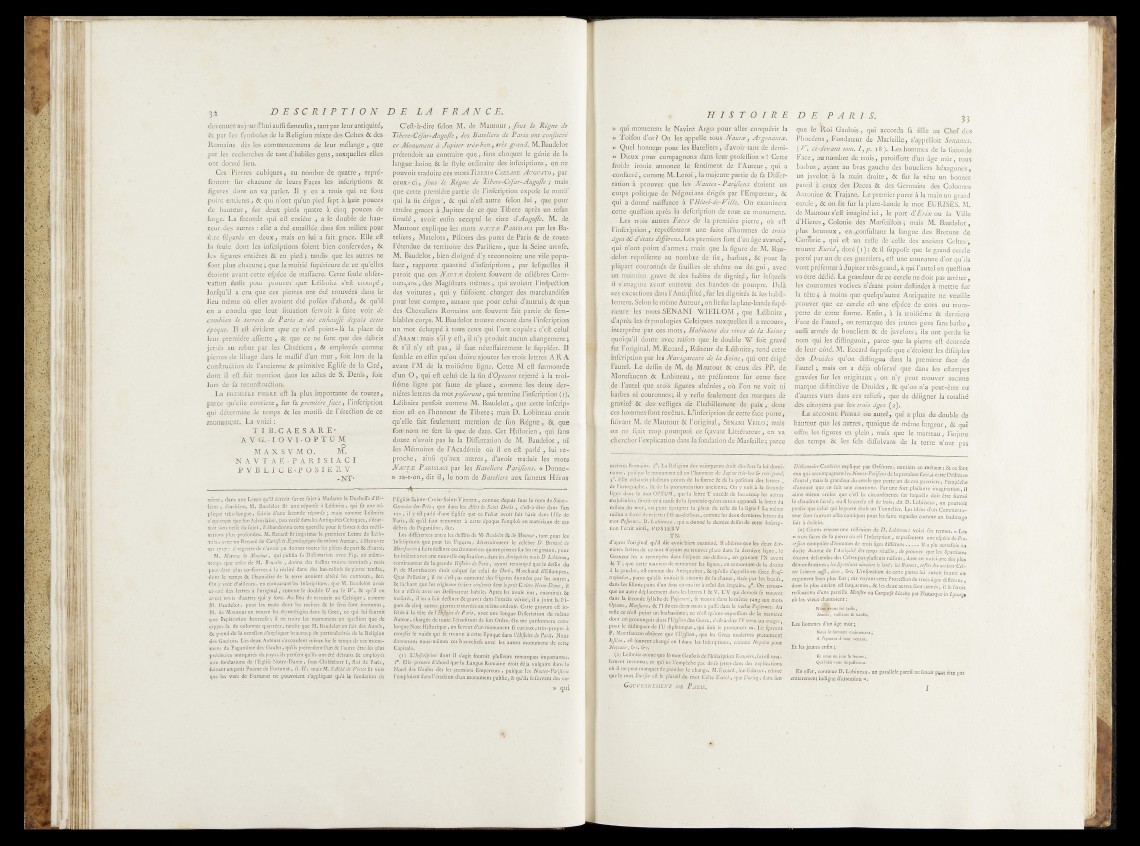
3a ( D E p S •£, R I r ± - T m j g m D F L A F -R A W C j L .
.>.d&venue8:ai»aurdüiüAiM^ ^ ^ ^ j ^ n t / p ^ ^ m ^ ^ | ™
8c par les Cynubo'lës de la R e lig io n mixte des Celtes 8c des
jpai le s l'echerches'cle janc d4aa!biles g en s , auxquelles elfes
ont donné lieu.
' Ces Pierres cubiques, »au ^nombre de -quatre , repré-
.J 1 ‘W p y ^ Bm |yB n S te c ;fon,t
|à. huit pouces
quatrel i l
Mkpge. L a ^ a le double de hauteu
r -des autres : elle a .été entaillée dans fon milieu pour
â ê a e .fépar>ée en deux-,- mais on lu i a.fait grâce. E lle eft.
le s figures entières & en pied ; tandis que les autres ne
^ahlct^has chacune ; que la m oitié fupéiieure de ce quelles-
^ Fpje-nt:-avant cette efrpiee de malfaere. C e tte feule Æjjpjg-.-.
; s^^-^àrnpj|;»\
cru„-que ces-. pierres^
Jift^^ ^ ^ ^ ^ p r f^ i e ^ y s fen t| |p^p!Qfées .d’afrord^ |L
.en -a|ÿc 'ii'^û^ùe,vj ^^r-iÉfetiatâîâBl :ÉèÿÈ'iMaim
m e. - terreinP- de ÊMimùu, été t ixkmjje^dgifiis cette ]
époque. I l eft évident que c e ;n eft ^©int-là la place de
^p^jpr^eraiére afïiette ,- & que ce ne. font .que des délfis,.
-î&fetéffaiéjeDui^ ^ r ^ e s ^ n ^ ^e^ s'fo &^mplôyrés.. ^Ommg
( | | raaflif id^un^^^^foit :l ô jsM < ^ a .-.
^QnÆ bM ^ ^ ^ ^ a n m ^ W i^njinx itive^EgHfe^dgM^ i t é ^ .
mention .dans l è s l ^ â ^ | y S . r D e n i s J ^ ^
-for^ deJa^r-eeqnfou^pnJ- ” ~
. r L â ^ |R EM iÉ R ^ ^ ^ ^® . la -plus drQpoïtante de toutes *
.parce qu’ e lle con tien t, fur fa première. fa c e , rinfcriptipn
^ r ^ ^ R ^ m |^ Me-j.temps> & les motifs He l ’ére6i:iî)n. de îçe
- - T I Ë S A R JE • „. ,
A # 4 ' - ï O V I - O P :T -U M
M A X S V M O . « S M .
; % | A V T A E - P A J R Ï S - I A C I
i> y B L I C E - .P é . s I E R A A
luere, danstmeL'éftré quAlfecï^it fur ce fujet a Madame la DactôlTe^d?@ît'
4âns fdàiélriere._Æ. Baudelot fit une reponfe à Leibnitz, qui fit^xm'e r ^
plique' tiès-longue, 'fui'yte d'une fécondé 'réponfe ; mais comme Léibnitz
Wâppctqïï^ueTon Adverfaire, peu verfé1|fï||jps Antiquités Geltiq’ucs, s’écar-
*tpit il-dbandcmna^'tt^^U^ell^p.ôuBférlivre^âf^^m^^
tâtions plus pfëfqfiMeç^VM'- EccattM6imprim^|^ÿi^ièfe Lettre- de Lc'ib-
|pSf§Favec un Recueil deCÀirioJiiés Eÿmologiqu« du même
f^^^py'î^i’l'regrfetf'ed&n’âvoir pu dônnewqûïës’iles pièces de part & d’aütrc.
M. Moreau de Mauxour^qffi\^bUà;f^Djfire»âtiÔh ’^éçSF|^;ra'*mêmè-
^é’mpéta^^çèlle 'ge M. Bdudèüt -,' doiîmbdes^/defi^s iniins /érimhes^mlis
•peut-être plus confbrjnes w&êè&Vité dans des bas-réliefs depîërté1 tendra,
■ dont.le temps & l’humidité de\la terre -argent altéré les contours, & f |
-Æ>nîf voit 'd’ailleurs', -en corriptfânt'les";’tnîcnpfidfev^ûe M, Baqdélqt avo||;-
ajpb'tc 'des-, lettres f Porfginatÿ'.c^ a^ fle douBlè/îJ.oli'fe W,"&^qiî’iyen
atai$OTtfë Airïreu 'de'r«i^i»anXêitT^ü^çorame^
Baudelot, poùr’lés-.mnls^.dont^Iés /racînés’/8c 3^fen?flon’f 'mconnüâ y
vjj^SWft^autoui^enAtwve^iès'étymël^tësdan^l^^êc^ce'qni’l^fdffîmt
une explication heureufe ; il rie'traite les monumens en queftion que de
•'.cip^siôc dfe^yonnés quawéés.^tandis que M. Baudelot en fait des Autels,
/•^oefpŸeud dè-là o'cc^pn^d|^êxgliqüer;bffM^ôu^M paxtiètiferités dé la" Rpllgiofi •
d,es Gaulois. Les deux Auteurs s'accordent-nfièux fur le temps'de céHtfànu-
'mens du Paganifme des'Gaules, qû’-ils.prétendent l ’un 8c- l’autre être les plus»
précieules antiquités du pays; ils penfent qu’ils ont été détruits & employés
. aux- fondations â'e'TÈ'glife Notre-Dame , fous-Childebert I , 'Roi de Paris,
fuivant-un'petit Poëme de Fortunat, //. If; mais M. IMMé de Vertot fit voir’
"'■ quëiJles 'vers de -Fortunat né pouvoient yéipjpl^a|r iqVi
Çeft-à-dire 'félon M. de..’Mautour ; /e; r/tf *
-/eJ r/e 'Êaris, ont cenfacilé
■i ce M onument .à Jupiter très^b.oày très grand. M. Baudelot
ppé.cendoit ^au. contraire que0 fansv choquer le génie' de la i
^■an^i^^ ^ i ^ ^ ^ p ^ lM'er.QtdInairev^sfofolii^Rns^'Qn nè
pouvoit traduire ces mots Tiberio Caesare A ugusto , par
ceux-ci 5 yb«j /e ûfe y mais j
aBtie ^e^irffcrip^i'on exgofemé®W.tif
Vqïïï la fit é r i g e r& qui n’.efl. autre félon lu i, que pouB
rendre .grâces à Jupiter de ce que Tibere après-un refus^
fo n d é , avoit'emfin accepté. îe ' titre d’^z^/^fe. M. de
Maùtoiir.explique .lq^ÿ?[|)cs, .Nç4ütæ B jjÉiiMMtoàDles Ba- ’
teliers, Matelots, Pilotes des ports de Paris & de toute
M. Baudelot, bièn éloigné d y.reeonrf©ûtre une vile populace
, rappoite quantité d’infcriptio'rfs ^ par lefquel'l'es il
merçans j des ’ Magiftrats ra ê i^ s P ,qui avoient l’infpedion
des voitures ^ qui y faifoient charger des marpbajfdifës
pour leui com pte , autant que pour celui* d’au t iu i; .Ôq^que
des - f eiÉ---'
’iirà-mdt^ échappérà, toàs ■ céuk- Qui’! r.Qntîfc'op iée kelwî
^ A ram : mais s’i l y e ft , il n’ y produit aucun changement ;
.& s’il n y eft ,pas, il faut néceffairement le f^ppléer. Il
•ifemb’lé ^nCe fféip^^ ^ ^ ’éM ô ^ e^ le s É ^ & leM é i ' A R A
avant l’M de la'tiEoi-fiéaTe'lig^e. Gette ’M• efl furmon*rè(ê
sn^res lettres* qm^ erm iQ e'l-in^ç rign^^ ^
tiaiij eft en l’honneur de Tibere ; mais*©. Lolmeau croit
;>.qû^elie . ; f e n y ^ ^ n ^ ^ V ^ g u ^
fonï ^ p ÿ n e fert là que de date. Cet Hiftorien 5 'qui fans
nf '
en y eA lpirlë .;j
^ar, Ife
y fameux-'Hëros
J ’EglifeSaiflte-Croix-Sain^ y i^^rv^riifuegdépuis feus lé <non^d^â/nt-
Gsrmflin 3er PrZr, que^dans^es S«wt De«u , £c73ll-a-.dire dans lan
> î i , il y,efi parlé d’une Eglifc que ce Pnélal avoit fait ll>àt'i^d^^îiîi^‘de
"Paris j &'qû’jl faut remonter à cette époque l’emploi en matériaux de ces
débris du Paganifme, 8cc.^S8m
Les différences, entfê"]les deflins de M- Baudelot & de Mautour, tant .pour les
Tnfcriptions gue pout les 'Figqres, déterminèrent le cclébre/ D Bernai d de ■
Montf luconSfdire'deffincr exaélement ces quatre pierres"fm les originaux, p-our'
1 ^ 'in^rer'avéc dne ipuvelfêéj^i^^^ Anfiquiï^Si rnaï^piLobinèau,
$ Pdhs, ayant ren^arqqé'qqeje-d>ffin,,(iu'
r^ ^ ^ MofltfauconWoitl^ ï ^ | m^ ^ i i à ^i?Qré, Marchariti|,a':E ^ n ^ & ,
Pelletier ; il hê s-,eft?pa^èo^'tèMé|qe^'E^ig'ures/dqnjiéesj parles autres,
w 'f a c î^ tg n e les origtnanx étoiept confervés 'dhru lejietic Cloître !Ême^.amè, $l:
lés a vi'fités avec uaDe^nateur ^ ^ ^ ‘Àpr^s'les àvoir 'vus, examinés 8e
^ mefure's, ïïles a Fait .dellincr & graver dansfrexaétei,vérité; il a .joint’liu.Éf-
gurc de cinq autres merres.tlc/uv^. à lf memé éndroit. 'bette gravure eft in-
féféçà’ la tête de \'MiJ^rerüiR'éruP\jfèc uheyVongue DiJîerfdtîü#fu,'^nêmç
‘Auteur, chargée d e ^ r e u ^ l^ ® tw n ^ ^ ^ © r e ^ Q n y m ^ ti^ ^ ‘n^a:Tett^
• % ||h |^ ^ t e /0itfbïJ<|ub, en faveur d’un monum'ént 'fi^ora^^très-piopre à
! t'emplir lè '^m ^ü iy fé j ttfflveÛ céfte Epoguefè |n s rBffîii»Je Paris. Nous
aSnnerbns'nous-mêmes . c é s ^ s T f e ü |^ ^ '^ s ' autres monumens dé çêttp
‘Gà'pi'taJe.. ■
/ ( 1 ) ' UInfcrijfiion dont il s’agit fournit plufieurs ■ remarques importantes»
/S^BÏl^l^^^âbdK^ue la Lân|tre^m'Én^ére;if déjà-vulgaire dans le
Nôrd’^ds^G^uleV dès les premiers Empereurs , puifque les 'Naûtes-Panfiens
Vemploient dans'I’éreéhon d’un monument public, «c^u’ils fcferVçàt des carinf
sm m m R r
g.oi'^our>' la .
a> Toifon d’01? On (Tes! â|^^lfe tous yf7^o/zrz//ZÆ.
» Quel honneur p our les Bateliers< M|âyo’ir,itari^de'^^nM
»Dieux pour cotaapagnpns dan§.l|ui.,p^feM©n'»»■! Cette
;^bii'de, * irbrii'^ân^^ ^ ^ ^ i^gp%nt ' de rAateéc ^ ;qui a
■eonfaoré-, comme M .Leroi, lamajeja-Ee'partie de fa Differ-
^||i(èn va-, iparbu^ei^ -qiufe'lis 'Naiutes ^% l |s ï i i®5
corps ^politique cle-''N'égocians ëii^és par l’Empeieur 3 &
qui a^dâWé1 naifànce à On- examinera
-cette queHion- âptB's l'a defcripti'on de tout ce monument.
£ T* Les trois autres -F<2c<?j de la première pierre dut' eft
l’infcripcion ^ 'repréfent-ent■. une'VfaLk'é jd’àommes de /ro/b-.’
âges dCvdléjlats dljfârerisiLéfprfemierSi-forit d’un âgé aVa'^^^l
rqmç^ti®^MT^d;ârmes Baûfix
“plutp&ê'' e’iM ^ i^ ^ d e^ É lle s^ d e^ c h ê fte^ p^ ^ ^ p u iy , av^eç^
un maintien ' grave &' dés' habits de«dignité ^ <fur lefquels
i’I s’i^f&^upi^oir entrevu des>.Band^s.,:,âi‘e pourpre. Delà* '
l lp lp
,riom-e;lies mots SENANI W IE IL O M q u e Léibnitz ,
tînterprete^p'ar. èe^tmQtsb Habit ans des rives' de la Seine 3
fur l’ongina'!. M. Ècca-rd, Editeur- de.'Léibnitzÿlènd cette
Jnfcriptien par les JVizi-'^ïZ'/fKrj- ’r/é /rz vfei/zi?j'qui ont érigé
- r a u t e U .L ^ ^ M # ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ü R &L* c l f c d te s P P . de;;.
Momfeflucqn ’
de l’autel' que xtrdis' figures .altérées, où l’on ne voit ni •
barbes nif couronnes, il y relie feulement des marques de
J^inf^i^^tfde:cetèe face pOTÊ^jf
faivant M. de Mautour & Loriginal-, Senan'Iv Y&mPi’mais"
en. -
K 33
>$&$ M ^ ^ ^ ^m q ^ l| / q ü ^ V a c c o rd a y^ (3ï ie f des
de* la ïeco'ifd.êJ'
jmûr'| to'usy
un f f i ll>: tête iÆ', bdnrieêî,'
^g|^bd)
^qr<Gl‘e ^ p :» ^ o ^ l i& i ]^ ^ y |® 3' ' lM e ^ ÿ ^ M. '
yd&ImutQT^'M^^^ffl’^ i c i . lm ^ ^ ^ ^ ^ F & c m M ^ i l l e ,
d’Hieres', Colonie des Marfe illo isj -''ma^
heureux ;?%^fcq6f^can^;lây' langue des', Breton^ déy_
( 0 ’ ^® fM p ÿ f§ q h e^ le g r à à d 'c e r c le
^ ^ p | | | f^ é g æ J u p k e r '-tr|s’-grand,;à|nLM
éerclé.n^ëfabit'.pâs arréèer^
iès: ÎL1. ^ V *?■ ’*7 !J.;.r’4’ ÿ'r. l:y~ 1J.‘
w | te ^ à ’ A . ’1 v'! *i ‘ A v^ i 1 -
E . ,* S r S ® ' s ' i - ' 5Î t S n . r H S
I it ï de .cecte form .' Cnfii , m^lcroifiéme ^ ‘ i. ‘ ü
F ace de l ’au te l, on remarque des jeunes gens fans barbe,
ail in i 1 6 " B'V ' 'n
K-sAjïlvjyMuaMjj V cÆ . i i e e j ;u ÿ y î^ ^ . ’tj»
de leur côté. M . Ecc: -I fuppofe que c ’étoient les dïfci îles
des j ( i rVar: 'qû’on 1 1
1 it I ; mais on i 1 jà. L j. yé ue r 1 , ellampes
marqu ' .diftinf iv e'1 le 1) li le , ce j.u’ inln a , :-■ re r
Æ ji \u u* l ' - r r ; f i - , ' j d i i i ï ï , i * - ,
des citoyens par les trois- âges '(a).
i a ' SECONDE lJÎÈRRC'qîii a u - e lljfy lj 'l.j.jy 'id u ^ l.y iV e ’s
'li3 J . i i * *',,é’n f ^ j l " , r..' ■ Jo.v'ùÿ'
ofFre les figures en plein, mais .q u é 'le marteau, l'injure
des temps ôc les fels diffolvans de la terre n’ ont pas
rafterésRgmcûns. i°. La Religion^^ivaln^^eu« 'ë^oît-Xdès-ÏÔra^à^Çoei 'doirii—
liante, puifque le monument eft en-l’honneur de Jupiter très-bon &- très-grand.
^^llilfeefa’ircit.'plulleurs points de la forme^Sc de'laj poficion 'des lettres j
’de l’olographe , &|Ml^^o^^^®^Wçiçnne?'On y voit à la fécondé
^ ^ ® R | * o t 'Ô ^ È ^ ^ ^ ' sl|^Ie^^^exç^de de bëaü^ ^M ^ alittèt
majufcules'; feioit-çe^càufe de la fymétri^qujgnrauroit aggràndi la-lettre du
r> ou Çour eoeg^i|ia^laçe du refte de la ligne*?, La même
raifon^ fô gçë,de rej^teM^âi^éffiraîj^o^mè les deux dernieres lettres du
mot Pojientnt. D; Lobineau, qui a donné.le dernier dëffin de '^êfêïiÉ©fâ||';?
non |écritiainïi4 POSIERV ' .
II^Ri^s^priliha^m’il dit a]ro|r'bieh,-examiné. îl^obferve^uSlVs Jdeinc: dcè% •
îuereslettres de ce mobn’ayaiît pu trouver place dans la deinièiè.'ligne, le
- Graveur les a îenvoyées dans ’refp^ce^ au-dellous, en gravant I’N avant
le T , que cette maniéré de retourner les lignes, en remontant de la droite-
|||l#gauçhe, eft connue 'des Antiquairèsy & qu’elle: s>pp,èllé;'ef^ep 'Bbuf-,'
trophedon, parce qu’elle imitoit le Chemiq de la charue, M^Wà^pSoâ^jV:
dans l^Jillqns pairs d’un fens contraire àjcelrfrdés^impairs.; ^.°, On remar- "
M^^Utre ‘déplacement danrlèsilettres I &
dans^l^^con^ë''fyUà^déyBo/ufriin^?^yt6uvëÆans le mêmé ran^S^^’oté^'
Opturijfo,' lÿlaxfumo, ÔC.l’^de ceÿ.deux mots a 'palféidans le verbe Pq/iei-w/it., Au '
relie ce n’.cft point'uivbaijbàri'fmei;jcc n’eft qu’une expreffion^^^ ^ ^ f i V^
d.ont,on BX^bbn|oit. des' Gte^;c’éft-à;-dnè, t
pour le ^iftinguër del'l'ü, diphtongue , qui doit le prdnbncërfflOTlIèv^^afit^
• '0ntfJUC0/>^|'ferp'què; VftftfÙohqu£les Grecs mode'rnes prçnWèènti.
Ipjilon, eft fouvent changé^en■ ,! dans les Infcriptions, comme Neptinû pour
:Nèptuno y &c. 8 ^ ^ .V
(i J Léibnitz avoueNquc'Ic mot Gaulois de l’Infcription ÉurM s
qûi'ne wemgêcfe p»s, déife' mérfdàns|'d^i. ëxij||a8bnsf|
ne Peut manqueW^,^rtr^^|ebhan|p. à î^ c^ d y^ fe é u r .Jw i^®
quèle ^jPlufieydü^oïyGéltè.Eùri^ÿ.què’Dflyîejyd
f''Di^o^n^'Camirreà e^fi^eÿR^Orfé^^ddyucr^çn'métaux ; 8cJ^nt!>
\‘®^eiYtaâis'îa graçde^a^^ç^^e;^o|^^^cM^frSérs%tï^
H'dîavoüeK'-qjie, cej- foit. unp,^^£ô)n^e»i|ir unèvfort piaifante1 imâgnatibnVifr
circonfejènce; doil ^elrè- 'formC
Ha^^^ ^ ^ g ^ MftfiWcercle eft?de> lig^^mlfD>.Bofeméauiii; om pourto'îi
J^MonTv^üVent afféz^qmiq^elpquÿek-fàir^ badinage
^fep'^dèlTefni ' ■
^^cGijons<e|co^ une réfîéxion ^dv^D\Loii>ifaü ^ voici fes'^te/mèsi' «; Les
» troisj^fàces,^^-meréeloù eftIfm&Ktr^i#. égreféntent une efpéce dp Pr*
éctlfidh c9ttiPmh '^lmw ^ ^ ^ ^ iek%Séretis Autrefois au
N docle Auteur de l’Anrijairé des temps rétablie, de prouver que-les Spartiates
étpient defeendus des Celtes par plufieuis raifons, dont en v,oici une,des pias
dëmonftrativés ; les Spartiates aimoienc le lard ; les Bretons, rejles des anciens Celtes
l'aiment auffi,, donc, frev L’infpeaion‘de’ceftê pier-rc lui auroit'fourni un
argument’bien.iplus'.fort; car voyant cette Proceffion de trois âges" différens y
dont le plus ancien eft fans armes, 8c les deux autres-fonf armés, ilfe^ferolt
relfouyenu d’uiw'pareille Monjlre ou Cemparfc décrite par Plutarque in Lycurgo
soi'i les vieux'chantoiènt :vN
. Lès hommes d’un; âge mûr ; • ,
Et les jeunes enfin;
y > un parallèle pareil ne feroit peut être pas
entiercrùënt indigne: d’attequorè »y