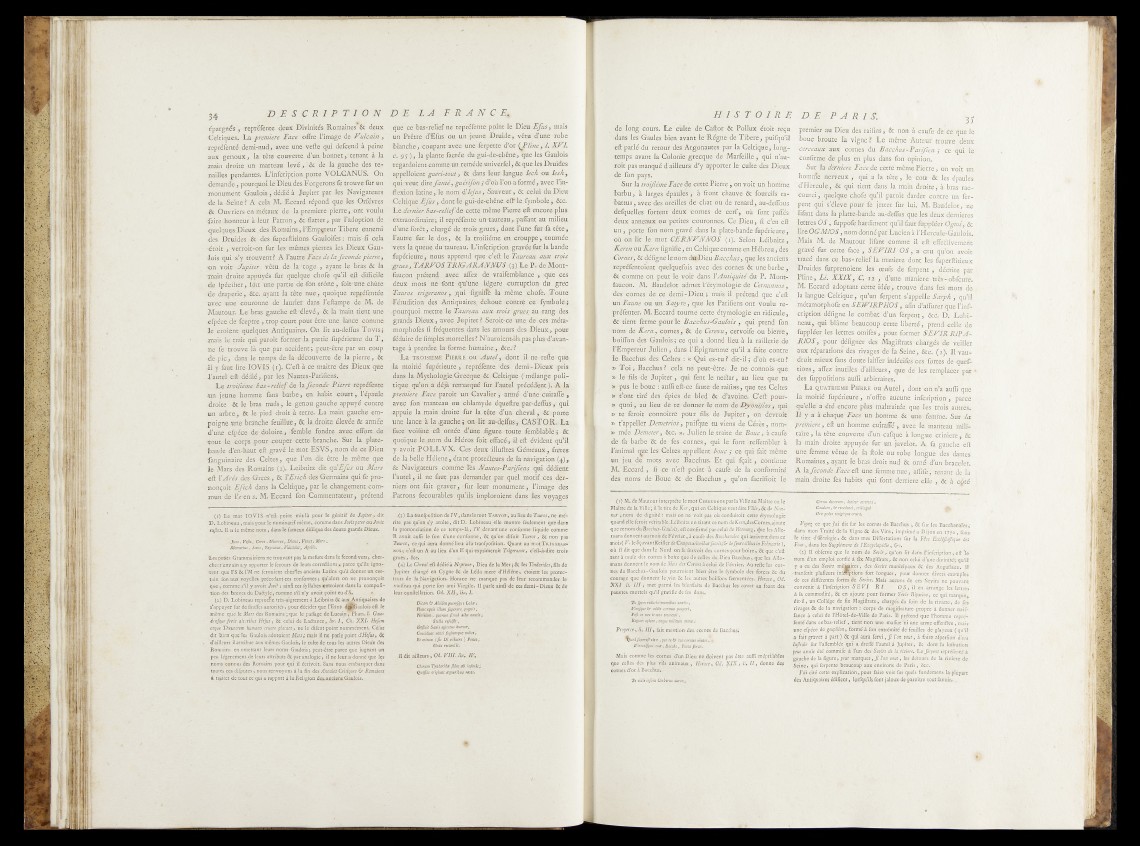
3 4 R i’ p 7\ id o '<x
Ipai-gr-il's j -.repiëfeiîte üeux Divinkés*-Romaines & deux
Geltiq-ues. La premiere la c e o-Ære l’image' 'de FuLcdin,,
|p l i^ e i ï d
aux genoux.., la tête couverte dunll^oranet,1 tenant à la
.main droite, un maiteau levé 'de' la gauche des tenailles
pendantes. L’infcrlption^porte VOLCANUS. One
monument Gaulois ÿ fld ié à Jupiter par les Navigateurs
de la .Seine ? A cela M. Eccard1 -répofid' -que les Orfévres
./V 0îiy,rip.rs en métaux de la premiere pier-rë,' o n t lM a l
^aire^Wôn^éûà'à4eur
^ d e ^ R b i^ n ^ ’PErnpifeur T d b ^ wë‘nnemi-v
• des Druides. 1& des fuperftirfQns< G^^Jres": mais -'ll' oela
'étoit , verroit^jgnfïur les mêmes'.pierres les Dieux Gaulo
is qùi-Vy trouvant l A J ’^ x ip ^ ^ c £H ç 2aJecQàde pierre,
»on voit '.Jupite r vêtu de la*5 toge’. 3 ayant le bras & la
^ ain4ÿoi|^ f(a ^ u y is ^ ^V ^ e J1^ ^ ç h o f é e$ difficÿlë'
de fpécifier, fo'it une partie de Ton tæônç, foivune chute
He draperie j fitc. ayant la »tête-nue, quoique repgréfentée
# 3gee ? u n d e t - l a u r i e r . daQ^Jjaftampe de .M. dé .
MtiûtOuK ' Le -bÆ^wgât^n^êii^levé.j^^ilS'màrn. u’n ^
.^ f p é c e jle |f ^ ^ p |^ J c ^ ^ ) t) ù r " ê tr e -une. lanée^^rnmë
le croient, quelques, Antiquaires. On lit î^djffus^vT o vis ;
'menais f< î® ^ la .-p àK i^ ^ p ^ ieu 5^ n '
ril y ïàuilirVTOYl£ (i)«jj§igff a.çè
-l’autel eft dédié j ,par~les Nautesr-ParifiênsûT~ -
- - L e oerpifèegig'îas
[§®
droite &: le bras nuds^ le genou gauche appuyé' contre
à ïen j^L a
poigne une branche feu illu e , & la droite élevée & armée
d’une, eip'éee de doloire^Üerable .fondre avec effort de
^QUtàde^coçps - p If* J a p^ace7-
nom'^e RSll
ié ’IÉiti
■ GŸL Y^Arès à é .s ^ i^ J - p L V E r ic h
Iv d a toit 'Efich \d |n | la Celtique, par le changement _com.-
Mul^iîi.|Ç?eS£ ^fJVÿ^Qcard fon ^ommenfafeur^^p^éteü^
f ) F R w m fflm M
^ùë^|$!^sfrèfe£.n:e ‘repr.^ent^p^îk- le, Dieu
' uni PrêtreUd^Efus fou un feunés^E^uid'e^v v l tu :©i;e
c. s>S ) ) la plante facrée du gui-de-çhêne , 'que l'es Gaulois
regardoiont comrae-un îem'éde univeifel1, & quelles D ruides
dans ieui^l^nguer^^- owjlesh.,
| iquiweut d k e jîm te ', guérifon ,' d’où l ’on-a formé , avec l ’in-
Celtique E f u s , dont le gui-de-chêne eft? le fym b o le , ôcc.
i D e tfërhiafya,s-relief àv cet-te même Pierre eft encore p lus
• e-x.tràOrdikairè'i il repréfente uïr:tau>reau, paffant au milieu
d’une fo r ê t, chargé de trois g rues, dont l ’une fur'Pà tête*
l ’autre'- fur l’e Bos||fc ô& 'lav;troiftémè^’enf^pu^ pe Jj^t0urnée
*vers la queue, du taureau.'L’infcription-gravée fu<r la^ban'de
!g |^ R ^ ^ ^ ^ ^ o^^pp|ejid;'\lie^^feleL<35z«rga«, auâx-troffi
igruesj T A R F O S T R IG A R A N M 7 S (-3.) L e P-.-*de M on t-
; : f à l i g l l p f î e z d ^ S ^ ^ ^ à n ^ ?v: fes
deux mots ,ne -font qu’une, légère corruption du g r e c \
' ■ Tauros trigeraizos y ;qui - fign i^ l a même cliofe. T o u te
«Ü^ru^itipn d e s^ A n tiq ü à n p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t^ ^ e^ ^ îiï^ p 'l^ ^
m è t tr e - leÆ w g g^ ~ aÊ^^îzoïs^fréèsiWL piangi i l s ,
g r a n d sD ie u x ,a v e c J u p i t e r ? S e r o i t - c e u n e d e c e sm é t a -
^---morpkpjes 'lî- fréquenfeès.'d^^l|s ramours des ;©ieux.^ pour
>3|duijevqe^fîMpés^or-telles ? N ’éu fo fep '^ â^ g a s^ ^ ^ d ^ an " '
" .ftagl'î a
^ L a troisieme'.Pje p Ie^Ou " ^ 2 ^ 5- d ont'.if'n e -refte'que
-ÿa -'i ^ P ÿ ^m ^ B i^ r é ^ r ÿ ^ fê n ^ T d e sK d e in ^ -D ie u x «pris
d ansl|5i^y^Q‘fôg4^®|^|âüe^k|i<^elt^üe/{|m^rigé'}p 'o l^
tique qu^on a déjà remarqué fur l’autel précédent ). A la
.; ^gOT^>g.,'^^^ïp !af(^f^Unl^alfaMer^a^^1td lg ^ ^m fà !W r>
avec fon manteau ou chlamyde Iqueftre par-deflus, qui
^ppjïirpHa'fm a i n ^ ^ i t ^ ^ M | ^ ^ 4 ^un|^cheVaI-À&^)orteI
^q^mqu^l^ m ^ ^ ^ ^ i^ o W d M e f e ^ ^^e ffi^'id ent'-.quU l.
y a v o i t P O L L V X . Ces deux'illuftres Gémeaux., freres
(4,),
N à y ig f t e ù r s ^ e q r n ^ é ^ f ë s j f e ^ ^ l y ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^ ^ M t '
l ’au te l, il ne faut pas demander par quel mo tif ces derniers
ont fait graver, fur leur monument, l ’image des
^Patrons "fècourables qu’i|s^implioa:bie|it .dans les voyages
;(^lfei^t^<^r-S^p^^p’OTpt,-^isîla. poMjïI^pMti^e 'jupiter^àit
fD.- Lobnveaa;, maisppar îe-n0minati£-.mênie, comme dans Joyüji&ei^aiJoiris.
-cuflos. Il a Je mêmé nom, dans-le fameux^M^tw/dW douze grands Dieux. -
- Jùiu, Vefia, "Cerej, M'merva, Diana,-Vernis, Mars . -
. '' :Mercuriusi Jovis, Nepcmus^tiulc^nus;- Afollo.
l e s petifs.Grammàiriens ne trouvant pas la mefiire dans le fécond-vers, cher- __
chenr envain a,y apporter le fecours de leurs correfiïions * parce qu’ils jîgnc|r
«rent. «ïue.I’S 8c l’M ne fervoient chez*les anciens latins-•flu’àJ'dQpper un cer-.
tain voyelles précédant ces confonnes ; quïalors on ne prononçoit
i ainfî ces fylIabes*ntroient dans la compofi-
' tion des brèves du Daftyle, comme s’il n’y ayoit point eu d!S. t ,, f ■ .*,■ v.' ,
(a) D. Lobineau ‘reprôcne très-aigrement à Léibnitz 8c au^&htiquairçs de
s’appuyer fù^m^çiTes'autoritésy pour décider que l’Esos dgfcaulois efl; le
y;inêm^cm^@îiferi’jdesRofnains;^ueIe'pa£^e^e»laUcain^Phars.r ^Gau-
icnfque feris altarièus Hefus, 8c celui de Laélance, liv. I -, Ch. XXL 'Hefum
. otque Theutatem kumano cruore plaçant, ne le difent point nommément. Céfar
,'dit^bidn?qtîe les gaulois adoroient Mars; mais il ne parle point d’ife/ùr, 8c
d ailleurs il aw^®a’ùx' ipemes Gaulois, le culte de tous les autres Dieùübdes
Romains en omettant leurs noms Gaulois; peut-être parce que jugeant un
•£peu lêgerefnent^de leurs atttibuts 8c par analogie, il ne leur a donné que les
», noms connus des Romains pour qui il' écrXvoit Sanç ftousrcmÈàçqucr dans
-'■ tgutêsjgë^flîfBRteSj nous renvoyons à la fin des Annales Celtiques & RomàifUS,
à traifêi.'dè:^ôut^etqui à-rapport à la Religion des.anciens Gaulois. ^
_^jjJiLa'tîanfpo§,tion dé rv*f 3àriï-Iè-m'& t ^A^y&V^àü!,l^i^eïai»,o^,;ne^md,i
rite pas qu’on sjy arrête, d^^^^pnn'éau elle montre-Sfeuiémenfr^U’e dans
la pronondation de ce temps-là, l’V devant unetidônïbniïê^hqmcie comme
R avoit auffi le fon d’une confonne, 8c qu’on' difoit Tavros, & non pas-
!P«urw, ce qui aura donnëlieuRa*la tranfpofition. Quant au m ot Tr i g ar a n*
Mûs.;\,e’çft'un A au liéu d’un^E; qüi'éîÇrimerqiPTrçera/ioro eft-à-dite trois
îjrup^8cc!^^|
| i g i^ î Ch^^^éà(é^Mipiune;0 in de la Mer;8c les-TMarides,&ls de
Jupiter changé en Cygne 8c de Léda mere d’Hélene, c'toierit les protecteurs
de la Navi^ation. 'Hbrace l e manque pas. dé 'leur' iccomïnànder- rIe'‘
-vaifleau-qui porte fon ami Virgile. JI parle ainfi -de ces demi -Dieux 8c de
leur conftellatîon.
Dicam 6- AlcÈtn putitfque Ltda ;
. 'Xmcïqw itlumjhperart.pugnis, ' ‘
Noùilansquonmjmul alba nautU;
lM
•iMluxc Saris ajpunu humor, ;
'i Concidmc venà Jupumque nubes, .
Adit;; ailleursi, ’Od. 1 ^ /. Z/V;^î^o 11
^i'<^fiC0Tm TyhilàriàiB jîdus‘al>. infirnh;
■ • «ua/fli cripiunc gptoribui-Wtt. ■
> i K m » T i w £ M â -
de long cours. Le culte de Caftor & Pollux étoit reçu
^eft/par-îé du retour des Argonautes par la Celtique, I©ng-
^ i p p ’ a™t' |a • MBaarfëS y ;q u f ^ ü -
• roit pas manqué d'ailleurs d'y àpp©iter le culte 4es Dieux.
Sui la r7oj/?<?W Trzce de cette Piene om voit S h’Vmite
barbu ^ à larges épaules, à fr©nt rcliaave & 'fourcils îa- ‘
'battus /
dëfquel-lës fortentvdeux ' tornes de cerf^^a- 'font paftls-
deux anneaux ©u petkel couronnes. Ce DiéiijÆ'c^en eft
un’j, porte fon^^nî gravé dans la plate-bande fupérieure 5,
où ©i&l le mot (i). 'Sein Léibnitz,
'Kerèr$ixÆ:£rri fignifie, en Celtique comme en Hébreu, des
Co;/zcj^ & défignelenom di^Dieu ^rzcc/iKj, que les anciens
repréfentoient‘quelquefois avec des'cornes & une baibe ,
& comme on peut le voir dans VA n tiq u ité du P. Mont-
faucon. M. Baudelot admet l’étymologie de Cermirmos,
■des1 cornes de ce demi-Di'pUj ; mais il" pré tend que c’eft
un Faune ' où u-n que les Parifiens, ont voulu re-
P ^ fêm e r )^ ^ ^ p ^ P a ^ ^ ^ ^ tÊ p ,lw m d Ita g ï^ |^ id ic u le .3
tient ferme r ^ ^ i\^ B â c ^ h ü s ^ aM o& s , qui prend fon
^a'@ni'de A!er/z? cornes, & de ^é^-z4 çè’Èvoife' ou bierre,
iboiffon des Gautois ; ce qui a donné lieu .à: la raillerie .de
l’Empereuc Jufièù, (dans1 fEpigtam'mè' qu’il a faite contre
le Basccbus des' Celtes : <c ^ û i es-tu ? dit-il ; IM||;ïlëfïat
Toi j Bacchus ? cela ne peut-êère: Je “né^tcô'nno'is-^qu'e
» le fils-de' Jupiter., qiûi fen tle neélar} 'tu'
» pus le bout : auflîeft-c‘e faute'de raillas, que tes Celtes
»-•;tÿnt’_tiTé des;-|piics de bled & d’âvôinfe. ;i^ ift‘-',pôu.r-
» quoi,-au lieu de te<donnei le' nonï de qui
» t’appel'lêr Demeirtos^
y.
de ‘T ^ b ^ ^ ^É ^W eV ^ ôm ë s . '. ^ ^ p ^ ^H t^ e ffem b lè r^ ^
l’animal que les Celtes apjà|lilent ^o«c y ce qui fait même
un ieÙ 'ld ^ n i^ ^ ^M ^ B a c è ft ig g '
M^E.èèâfd fr 'tse .n’eft point a eaùfe 'd'e’ la' conformiez
^des^ rîoms de Bcmè '|ôGM^^ecnùs^^^or^pCTffi(5rc^^-V
\D : V M y t R - f t v m
^ l a ^ g a g y y jê ) feâïîfe A u teu r o r o ^ e ‘deux
‘ ''fenfitn^BBiCTilrs* dauji^oWâM'liîün. ,v\ '
^ u e :^ ^ ^ p ^ tn e ro% ^ p i& > -yGù>vôîè*ySi^
J’u o w ^ p iW e U x , H r W '^ Ç j f l é t e u ; & - fc s épâullsl
®nfolà Jmaih artute Æ&lpïasJ^c-
Stjfâjü uii!'fe rsr !!
” m W TOu‘o l™ t t r o a t e ‘ lui. M'i
j 1 i - f ■ 1 î
j j i w f i p ^ - ' n ’ M i l H * s j .
à i ’HercnfesbJIldiif..,
Mais M. de Mautour lifant comme il eft e£Fe£tivemenc
g ,™ i.;jl u j iRfJ oe £oe m P i t f ij
. tweé dans ce bas-relief là toaniere dont les fupetfticicux
Drui es furprek. ent les et fs .< ’ i» < r ,■ dderite H
L -', ' l î^î r '■ if-a ti' 1
- 1 v h . î* *\k r y.> » 1 IV i , ■ t j
^ E H H s a H ' ' * 7 4 ' 11 v r *
criptioa ddl g le 1 . e o s f e 'd ’un 1 :tf t» icc. D .
lu I e‘ 1 ) ,1 i t ï | v V ^ V r l*H L \ i *ï*
^ V ' 1 ^U lo r 1
s o, i i l s u ' > , r t l 1 15 ,i , \ 5 Î ‘î
f ' «ST1,V| V u f te-
® n ï fe S ^ a^ e ÿ lpÉ •
le SO :ié 1 ' i u r e , i E e au i inferif ion , r .
à . y f e a-T B y S -.i l- tS V r I f- it - ^ Ij(> î ’ ” ï u C<_
I I y a à chaquè un homme & une femme. Sur /a
premie. , eft un homme ce il jfl , y ^ V ,‘,‘‘i m.a;i ’
taire j 1^ tête *J i t * t i fque à longu ci i
^ ^ n M ,bit&''appuyde.ifû\.- l|n ^ |v a o t î % i j
l " f vmÎ*1 ^ ,V 'i i } j | p j-X*'1’ "U 1 ,
Romaines, ayant le bras droit nud fiç ornd d’un bracelet.
A Inféconde f a c e eft une.femme m ie , aflife, tenant.de la
i un 'droite 1 > habite qui font d - ie .éll , & l c è té
(i) M. deMàutoar interprète le mot Cernunsos par la yiMàji Maître ou le
Maître‘de'la Ville; ille\fire,dc Ker, qui en Celtique veut dire Fïüe, & de Non-
7itrr , nom deàmgnilé : nfais^ôtn^n^ voit pas où conduiroit cette>étymoIogie
quànd'e^êVle^irvëfilàblë.'Èéibnitz-eflgtigànt ce nom dei^er/i';des©0rnes,aioute
quecenom dulBrtcc/iuj-GaûZou,'eft crafirme par celui de Hornungfmie lesAHe-
mans donnent au mois de Février , ^aufênès Baccêanalfî qui arrivent dànï'ce'
mois( F leSqav^ntKcÙ&r'd^^mpofâlombusfacris;É> defpure'ihb'üs m Februm w ),
j^MÎl1- dit qjiè'dans le Nord', on fe fer^oit des cornesspourboire, 8c que c’eft -1
fM^fâ’és-: ëô'rÙM a: Dorr^ffî^q^ai^dii-Dieù'Bac^^^qiie lesiAU'e-
m^svdOTn^me^m'de'' Mois - dês^Ço^^^mM-àe Fêyrien'||prèfte Ies<corJ'
nés du^Raoçgu^'GAaulo^ppuiioienc bien' êtfeslc fymbole dès forces ,8c du
courage que doiîiîeiit le,vin 8c les autres"boÜTons fêrrh'entées.'i’^wace, Od.
XXi ■ J&ÈÊ&t- i d e s ■
paùvrcs mortèlSjiqîi’îl gratifie de fes dons.
' Vircjqut b" addis cornua pauptri,
R^uiïafrçes arma ;
R Properre, li^Sï'^fait mention des cornes de Bacchità
^ -Mais comme' lés cpr-nesl M’ûn'.Dieù'nepdoivcnt j>as être auffi méprifables;'
que celles des plus ^Us^ammaux , H t o a j j g à j m ^ X l X dés;.,
cornes d’or à Bacchüs.
'i ^ & îjcedpti,
M VoJ&ce > Ié^%^ft^f^ë^B^VcIîû^ÿ;8î^^di^^^BàcÿïiarfàIeiv
dans mon Tralté“ des VinsMmmmi^a-DjTon^^en^irvô^aMy
'vurtitre. d’OEnpli^ie,. 8c dans*mes,^^^^tatibW,' fuf la Fête Ectiifiajttque''desfi
^^ia;yàgTif§^fSü0 ^me^Ê^W^iêlofédje&>c. .
S R H N ‘9 0 0 : ^ Je^s°Æ$é§,
^^^mrt^m^feconfi^-^^Magifir^fSj. &snn^éîûSStHlr divinif^^tt’xKj
m^feres, des^iSwrawnupfala ux , 8 o i .
^^^pî^^fieurs. inf«!pfions f o ^ ^ ^ ^ ^ ^ u r !Imnfet‘':dïvers exemples
ÆaeVces'diftèrentés' fortes de Sevirst- Aïàis^ ^ mÿ.de'^çeV'Séyîr^Vnë.pduvaht
*»con.VMir\ÿTin^POTii^Sj^K& R I arrange les lèttres
^a^^.conM^aiK?^^en|^ uteÆPou^ &)tm6i^^mr^Bjparios\ ce'qui nîar^î^,
ÿdft-ü«'uniCoHege de(fîx'Magiftrats,<diarges>Jdti
‘ rivages 5c, de la»- Payiè^.1i°Æ^ <g ^4e-.^^^rature propre à dohnennatp,
■ '^nce à.cefùi de- prétend^^Fiio^ïml5 referé^'t
,'Hem'é da)is'êé bas-relie/^txem-lnôimme malTue 'ni une arme offenfive ÿ mail'?'
''une form/^forir e!xtrémîté de^feuilles dèVglaÿeüx'(qu’ilj
garnit graver à part 1 8c qui àura^fervi, ’Jî'Von veut, à faire" aiperfion' d’eaù •
lujirale fur raflembléei qui{«Èidrefle l’autel à Jupiter, ’& dont la Iuftrafiorê
peut avoir été comini^^^mm dp^Swirr 'de la riviere. Le' fèrpenz repréfenté à
>*gâuché de la figure^ peuf'marquerapKlw veut, l'es détours;de la rmèrë-lfe.;1.
Seine »’-’qùi'-'fcrpente beaucoup aux environs de Paris, 8ce.
J’âi cité cette explication, pour'fairc^voir fur quels fondemens la plupart
des Antiquaires édifient, lonqu’ils font jaloux de paraître tout favoir.
i
ù
3 i l