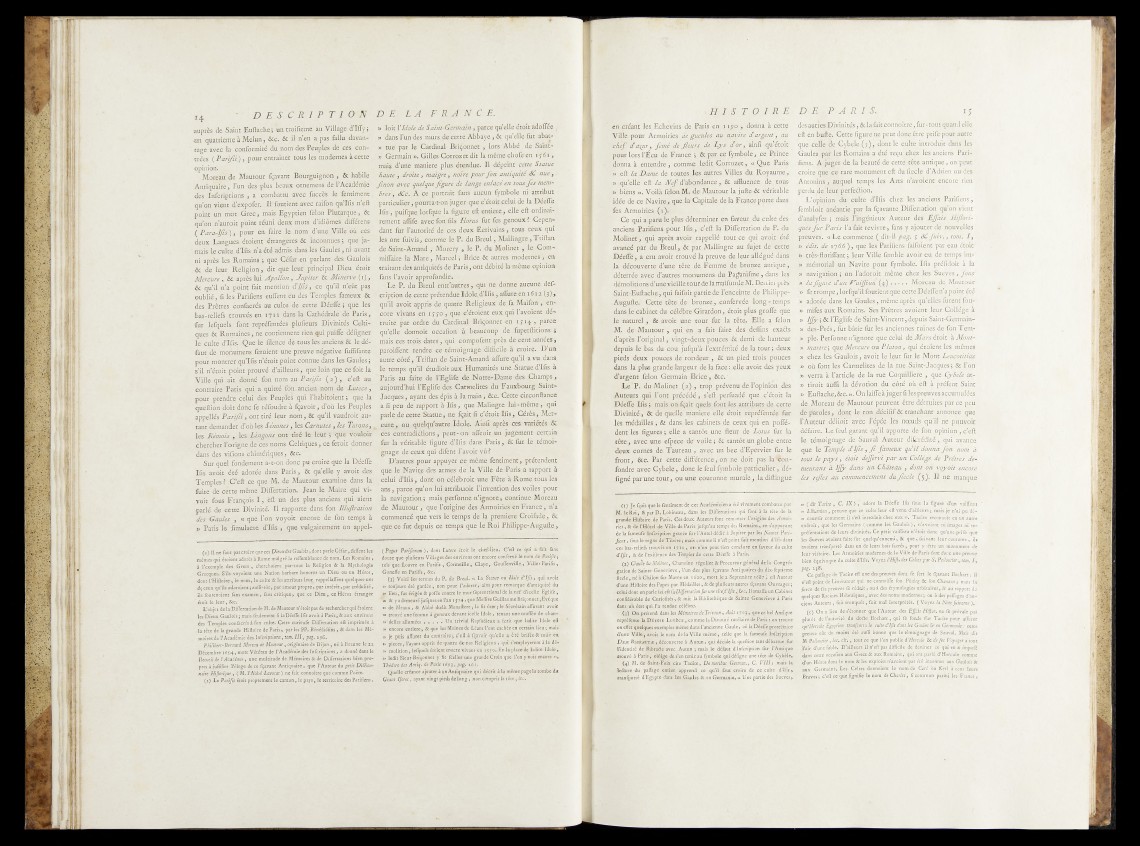
14 xi'* sfB Ê Ê B Ê Ê F '& 'T‘ 1 ■ TiWauprès
de Saint E u ftad ia ; un ttpifième' au V illa g e d’I f f ; , ï:
a n quatrième à M e lu n , & c . & i l n’en a pas fallu davàji^.
rage ar e c la ' eônfèirniicé'.du nom des Peuples de ces cont
r é s P a r ifd ) , po.ur entrai er tous les modernes à cette
opinion.
Moreau de Mautour féaVant B o u rg u ig n o n , & -habile
Antiquaire, 1 un 'des■.plus.jbeaux. ùr-pemtns■ de11 \ c i émie
dès ï ïfçripri Di S i â combattu av e c .1 i ç c è l te fentiment
qu'oft :y-ierk ■ ïé x ] ofer. J t fout ent avec raifon qu’Ifis n eft
point ,un n 11 G ; c , mais Ég yptien félon I te , ôe
qu’on i f auroi p o int'réuni d u x mots d’idiomes diffère ns
‘f Pa. a.-lfis jjyjf ou c '.en, -fa s e le nom d'une V i lle tSS--s&_.
d ix L 1 s éto iênt étrangères & inet nr Lies ;: q t ié ja -
'Siais :1e cuit d’Ifis n a é é admis dans les G au le s , ni ayant I
n i après les'E -omarns ; que G-fat en parlant des Gaulé:s
s L de leur R e lig io n , dit que leur princ pal. 1 > u éto it
Mercure & après lui Apollon ., Jupiter 6c Mu. v 1 ,
& qu’il n’ a point fait'ment■ ipn.id’rÿ&’îijGé q u i 1. n’ eû t [ j>
o u b lié ,.fi les P aiifi 1 s eüITent è ü 'd e s l f e t pies fameux &
des Prêtres cônfacrés au culte de cette D é e ffe ; que les
bas eliefs trouvés ! 1 171.1 dans la Gathédi le ds Paris,,
fur iefquels. font- repréfentées pluifiéi|rs: Divinités C e lt iques
& K pm ain eà ,n p contiennent r en qui puiffe défig 1er'
le cuire. d'I is. Ç lu e le lilenee dè tous les anciens 8c le dé-
f de nom mens fënéient- une p reuve néj ative fuffifat te
pour montrer q u lf is nMtoit point connue dans les Gaule s ;
s 1 n éc if point prouvé d’ailleu rs , que loin ,u ce foie la
iViilè'cpiï ait donné ft nom au P ar {fis ( 2 ) , c e ft au
contraire Paris qui a quitté Çm_ançièn n< 1 de Lutece ,
pour prendre celui dés P euplel qui ïh d b itd ient ; que la
qui lion doit donc 1 ré( > 1 Ire à fçavoir , d’ôù. les Peuples |
appellés Ml t tiré leur n om , & q u i V udroic au-
‘ tai c'dl manc er "d 1 n ie s d éno u 1 , les Ça nut r , les Turoi s , .
les Kern LSI,, les L in g iris ont tii é le leur 5 que d Ou lo ir
eherchei' l’ eiiinH: de ées noms Celtiques , c e lèroit'donner
d an sd e sy ifiû ns chimériques, Si c .
Su r quel fondement a-t-on donc pu e mire que la Déeffe
m avoit é té adorée dans P aris , & qu e lle 5 avo it des
Temples ? C e l t ce qu A î it Mau t ur examine dans la
fuite de cette même Differtation. Jean le Mair 3 qui v i ve
t fous Françoi I , êft un des piiis 'anciens qui nient
parlé de cette. Divinité- H rapporté-dans fon Illufiration
des Gaules , « que l'on voyo.it en o r c de fo temps 1
» Paris le fimulacre d'ifis , que t ul jairemeîit o 1 appt 1-
(1) Ii ne faut pas croire que cts’Dieuxdes Gaulois, dont parle Ccfar, fiiflènt les
même! qui étoient adorés à Rome maigri h relTem n - nom. Les Romains,
à l'exemple des. Urées , cherchoient par-tout la Religion & la Mythologie
■ Grecques. S'ils'voyoîent une Nation barbare honorer un Dieu ou un Héros,
dont l’Hifioire, le nom, le culte St les attributs leur tappelIalTcnt quelques-uns
de ceux qu’ils ador oient ; aufli-iôt, par amour propre, par intérêt-, par crédulité:,
ils foutctt'ôicntr.fans examen , fans critiqué , .que. ce Dieu , ce Héros, étranger;
étoit le leur
L’objet de laDifiertation deM. de Mautour n’étoit pas de rechercher qûi%pient,
les Dieux Gaulois ; mais feulement fi la DéefFe Ilîs avoit à Paris, & aux environs
des Temples confàcrés à fon* culfeVCette' curieufe Dilfértation eft imprimée à
la tête de la grande Hiftoire de Paris, par les PP. Bénédictins, & dans l'es Mémoires
de l’Académie de^tnfçrip'Mpns, tom. III, pag. 196. /: '
PJiïlib'ertrBernard. Moreau de Mautour, originaire'de'Dijon^, né_à Beaune le zz
Décembre 1654, mort Vétéran-de l’Academie dès inferiptions, a donné;dansi)le
■ Reçiieil-de VAcadémie , une. multitude de. Mémoires & de DilTertations bieiÇp.fp||
près à juftifier l ’éltoge de ce fçavant Antiquaire, que l’Auteur du petit DiSlion-
tune IfiJioffqu£,y C^M.l’Abbé'iLayocat ) ne fait .connoltréquc’comme Poète.
> ,(z) Le Parifis étoit proprement le canton, le pays', le territoire des Pari/ïens,
L A F R A N C E .
" : ^ Sairit^£w%mrp i parce y
»- tue’ par le'Cardinal1 Briçonnet , jiors Abbé de Saintmais
d’une" maniéré |Sÿ-étgÙ£l'ue. Il- dépeint cette Statiie:
haute , droite , maigie , nôtre pmir fort antiquité SC nue , |
J înon avec quelque figure de lange enLapé en tous f e s mem-
è re s, SCc. A ce portrait fans aucun fymbole ni attribut
-M’s , puifque l©rf^£e'la figure eût en,tiei;e, «Me eft © ld ii^ /
'fêpèiM â®:fes ’
da'nt fur’l'5autorité ,<âev \ces deux Ecriwaifas , .tous ceux qui-v
les ont-fuivisj comnaê lé P. duBreuii, Mail-ing^e, Triftarî1
de Saint-Arnaud , Morery , le P. du Molinet ,
I fa ns l’avoir ap pro fondie.
-L e P. du Breul enuautres^q?!;ne1 donne aucune defjfalajglÉag#
paroiJTent, r|ndrê ce témoignage.^dÆQÜ'eo a cr©lpe.-'D un
"' Paris â t ié|ë:
Jacques 5 ayant des épis à la maduj &c. Gefte ckcorisflan'ce
a fi peu de rapport à Ifis ^ <§ue Malingre lui - même, qui
parle de cette Statue, ne feait fi c étoit Ifis, Gérés, Mercure
9 ou quel qu’autre Idole. Ainfi après ces variétés &
dès ^ ^ E ^ ^ a r ^ ^ ^ e u ^ ^ ^ y ^ ^ ^ iugèment
iur ■
gnage de qeux qui difen-t Tavoii vu ? '
D’autres pour appuyer ce même fentiment, prétendent
’qu'è le'îKraviçe des armes de dè‘Paris a 'rapport- à
:eëiiiâ d^iis^
.a n s I , parce, qu* o n^ufeattrib^oit
É®&Matitoïir cè^fin^a
* leJtfe
1
- ( f dgus Bdrijiorum*-), dont Lutece étoit le 'chef-lieu. C’cft ce qui a fa-t fans
doute que plufieurs F
tels que cLouvre en Parifis , Cormei'lle, GÎaye, Gouflènville »^ilîe’i Parifis ,
'Goneire’'én.:P,ari'fis, &c.
’ (3) Vojc’i les termes du P. du Breul. « Lt.Stktfefon&dtlè d7jfr, q.ûpavolt"'
» toujours été g'àrdée ^n onjg^lalq tèrga ?^^ remarque^aiiti^t^d^
lieu, fut érigée & pofée contre le mur feptentrional de la nef d’icclle Egfifc r
P & y a demeuré jufqucs en l’an 1 y 14 ,jque Meflïre Gui'Ifeume'Briqonnec,-Evêque 1
» de.»Meauxv/&;Al>b^;dutit i^n^ei^'j'la'fit’
» tfbuyié-unie'iSunriié ■ li%e)iOTX!âévantûceHè:Idoile', '-tenan^^e'tôta'^iâ^l&iüS^
»'déliés allumées . . . . . ^hùtrivial Raptodieux a écrit que ladite'IdoJe-seR
» encore entière, & ç[uc lys'Moi^eside-Léans1l’onV>çacH'ée eri certain lieu ; mais
„ je puis âfliirer du contraire ; c’eft à fij&voir qu’elle- mife^'eft.
t, pièces j l’iyant appris de‘qüa'tre :deÉ‘oiiî'Relig{eÙJt i’ qiit’s’emjlloyeren( à la déi
a» raOlition, lelquelsétoient'cnocre vivans en iÿj‘oï,En4a placeid.e ladite Tdole,
n ledit Sieur.Briçonnec y 'fit Sceller une grande^^roix que l’on .y^bi't encore «•
Théâimdes À^tip^e 'Paris 16-93, pjMk&K ^ . 4
j Quelle créance ajouter à un Antiquaire qui décrit à la même page la'tqriifbcidu
Géant,Iforet , ayant vingt pieds de long , nbn'ctfmpris'laitêtc,1 Sçc.' ■ -
H I S T O I R E
les Ecliev.ins de Paris en 11 po , donna à cette
Yille-pour AimjDiiies ^ ézzt "} aiifil
fem é de fleurs de L y s d’o r , ainfi qu’étoit
Villes du Royaume,
» qu’elle eft la N e f d’abondance, & affluence de tous
fes Armoiries ( 1).
Deefle, a-.ÇEU'.àvoir trouvé la preuve de leur 01lé'gué dans
la découverte d’une. ,j£te- dé Femrae de antique^
? dans les
5.aint>Euflache, qui faifoit partie de l’enceinte de Philippe-
Augufte. @ette^têtesi Ég; BTQnz^^çcmem éem^
ie; bà#rel r &îâv-oit une tourjihr la tête. Elle a | ^ ^ Ë :
;M. dte .lP'aiii©^!.^ 'iùï- ,en .;à
pied§. dëu0 ?ip||if;@ -iA® ^pied^@Ka ^ m ^ y
dans la plus grande largeur de la face : elle avoit des yeux1
d’argent félon Germain Brice, &c. •
Le P- de. l’ipÿnqiai Jdes.
-Auteurs qiai r©.n^'jprdé'édé^ ■ s’eft perfuadé qne c’éMt-la
Déefle Ifis î mais on fçaic quels fouDles 'a |^ b ‘^feije cette
fcBsa|médailles^6c^idans^le^^ m n ^ M ^ ^ ^ ^ | ^ n ^ g l f ê ^
tê te , avec une efpece def voile ; ,ôc tantôtjun globe entre
deux cornes de. Taureau, avec uny^Sgë;d’Epervier Air le
front j &c. Par cette différence-,, on ne é^iê.’pas la ^ o n --
figné par une tour ^ ou
lA \ j ’ ^ ^
j» ^ ^ B M c o nn^M,e j lay-toùm ^ W f e g ^ *(
auire
qùp lrpJ^P'e,. ir^oluic'dansî'les-1*
|n.eSs. • ^l>4 9 ue'j on^ ^ Ê Ê
d»Adrien o t^a^ty
perdu de leur perfeûion.
gemb 1 t
arts ’
t f ’. SC ftiLVjP,ftomY'J^'}
lKü r^ ill^fC Tn^ ^^ ^W eu ,.d e ' temps im-
à la
)S ) « ^ j ^ e^mt-!bâtfe?^ M i s ÿ ^ ç iénneglCTAme^E^^Q^^^B
fur ie Mont Leucotitius
^ fE u f t a c i f f i^ ^ ^ ^ ^ M ^ à g n^ 0 1e s ;p rë iiv ë^ c cum u le è s ï;
fedf^Mqreatf^^Maùtour^epYènt^êg^Sécs^iêg^par-cCB i^ Ë
^^^jardlès.# v^ ^ nt
t ^van?ef
'• nieiikàns doi
commencement Y. Ilj^ 'ixC an q u e
'.h fl-3 J^'fçris que le fentiment de cet Académicien a été vivement combattu par
M. le Roi, & par D. Lobineau, dans les Dlffettations qui font à la tête àe la
grande Hiftoire de Paris. Ces deux Auteurs’font remonter l’origine des; /frmoi-
rier, & de l’Hôtel dcj&ll<£de Paris jufqu’au temps des Romains, en s’appuyant
de la fameufe' Inlcription grav.ée £ür l’Autel dédié à Jupiter par les Nautes Pari-
fiens, fous'lc régné de'Tibère ; mais;commeii n’eft point fait mention d’Ifis dans
ices bas-reliefs trouvés en 1711 , on n’eti peut rien conclure en’fâveur du culte
^d’0 î.j & de l’çxiftence .depTemp^çyie cétïé Mée'ftè à Paris. ^ ■;
(z) Claude du Molinet, Chanoine§^^l^rj;&'Procureur général de la Congrégation^
Sainte-Geneviève, Pua dés -plusWgâSflps Am‘tiquair0 du dix-feptieme
fieclc,néà Clidlpn fur'Marne en 16zo, mort, le 2 Septembre i 6'87 î e^uteurf
d’une .Hiftoire des Papes par Médailles, & de plufieurs autres Içayàns .Ouvrages ;
celui;dont.on parle ici eft (àDi/fertntion Jur une têté/IJis^c. Il amafla un'Cabinet
confidérable deiCuriofîtés j.&.mjt la Bibliothèque de 'Saîiitc: GMeyieye à Paris
dans ^un état .quiifl’à; rendue célébré.
. ?^^m^)xL~prétend dans les Mémoires de Trévoux, Aoîit 1703, que ce bel Antique
repréfentc lajDÉESSE Lutèce , comme la'Diyimcé tutélairè'de^Paris : pn trouve
en effcc'queïqjies exemples même dans l’ancienne Gaule, où la Déefle proteârice
d’une Ville rta\5oic de la Ville même , telle que la fameufe Inlcription
Dbæ Bibractæ , découverte à Autun, qui décide la queftion tant débattue fur
l’identité de Bibraâe avec Autun ; mais le défaut d’Infcnpuom fu^Antique
trouvé à Paris, oblige de s’en tenir au lymbple^ ^quidefigne une tête de Cybèle.
(4) M. de Saint-Foix cite Tacite, De moribus Germon. , C. VÏÉ:; mais’-là
leâure du paftage entier apprend ce .qu’il-
■ traniporté d*Egypw:(l|^[çsit@9ules & en Germanie. « Une partie des Sueves,
» ( dit 'Ta,dte\rÇ. *IX ) , adore CousWa^i^î^ vauféàu
In ttburnùn} pjëùve^w^ m ^^^r* eyyemi’d’a ï l l é ~ u e »
pjéfentatioi^ n^l'é^^myinité^^^mWaaiff^y n’etoit tin^j') fê'Sqit e
iW'^utevesiàvoient fàit^^j'?q«fe^fe^em^7&_qûe ,)'fiii^^^r«:pufume , jjg
%y6i^^^ffif^oeé^da^unfdêrieùr^p^®&crés;V'gduc yî^oejiia 1'ihonu,meiJt de1’
ilei^ytélfïire., tes Armoiries''modern^fa^a Ville deTJàriifion fd o n c une.p^euvè
cui^T^^o^M^|ÇdëfrGe/rgJ^S^!Pe//^‘èrydMw,‘
'Ce ^ggVde Tacite èft'une despreuves dont ^KEt^^^aÿaftÉ'Wchart'j ü^
n’ëft^qm£î'deWïre^^^^^^connoifiè G^PMeg.-Scl^Êjé0mKfi^a.]s la
■ ciens Auteurs*ÿï^îiroqq,ués^ foit mal interprétés. '(^^^u^f^Jumnte ).,.
i^ H O n a lieu deè^^^errq.üô;PAP.e^bU^iEj^^Æc|r‘ qe^Ièt prévale paâ ,
^^ôtyde^iàutÔMadu^oâefBqchart, qùi'fe '
■ ^^^ercüle Egyprie^^wjp^raiei|culte d*Ifis dans lehGmtles vfinperfinfmU : cette
^^mv.q ifti 'du! bqone^u’fe^p é^^a^ ^ ^ M'râh IVfeis ,dili
.M^Pelloufier, loct 8gMÿes VoyageS a tout
stjarr d’une fàble/^^^js^i^ftWas 'diffidK .Cd^^ m er,-c^q’ui en V irimofé
Mgfts' cétte'-o'cca^^aux Grecs & aux RomainsquîsOrit parl4,d'f@ mle comme
§j|un .rféros exploits n’avoient'pas été'inconnus'aux ^tüfejs &
I^^UGèrrnal^^^^^eltes’ ’dohnmKif ié nomade' Gàrp^vr'^^-)i'^tous leurs
vJ^àyes; c’eft çe.q^'fignyipMe J&m'dé .Charles, ^^ïmuri’^®ni'|les'Francs f