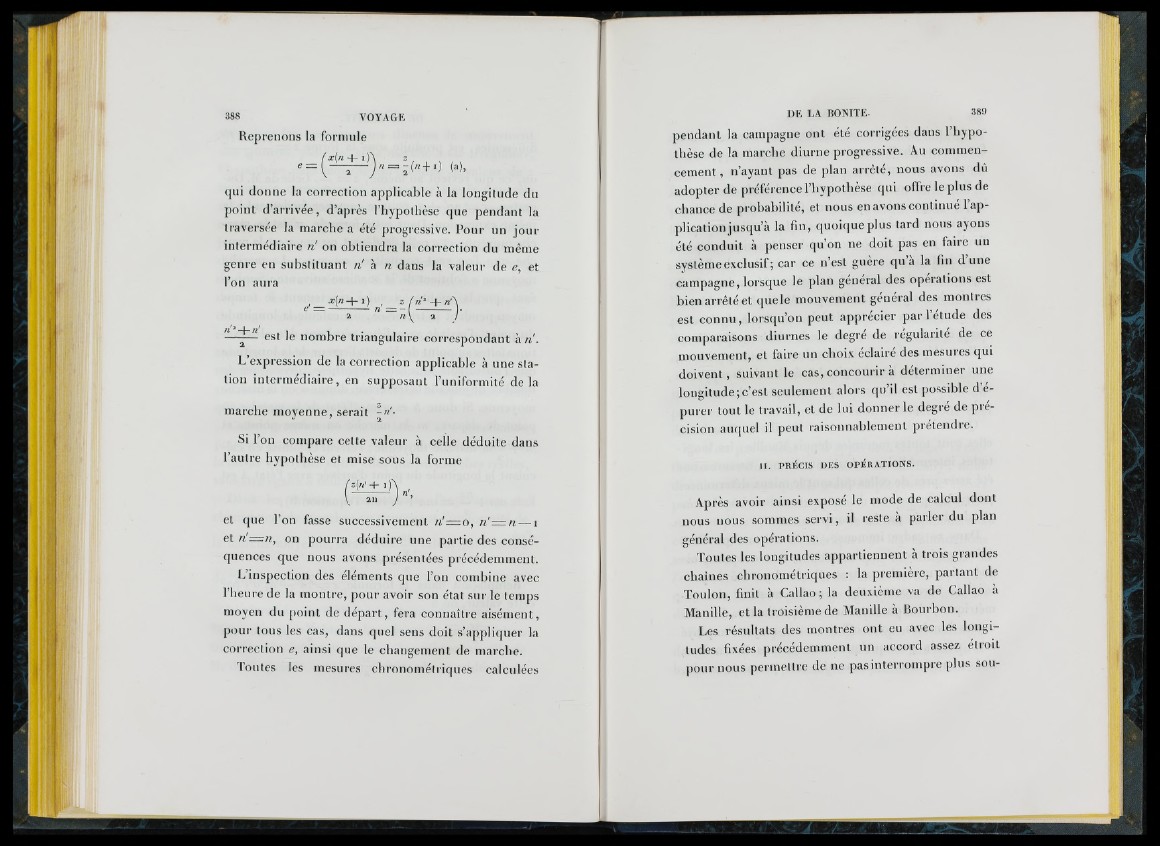
388 VOYAGE
Reprenons la formule
f xl/i + 1
qui donne la correction applicable à la longitude dn
point d’arrivée, d’après l’hypothèse que pendant la
traversée la marche a été progressive. Pour un jour
intermédiaire «/ on obtiendra la correction du même
genre en substituant «' à « dans la valeur de c, et
l’on aiiia
t ' — _ i ^ ■
— -— est le nombre triangulaire correspondant à n'.
L ’expression de la correction applicable à une station
intermédiaire, en supposant l’uniformité d e là
marche movenne, serait -«'• ’ 2
Si l’on compare cette valeur à celle déduite dans
l ’autre hypothèse et mise sous la forme
et que l ’on fasse successivement n '= Q , /i’= n — i
et « '= « , on pourra déduire une partie des conséquences
que nous avons présentées précédemment.
L’inspection des éléments que l’on coridjine avec
l ’heure de la montre, pour avoir son état sur le temps
moyen du point de dépar t , fera connaître aisément,
poui- tons les cas, dans quel sens doit s’appli(juer la
correction e, ainsi que le changement de marche.
Tontes les mesures cbronométriques calcidée.s
pendant la campagne ont élé corrigées dans l ’hypothèse
de la marche diurne progressive. Au commencement
, n’ayant pas de plan arrêté, nous avons dû
adopter de préférence l’hypothèse qui offre le plus de
chance de prohahililé, et nous en avons continué l’application
jusqu’à la lin, quoique plus lard nous ayons
été condui t à penser qu’on ne doit pas en faire un
système exclusif; car ce n’est guère qu à la lin d u n e
campagne, lorsque le plan général des opérations est
b iena r rêtée t quele mouvement général des montres
est connu , lorsqu’on peut apprécier par l’é lude des
comparaisons diurnes le degre de régularité de ce
mouvement, et faire un choix éclairé des mesures qui
do iv ent , suivant le cas, concourir à déterminer une
long i tude ;c ’est seulement alors rpi’ il esl possible d’épurer
tout le travail, el de lui donner le degré de précision
aiupiel i! peut raisonnablement prétendre.
u . PR ÉC IS DF.S O P ÉRA .T IO N S .
Après avoir ainsi exposé le mode de calcul dont
nous nous sommes s e r v i , il reste a parler du plan
général des opérations.
Toutes les longitudes appartiennent à trois grandes
chaînes cbronométriques ; la première, parlant de
Toulon, finit à Callao; la deuxième va de Callao à
Manille, et la troisième de Manille à Bourbon.
Les résultats des monlres ont eu avec les longitudes
fixées précédemment un accord assez étroit
p o um o n s permettre de ne pas interrompre plus sou