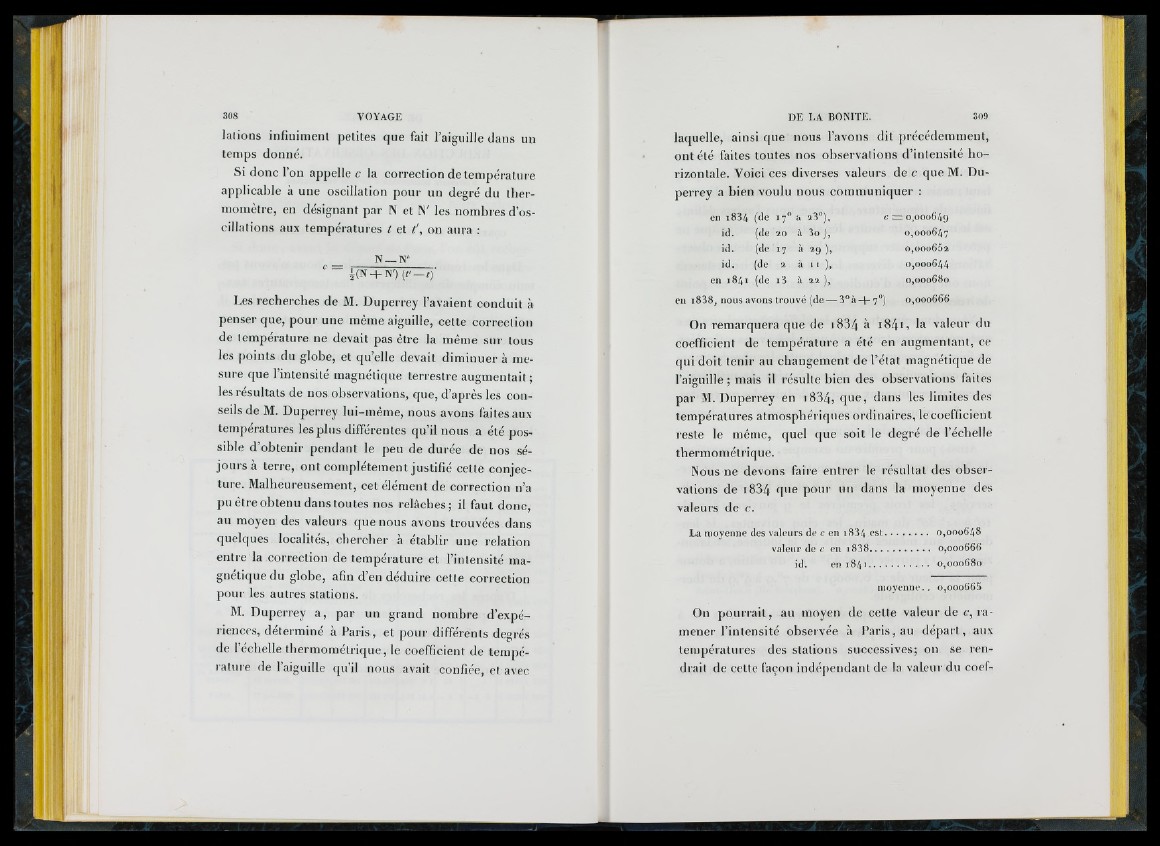
huions infiniment petites que fail l’aiguille dans un
temps donné.
Si donc l’on appe l le e la correclion de température
applicable à une oscillation pour un degré du tbermomètre,
en désignant par N et N' les nombres d’oscillations
aux températures / et t', on aura :
N _ N ' '
Les rechercbes de M. Duperrey l’avaient condui t à
penser que, pour une même aiguille, celte correction
de température ne devait pas être la même sur tous
les points du globe, et qu’elle devait diminuer à mesure
que l’intensité magnétique terrestre augmentait;
les résultats de nos observalions, que, d’après les conseils
de M. Duperrey lui-même, nous avons faites aux
températures les plus différentes qu’il nous a élé possible
d ’obtenir pendant le peu de durée de nos séjours
à terre, ont complètement justifié celle conjecture.
Malbeureusement, cet élément de correction n’a
pu être obtenu dans toutes nos relâches; il faut donc,
au moyen des valeurs que nous avons trouvées dans
quelques localités, chercher à établir une relation
entre la correclion de température et l’intensité magnétique
du globe, afin d’en déduire cette correction
pour les autres stations.
M. Duperrey a , par un grand nombre d’expériences,
déterminé à l*aris, et pour différents degrés
de l’échelle tbermomélr ique, le coefficient de température
de l’aiguille qu’il nous avait confiée, et avec
laquelle, ainsi tpie nous l ’avons dit précédemment,
ont été faites toutes nos observat ions d ’intensité horizontale.
Voici ces diverses valeurs de c que M. Duperrey
a bien voulu nous communiquei' :
en i 834 (d e 1 7 “ a 2 3 "), c = 0 ,0 0 0 6 /,9
id . (d e 2 0 à 3o j , 0 ,0 0 0 6 4 7
id . (de 17 à 2 9 ), 0 ,0 0 0 6 6 2
id . (d e 2 à 1 1 ), 0 ,0 0 0 6 4 4
e n 1841 (d e i 3 à 2 2 ), 0 ,0 0 0 6 8 0
en 18 3 8 , n o u s a v o n s tr o u v é (d e — 3° à -1 -7 ° ) 0 ,0 0 0 6 6 6
On remarquera que de 1 834 b i 8 4 i , la valeur du
coefficient de température a été en augmentant, ce
qui doit tenir an changement de l ’ état magnéticpie de
raiguilie ; mais il résulte bien des observations faites
par M. Duperrey en i 8 3 4 , que , dans les limites des
températures atmosphériques ordinaires, lecoefficient
reste le même, quel que soit le degré de l’échelle
thermométrique.
Nous ne devons faire entrer le résultat des observations
de i 834 (pie pour un dans la moyenne des
valeurs de c.
L a m o y e n n e d e s v a le u r s d e c en ( 8 3 /, e s t .................. 0 ,0 0 0 6 4 8
v a le u r d e r c n i 8 3 8 ........................... 0 ,0 0 0 6 6 6
id . en 1 8 4 1 ........................... 0 ,0 0 0 6 8 0
in o y em u '. . o ,o o o 665
Ou pourrai t , au moyen de celte valeur de c, r a mener
l’intensité observée â Paris, au départ , aux
lempéraliires des stations successives; on se rendrait
de cette façon indépendant de la valeur du cocl