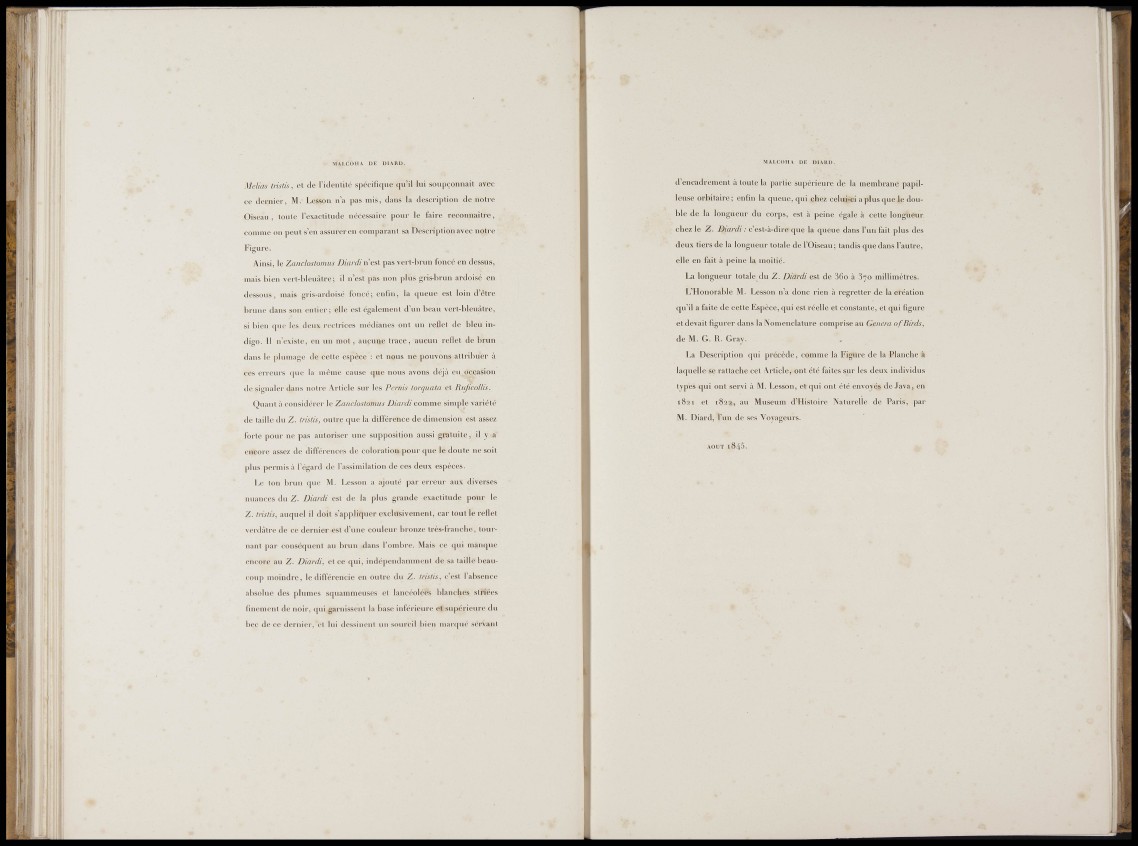
1/ît
fi
1
>
§
3:
.1
il:;
H ;
MVl.COIIA DE UIARD.
Me/ias trislis, el Je ricleiililc spéciti(|ue qu'il lui sou|)çonuail avec
ce ileniier, M. Lessou u'a pas mis, dans la descriptiou de noire
Oiseau, loule l'exactilude nécessaire pour le l'aire reconnaître,
comme ou peut s'en assurer eu comparant sa nescri|)tiou avec notre
Fieui'c.
Ainsi, le Zanclostomiis DiarcH n'est pas vert-bnm foncé en dessus,
mais liieu vert-lileuàtre; il n'est pas uon plus gris-hrun ardoisé eu
dessous, mais gris-ardoisé foncé; euliu, la (|ueue est loin d'être
brune dans sou entier; elle est également d'un beau vert-bleuâtre,
si bien que les deux reclriees médianes ont un reflcl de bleu indigo.
Il n'existe, en un mot, aucune trace, aucun reilel de brun
dans le plumage tie cette espèce : el nous ne pouvons attribuer à
ces erreurs tpie la même cause que nous avons déjà eu occasion
de signaler dans notre Article sur les Pcrnis torquata et RuJicoUis.
Quant à considérer le Zanclostomus Diardi comme simple variété
de taille du 2 . tristis, outre que la différence de dimension est assez
forte pour ne pas autoriser une supposition aussi gratuite, il y a
encore assez de différences de coloration pour que le doute ne soit
plus permis à l'égard de l'assimilation de ces deux espèces.
Le Ion brun que M. Lessou a ajouté par erreur aux diverses
nuances du Z. Diardi est île la plus grande exactitude pour le
Z. Irislis-, auquel il doit s'appliquer exclusivement, car tout le reilel
verdàtre de ce dernier esl d'une couleur bronze Irès-franclie, tournant
par conséquent au bruu dans l'ombre. Mais ce (pii nuuupic
encore au Z. Diardi, el ce qui, indépeudammeiil de sa laille beaucoup
moindre, le différencie eu outre du Z. Instis, c'esl l'absence
absolue des plumes squammeuscs el lancéolées blanclies striées
lineuicnl de noir, (pii garni.ssent la base inférieure el supérieure du
bec de ce dernier, el lui <lcsslncnl un .sourcil bien marqué .servaiM
m
i Si
i! m
MAi.(:()[rv DE nr\i\D.
d'encadremenl à toute la parile supérieure tie la membrane papilleu.
se orbitaire ; enfin la queue, qui chez celui-ci a plus que le double
de la longueur du corps, est à peine égale à celte longueur
chez le Z. Diardi : c'est-à-dire que la queue dans l\m fail plus des
deux tiers de la longueur totale de l'Oiseau ; tandis que dans l'autre,
elle en l'ail à peine la moitié.
l^a longueur totale du Z. Diardi esl de 36o à 3^0 millimètres.
L'Honorable M. Lesson n'a donc rien à regreller de la création
qu'il a faite de cette Espèce, qui esl réelle et constarne, et qui figure
el devait figurer dans la Nomenclature comprise au Genera of Birds,
de M. G. R. Gray.
La Description qui précède, comme la Figure de la Planche à
laquelle se rattache cet Article, ont été faites sur les deux individus
lypes c[ui oui servi à M. Lesson, et qui onl été envoyés de Java, en
1821 el 1822, au Museum d'Histoire Naturelle de Paris, par
M. DIard, l'un de ses Vovageurs.
.loiiT 1845.
Î
iU