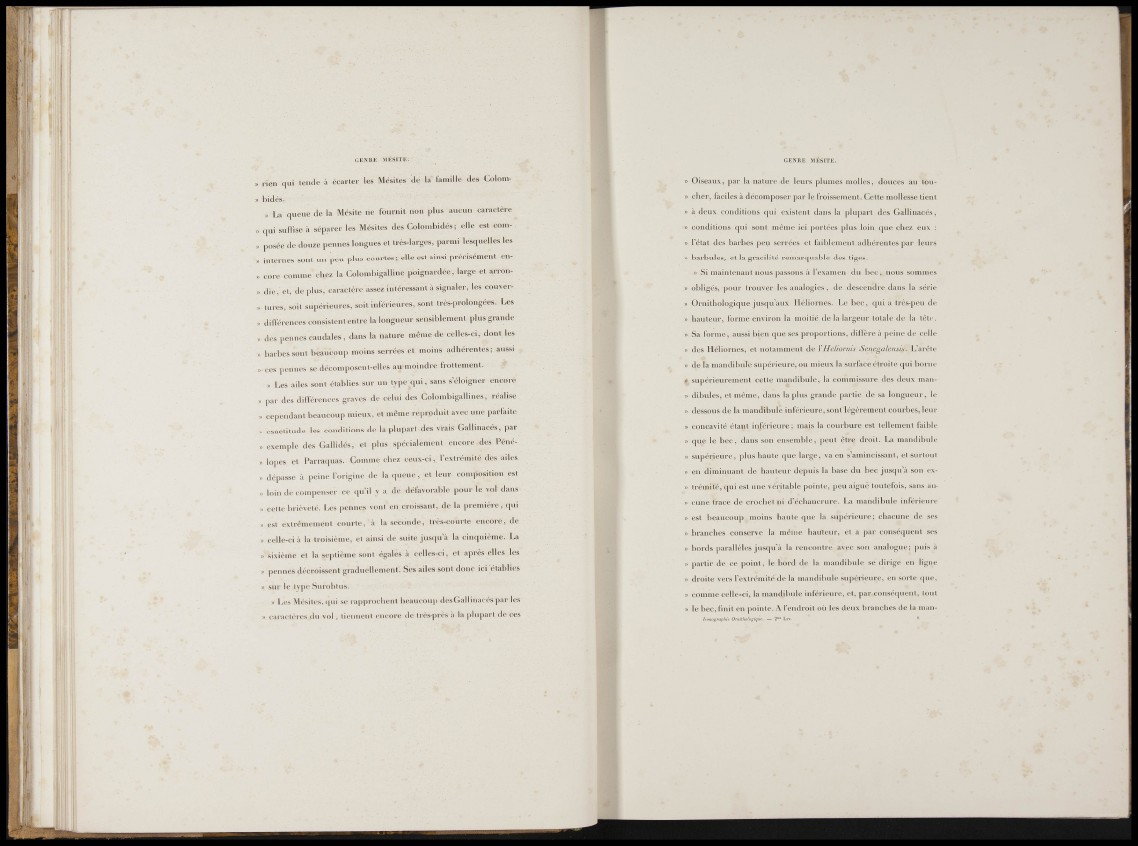
1'
. ,„.;
m
r f ' l M f l
p i
, FT »
a
Î
idL
• f
(i
•I
i I
IPÎ
C E l V R I i MKSITE.
» lien nui leiule à écailer les Mésites de la l'amille Jes Coloin-
» hides.
» La queue de la Mésite ne fournil iioii plus aueuii caractère
„ t,ui suffise à séparer les Mésites des Colouibidés; elle est eoin-
„ posée de douze pennes longues et très-larges, parmi lesquelles les
„ internes sont un peu plus courtes; elle est ainsi précisément en-
» core comme chez la Colomhigalline poignardée, large et arron-
,> die, et, de |)lus, caractère assez inléressanl à signaler, les couver-
>, tiires, soil supérieures, soit inlerieures, sont irès-prolongées. Les
» dilVérences consistent entre la longueur sensiblement plus grande
, des pennes caudales, dans la nature même de celles-ci, dont les
„ barbes sont beaucoup moins serrées et moins adhérentes; aussi
»- ces pennes se décomposent-elles au moindre frottement.
» Les ailes sont établies sur un type qui, sans s'éloigner encore
>, par des différences graves de celui des Colombigallines, réalise
„ cependant beaucoup mieux, et même reproduit avec une parfaite
„ exactitude les conditions de la plupart des vrais Gallinacés, par
„ exemple des Gallidés, et plus spécialement encore des Péné-
„ lopes el Parraquas. Comme chez eeux-ci, l'extrémité des ailes
, dépasse à peine l'origine de la queue, et leur coniposilion est
» loin de compenser ce qu'il y a de défavorable pour le vol dans
» celle brièveté. Les pennes vont en croissant, de la première, qui
» esl extrêmemenl courte, à la seconde, très-courte encore, de
» celle-ci à la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième. La
,> sixième et la septième soni égales à celles-ci, el après elles les
» pennes décroissent graduellement. Ses ailes .sont donc ici établies
» sur le type Surobins.
» l.cs Mésites, (|ui se rapprochent beaucoup desGalliiiacés par les
» caractères du vol, lienneni encore de Irès-iirès à la pluparl de ces
G E N R E MKSITE.
T> Oiseaux, par la nature de leurs plumes molles, douces au tou-
» cher, faciles à décomposer par le froissement. Cette mollesse tient
j> à deux conditions qui existent dans la plupart des Gallinacés,
» conditions qui sont même ici portées plus loin que chez eux :
)i l'état des barbes peu serrées el faiblement adhérentes par leurs
» barbules, et la gracilité reiuarqiial.)le des tiges.
» Si maintenant nous passons à l'examen du bec, nous sommes
» obligés, pour trouver les analogies , de descendre dans la série
1) Ornidiologique jusqu'aux Héliornes. Le bec, qui a très-peu de
» hauteur, forme environ la moitié de la largeur totale de la lête.
» Sa forme, aussi bien que ses proportions, dilTère à peine de celle
)) des Héliornes, el nolammenl de VHdiorius Se/tegaleiisis. L'arête
» de la mancHbule supérieure, ou mieux la surface étroile ipii borne
» supérieurement cette mandibule, la commissure des deux manî)
dibules, el même, dans la plus grande partie de sa longueur, le
» dessous de la inaudibule inférieure, sont légèrement courbes, leur
» concavité étant inférieure; mais la courbure est tellemeni faible
» que le bec, dans son ensemble, |)eut être droit. La mandibule
)> supérieure, plus haute que large, va en s'amincissani, et snrioul
» en diminuani de hauteur depuis la base du bec jusqu'à son ex-
» trémité, qui est une véritable pointe, peu aiguë toutefois, .sans auyi
cune trace de crochel ni d'échancrure. La mandibule inférieure
» est beaucoup moins haute que la supérieure; chacune de ses
» branches conserve la même haulenr, el a par conséqueni ses
» bords parallèles jusqu'à la rencoiiire avec son analogue; puis à
» partir de ce point, le bord de la mandibule se dirige en ligne
» droite vers l'extrémité de la mandibule supérieure, en .sorte (pie,
i; comme celle-ci, la mandibule inférieure, el, par conséqueni. loul
» le bec, llnil en pointe. l'endroit où les deux branches de la man-
Iconograjiltic Orn