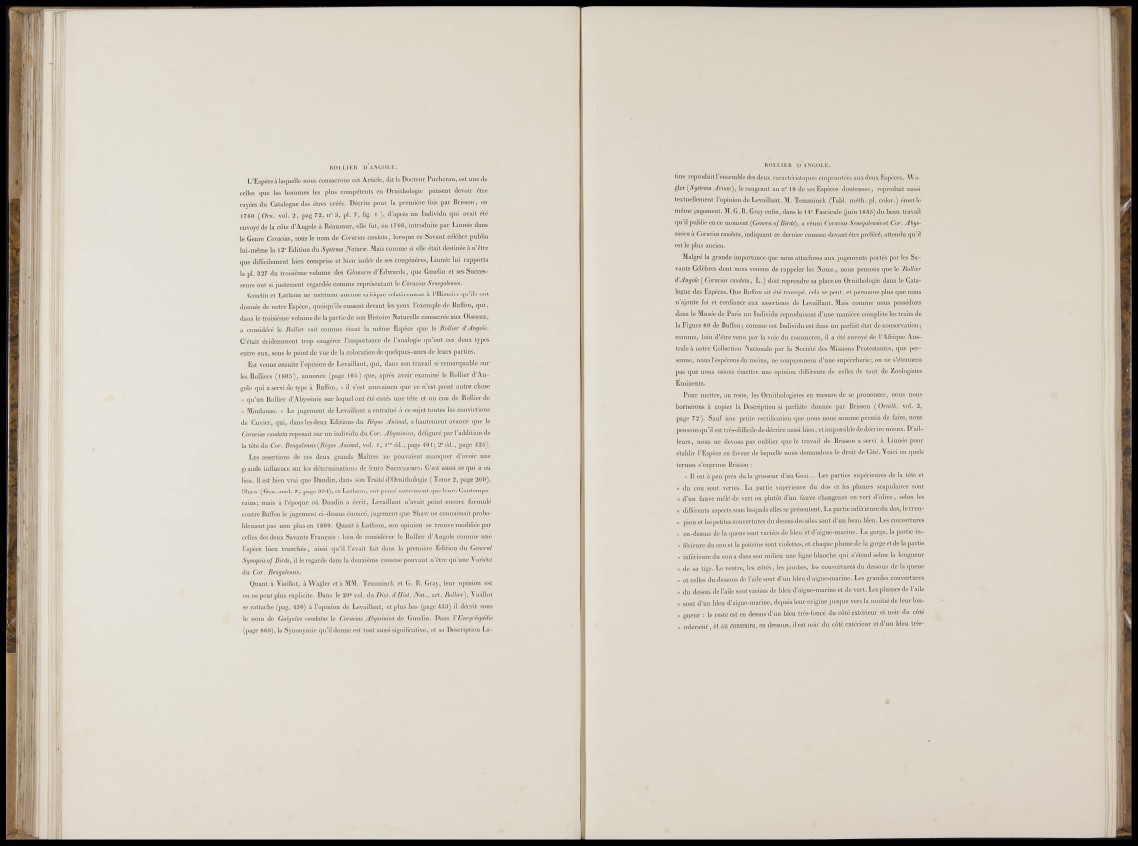
If. . ' i ' í •
.•»yL I! :.•.
•i , i !l:
S
!
•Tilí
ROl.LIHH DANGOi.i;.
L'Espèceà laquelle nous consacrons cet Article, dit le Docteur Pucheran, est une de
celles que les hommes les plus compétents en Ornithologie pensent devoir cHre
rayées du Catalogue des êtres créés. Décrite pour la première fois par Brisson, en
i r e o (Oni. vol. 2, pag 72, n" 3, pl. 7, iig. 1 ), d'après un Individu qui avait été
envoyé de la côte d'Angole à Réaumur, elle fut, en 1706, introduite par Linnée dans
le Genre Coradas, sous le nom de Coradas caiidata, lorsque ce Savaut célèbre publia
lui-même la 12' Edition du Syslma Natura. Mais comme si elle était destinée à n'être
que difficilement bien comprise et bien isolée de ses congénères, Linnée lui rapporta
la pl. 327 du troisième volume des Glamires d'Edwards, que Gmelin et ses Successeurs
ont si justement regardée comme représentant le Coradas Senegalensh.
Gmelin et Latham ne méritent aucune critique relativement à l'Histoire qu'ils ont
donnée de notre Espèce, quoiqu'ils eussent devant les yeux l'exemple de BufTon, qui,
dans le troisième volume de la partie de son Histoire INaturelle consacrée aux Oiseaux,
a considéré le Rollier cuit comme étant la même Espèce que le RolUer d'Angole.
C'était évidemment trop exagérer l'importance de l'analogie qu'ont ces deux types
entre eux, sous le point de vue de la coloration de quelques-unes de leurs parties.
Est venue ensuite l'opinion de Levaillant, qui, dans son travail si remarquable -sur
les RoUiers (1805), annonce (page lOô) que, après avoir examiné le Rollier d'Angole
qui a servi de type à BuiTou, « il s'est convaincu que ce n'est point autre chose
ti qu'un Rollier d'Abyssinie sur lequel ont été entés une tête et uu cou de Rollier de
» Mindanao. » Le jugement de Levaillant a entraîné à ce sujet toutes les convictions
de Cuvier, qui, dans les deux Editions du Règne Animal, a hautement avancé que le
Coradas caudala reposait sur un individu du Cor. Abijssimca, déliguré par l'addition de
la tête du Cor. Bengaletisis {Règne Animal, vol. 1, éd., page -îOl; 2^ éd., page ^25).
Les assertions de ces deux grands Maîtres ne pouvaient manquer d'avoir une
grande inlluence sur les déterminations de leurs Successeurs. C'est aussi ce qui a eu
lieu. 11 est bien vrai que Daudin, dans son Traité d'Ornithologie ( Tome 2, page 200),
Shaw (Gen. zool. 7, page 394), et Latham, ont pensé autrement que leurs Contemporains;
mais à l'époque où Daudin a écrit, Levaillant n'avait point encore formulé
contre BuiTon le jugement ci-dessus énoncé, jugement que Shaw ne connaissait probablement
pas nonplus en 1809. Quant à Latham, son opinion se trouve modiliée par
celles des deux Savants Français : loin de considérer le Rollier d'Angole comme une
Espèce bien tranchée^ ainsi qu'il l'avait fait dans la première Edition du General
Synopsis of Birds, il le regarde dans la deuxième comme pouvant n'être ((u'une Variété
du Cor. Bengalensis.
Quant à Vieillot, à Wagler et à MM. Temminck et G. U. Gray, leur opinion est
on ne peut plus explicite. Dans le 29* vol. du Did. d ffisl. Nal., a]-l. Rollier), Vieillot
se rattache (pag. 430) à l'opinion de Levaillant, et plus bas (page 433) il décrit sous
le nom de Galgnlus caudatïis le Coradas yihyssiniea de Gmelin. Dans i'EncyclopMe
(page 869), la Synonymie qu'il donne est tout aussi significative, et sa Description Lamk
ROl.l.l liK U \NC.<)l.li:.
tino feproduit l'ensemble des deux cariictcrisLiqucs einprualees aux deux Espèces. Wagler
[Systema Amm), le rangeant au n" 10 de ses Espèces douteuses , reproduit aussi
textuellement ropinion de Levaillant. M. Temminck (Taiil. méth. pl. color.) émet le
même jugement. M. G. R. Gray eniîn,dansle 14" Fascicule (juin 1845) du beau travail
qu'il publie en ce moment (Gi'itero of Birds), a réuni Coracias Senegahnsis et Cor. Abyssimcak
Cor acias caudala, indiquant ce dernier comme devant être préféré, attendu qu'il
est le plus ancien.
Malgré la grande importance que nous attachons aux jugements portés par les Savants
Célèbres dont nous venons de rappeler les Noms, nous pensons que le Rollipr
d'Angole ( Coracias caudala^ L. ) doit reprendre sa place eu Ornithologie dans le Catalogue
des Espèces. Que BulTon ait été trompé, cela se peut, et personne plus que nous
n'ajoute foi et confiance aux assertions de Levaillant. Mais comme nous possédons
dans le Musée de Paiis un Individu reproduisant d'une manière complète les traits de
la Figure 88 de BuiTon ; comme cet Individu est dans un parfait état de conservation ^
comme, loin d'être venu par la voie du commerce, il a été envoyé de l'Afrique Austi
aleànotre Collection Nationale par la Société des Missions Protestantes, que personne,
nous l'espérons du moins, ne soupçonnera d'une supercherie ; on ne s'étonnera
pas que nous osions émettre une opinion différente de celles de tant de Zoologistes
Eminenls.
Pour mettre, au reste, les Ornithologistes eu mesure de se prononcer, nous nous
bornerons à copier la Description si parfaite donnée par Brisson (Ornilh. vol. 3,
page 72). Sauf une petite rectilication que nous nous somme permis de faire, nous
pensons qu'il est Lrès-diUicile de décrire aussi bien, cl impossible de décrire mieux. D'ailleurs
, nous ne devons pas oublier que le travail de Brisson a servi à Linnée pour
établir l'Espèce en faveur de laquelle nous demandons le droit de Cité. Voici en quels
termes s'exprime Brisson :
« Il est à peu près dala grosseur d'un Geai... Les parties supérieures de la tête et
H du cou sont vertes. La partie supérieure du dos et les plumes scapulaires sont
" d'un fauve mêlé de vert ou plutôt d'un fauve changeant en vert d'olive, selon les
» diflcrents aspects sous lesquels elles se présentent. La partie inférieure du dos, lecrou-
» pion et les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un beau bleu. Les couvertures
» en-dessus de la queue sont variées de bleu et d'aigue-marinc. La gorge, la partie in-
>. férleure du cou et la poitrine sont violettes, et chaque plume de la gorge et de la partie
» inférieure du cou a dans sou milieu une ligne blanche qui s'étend selon la longueur
H de sa tige. Le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue
» et celles du dessous de l'aile sont d'un bleu d'aigue-marine. Les grandes couvertures
» du dessus de l'aile sont variées de bien d'aigue-marine et de vert. Les plumes de l'aile
» sont d'un bleu d'aigue-marine, dcjmis leur origine jusque vers la moitié de leur lon-
.1 gucur : le reste est eu dessus d'un bleu très-foncé du côté extérieur et noir du côté
intérieur, et au contraire, en dessous, il est noir du coté extérieur et d'un bleu trèsir.: