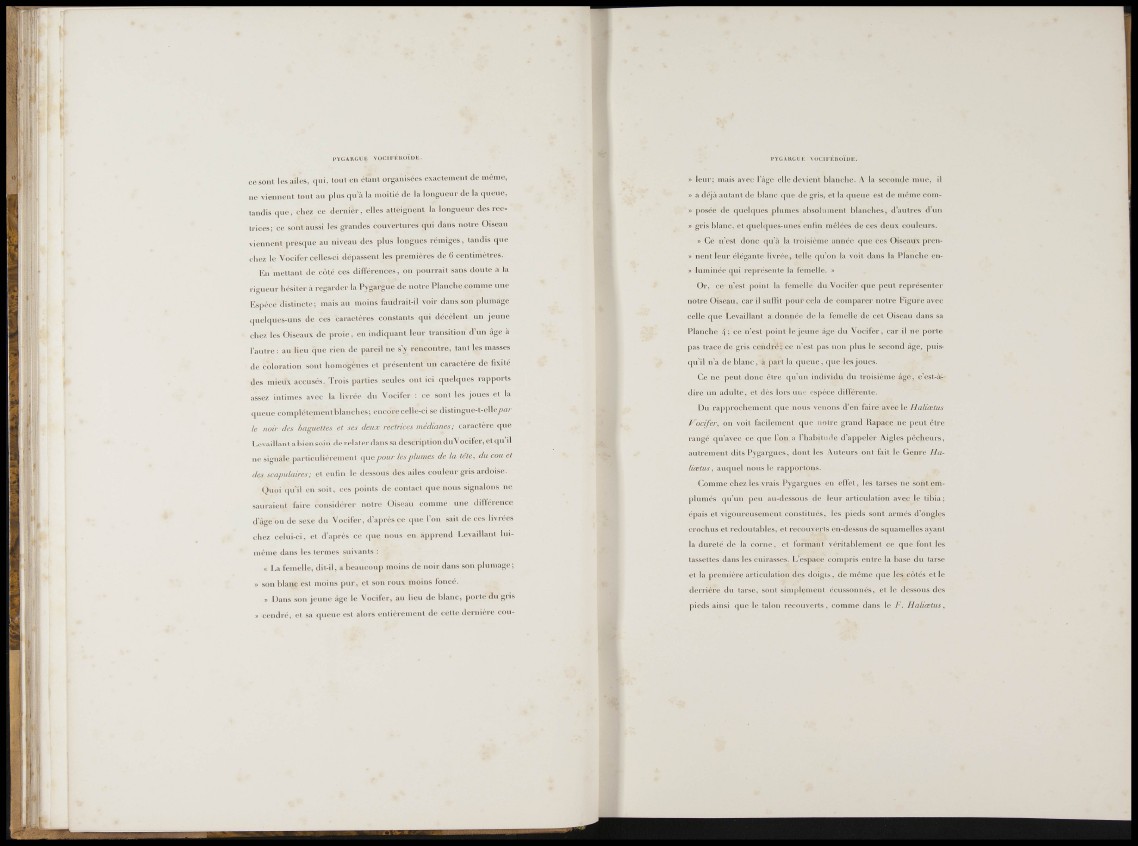
U i i
p
It**
M
l'VGAKGUlí VOCirEROÏUli.
ce soul les ailes, (iiii, loiil en élaiU organisées exactenieni de même,
ne vienneni loul au plus qu'à la nioilié de la longueur de la queue,
landis c(ue, eliez ce dernier, elles atleignent la longueur des rectrices;
ce soul aussi les grandes couvertures qui dans noire Oiseau
viennonl presque au niveau des plus longues rémiges, landis que
cliez le Vocifer celles-ci dépassent les premières de 6 ccntimclres.
En meltanl de côlé ces dilTérences, ou pourrait sans doule à la
rigueur hésiter ù regarder la Pygargue de notre Planche comme une
Espèce distincte; mais au moins laudrait-il voir dans son plumage
quelqiu's-uns de ces caractères constants qui décèlent un jeune
chez les Oiseaux de proie, en indiquant leur transition d'un âge à
l ' a u t r e : au lieu que rien de pareil ne s'y rencontre, tant les masses
de coloration sont homogènes et présentenl un caractère de fixité
des mieux accusés. Trois parties seules ont ici quelques rapports
assez intimes avec la livrée du Vocifer ; ce sont les joues et la
(|ucue complètement blanches; encore celle-ci se distingue-t-elle^«/'
le noir des baguettes et ses deux rectrices médianes; caractère que
Levaillant a bien soin de relater dans sa description duVocifer, et qu'il
ne signale particulièrement i^ac pour les plumes de la téte, du cou et
des scapidaires; et enfin le dessous des ailes couleur gris ardoise.
Quoi ([uil en soit, ces points de contact que nous signalons ne
sauraient l'aire considérer notre Oiseau comme une différence
d'iige on de sexe du Vocifer, d'après ce ipie l'on sail de ces livrées
chez celui-ci, et d'après ce (pie nous en apprend Levaillant luimême
dans les termes suivants :
« La femelle, dit-il, a beaucoup moins de noir dans son plumage;
» son blanc est moins pur, el son loux moins foncé.
» Dans son jeune ;ige le Vocifer, au lieu de hianc, poi tedugris
J) cendré, et .sa cpieiie est alors entièi-emcnl de celle dernière coii-
PYGARCui.; ^ ociriiKoiuL.
« leur: mais avec l'âge elle de\ ient blanche. A la seconde mue, il
» a déjà autant de hiaiic que de gris, et la <|ueue est de même coin-
» posée de quelques plumes ahsolinnent blanches, d'autres d'un
I) gris blanc, et quelques-unes enfin mêlées de ces deux couleurs.
« Ce n'est donc cpi'à la troisième année (pie ces Oiseaux pren-
» nent leur éléganle livrée, telle (pi'on la voit dans la Planche en-
» luminée (_|ui rejirésente la femelle. »
Or, ce n'est point la femelle du Vocifer que peut représenter
notre Oiseau, car il suffit pour cela de comparer notre Figure avec
celle que Levaillant a donnée de la femelle de cet Oiseau dans sa
Planche 4; ce n'est point le j eune âge du Vocifer, car il ne porte
pas trace de gris cendré; ce n'esl pas non plus le second âge, puisqu'il
n'a de blanc, à pari la queue, que les joues.
Ce ne peut donc être qu'un individu du troisième âge, c'est-àdire
un adulte, el dès lors une espèce différente.
Du ra])prochement que nous venons d'en faire avec le Malioetiis
Vocifer, on voit lacilement que notre grand Rapace ne peut être
rangé cpi'avec ce que l'on a l'habilude d'appeler Aigles pêcheurs,
aulreinent dits Pygargucs, dont les Auteurs ont fait le Genre Ha-
Uoetus, autiiiel nous le rapportons.
Comme chez les vrais Pygargues en effet, les tarses ne .sont eni-
|)lumés tpi'iin peu au-dessous de leur articulation avec le tibia;
épais et vigoureusement constitués, les pieds sont armés d'ongles
crochus et redoutables, et recouverts en-dessus (.le squamelles ayant
la dureté de la corne, et formant véritablement ce que font les
lassettes dans les cuirasses. L'espace compris entre la base du tarse
et la première articulation des doigts, de même cpie les côtés et le
tlerrière du tarse, sont simplement éciissonnés, et le dessous des
pieds ainsi que le talon recouverts, comme dans le /•'. Halioetus,
f i|
Í:
JT '*(
i 11 r