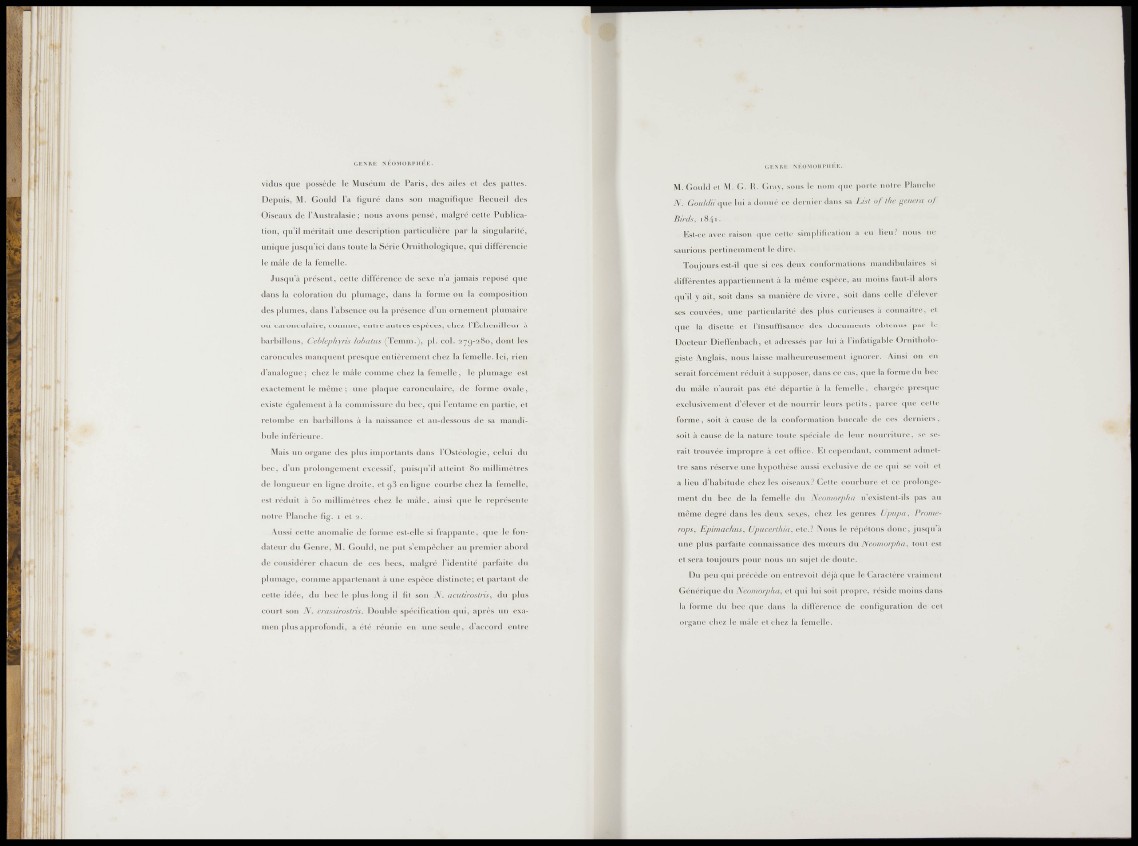
OILMIR MF,OMOUI>HRK.
villus que possède le Museum Je Paris, des i\iles el des palles.
Depuis, M. Gould I'll figure dans son inaguifuine Reeueil des
Oiseaux de TAuslralasie; uous a\t)ns pensé, malgré eeUe Puhliealion,
tpi'il mérilait une tiescriplion parlieulière par la singularile,
uniiine jusqii'iei dans toule la Séri e OrLiilhologiiiue, qui dil'lereueie
le niàle tie la lenielle.
J u s q u ' à présenl, eelle dilTérenee de sexe n'a jamais reposé ipie
dans la eoloralion du |)lumage, dans la l'oi-me ou la eonqiosilion
des phnnes, dans l'aljsenee ou la présence d'un ornemenl plniuaire
ou cai'onculaire, eomme, eiiire antres espèces, chez rEclicnillenr à
barbillons. Cchlephyris hbatiis (Temm.), pl. col. 279-280, doni les
caroncules inampienl [)resque enlièremeni chez la femelle. Ici, rien
d'analogue; chez le niàle comme chez la l'emelle, le plumage esl
exactenienl le même ; une phupLie caroncnlaire, île l'orme ovale,
existe également à la coniniissnri' tin bec, tpii l'entame en partie, cl
r e l o n d i e en barbilloLis à la naissance et au-dessous de sa mandibule
inférieure.
Mais un organe des plus iuq)ortants tians l'Ostéologie, celui du
i:>ec, d'un prolongement excessif, puisqu'il atteint (So millimetres
d e longueur en ligne droite, et g3 en ligne courbe chez la femelle,
est réduit à 5o niillimctres chez le mâle, ainsi que le représente
notre Planche lig. i et 2.
\nssi cette anomalie de forme est-elle si frappante, que le fond
a t e u r du Genre, M. Gould, ne |)ut s'enqjêchcr au premier aliord
de considérer chacini de ces becs, malgré l'identilé parfaite du
plinnage, counne a|)partonant à nue espèce distincte; et partant de
cette idée, du bec le plus long il lit son A. (!Ci/tifo.sfrji\ lîn plus
court son iV. cra.'isirostris. Double spécification qui, après un examen
|)lus apj)T'ofi)ndi, a été réunie en une seule, d'accord entre
i ; u i > : ni.OMoiii'iil'.i-;.
M. Goul d et M. G. 1!. Gia\ , sous le nom ipie porte notre Plaiiehi-
Goi/W» que lui a donné ce dernier dans sa Lis! of the i^encra of
Bh-ds. .841.
Est-ce avec raison <|ue celte siniplilicatiou a eu lieu? nous ne
saurions pertinemment le dire.
Toujours est-il que si ces deux eoulbrniatious mandibulaires si
différentes appartieunenl à la même espèce, au nmius faul-il alors
qu'il y ait, soit dans sa manière de vivre, soil dans eelle d'élever
ses couvées, nue particnlarilc des plus curieuses à connaitre, cl
que la disette et l'iusuffisance des documents obteiuLS par le
Docteiu' Dicffenbach, et adressés par lui à l'infatigable Ormlhologiste
Anglais, nous laisse malheureusement ignorer. .'Vinsi on en
serait forcément réduit à supposer , dans ce cas, que la forme du bec
d u mâle n'aurait pas été départie à la femelle, chargée presque
exclnsivenicnl il'élever et de nourrir leurs petits, parce que celte
f o r m e , .soit ;i cause de la confoi-mation buccale de ces derniers,
soil à cause de la nature toute spéciale de leur nourriture, se serait
trouvée impropre ,à cet olïice. Kt ce|)endanl, comment admettre
sans réserve une hypothèse aussi exclusive de ce qui se voit et
a lieu d'habitude chez les oiseaux? Celte courbure et ce piolongeinent
du bec de la femelle iln Nronioijifiri n'existeiit-ils pas au
même degré dans les deux sexes, chez les genres Upupn, Promerops,
Epimachus, Upiiccrliiia. etc.? Nous le répétons doue, jusqu'à
une plus parfaite connaissance des moeurs thi JSeoniorpiia^ fout est
cl sera lonjours poui' nous un sujet de doute.
Du peu (|ui précède on entrevoil déjà que le C.araclère vraimeni
G é n é r i q u e du jSeomorplia^ et qui Ini soit pi'opre. l'éside moins ilaus
ia i'orme du bec que dans la différence de conliguration de cet
organe chez le ui;ile et chez la femelle.
I I