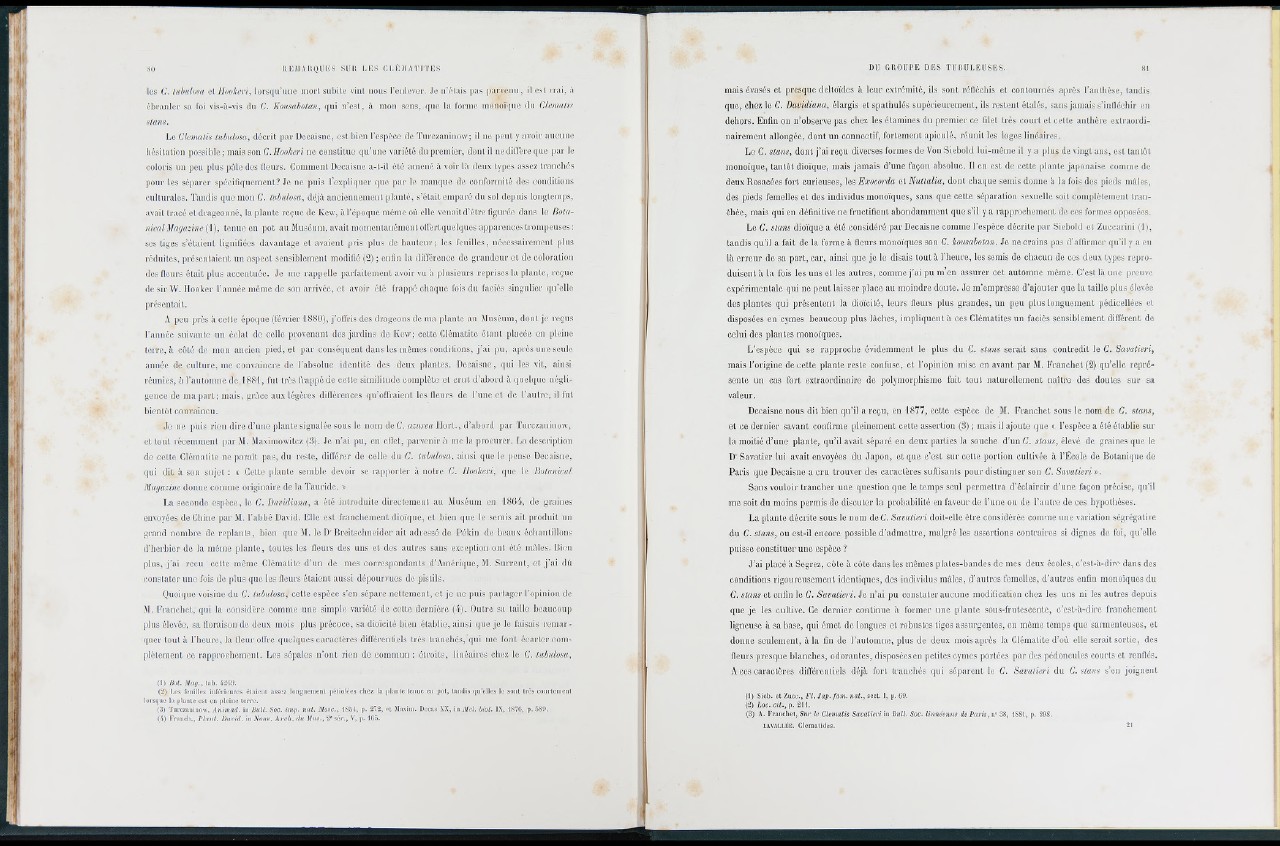
m
les C. udndosa ol I h o /.r r i, lorsiin’iinc mort siibilo vint nous l’ciilevor. Je it’ôlais pas parvenu, ¡I Ost vrai, à
(■'branler sa loi vis-ii-vis du G. Kousahalan, (|ui n’e s t , à mon sen s,-iin e la l'orme mono'ipKi du CAemalis
■dans.
Le CAemalis lidmlosa, décrit par Deeaisne, est bien l'cspéce de Tui'czaninow; il ne peut y avoir aucune
lu'sitafion jiossible; mais son C.Uooke.ri ne constitue ipi’nne variété du premier, dont i! ne diffère cpic par le
color is nn peu pins paie des (leurs. Comment Deeaisne a-t-il été amené ii voir là deux tyjies assez tranclié.s
pour les séparer spécilnfuemcnt? Je ne puis l’expliquer que par le manque de eonrormité des conditions
eultiirales. Tandis i¡ne mon C. iidndosa, déjà ancicnnemetiL ¡ilanté, s’était emparé du sol depuis longtemps,
avait tracé el dragconné, la ¡)latite reçue de Kew, à l’époque même où e lle venait d’être ilguréc dans le B o ta nica
l Maijazine (I ) , tenue en pot an Aluséum. avait momentaiiémcnL offert quelques apiiarenecs trompeuses:
ses Liges s’étaient ligniliées davantage e l avaient pris plus de b anleu r; les l'etiilles, iiécessaircmenL plus
réduites, présentaient un aspect sensiblement modiiîé (2) ; eiiiiii la différence de grandeur e l de coloration
dos Ileurs était ¡)liis acc entuée. Je me rappelle parraitemeiiL avoir vu à plusieurs reprises la plante, reçiuî
de sir AV. Ilooker l’année même de son arrivée, et avoii' été frappé chaque fois du faciès singulier )|ii’elle
présentait.
A peu près à cette épO([uc {février 1880), j ’offris des drageons de ma plante au Muséum, dont j('. r(!çns
r a imé c suivante un éc la t de ce lle jirovenanl des jardins de Ivcw; c e lte Clématite étant placée en pleine
terre, à coté de mon ancien jûcd, e t par conséquent dans les mêmes conditions, j'ai jni, après une seule
année de cnUiirc, me convaincre do l'absolue identité des deux p lanles. D e ea isn e , ([lù les vil, ainsi
réunies, à ra u tonme de 1881, fut très frappé de cette similitude complète et crut d’abord à ([iiebiiic néglig
en c e de ma ])arl ; mais, grâce aux légères dilîérenccs qu’offraient les Ileurs de ITuic e l de l'autre, il fut
bientôt convaincu.
Je ne ¡)uis rien dire d’mie plante signalée sous le nom deC. aziivca Hort., d’abord par Turczaninow,
et tout récemment par M. Maximowitcz (3 ). Je n’ai pu, en ellet, parvenir à me la procurer. La dcsci-iptioii
de cette Clémalite ne parait pas, du reste, différer de c e lle du C. tu b ulosa, ainsi (¡ue le pense Deeaisne,
(¡ni dit à son su je t : « Celte ¡liante sem ble devoir se rap¡)orler à notre C. Hookeri, (¡ne le B ulanicul
Magazine donne comme originaire de la Tauridc. »
La seconde e sp è c e , le C. D ne idiuna, a été inlroduitc dii’CctctneiiL au Miisémn on 18()4, de graines
envoyées d eCliinc par M. l'abbé David. Elle est franchement d ioïq ue , e l ])ien que le semis ait produit un
grand nombre de rcj)lanls, bien que M. le I)'Dr cilschn eid cr ait adressé de l ’ékin de beaux écliaulilloiis
(riicrbicr de la même p la n te , toutes les Ileurs de.s uns et des autres sans exception ont été mâles. Di('n
plus, j ’ai reçu cette même Clématite d ’un de mes correspondants d’Amérique, M. Siirrciit, et j'ai dû
conslater une fois de ¡)lus (¡ne les ibnirs étaient aussi dépourvues de pistils.
Qiioi(¡uc voisine du C. tubulosa, cette e sp èc e s’en sépare iiettement, e l je ne ¡mis partager rofunion do
M. Erancliet, qui la considere comme une simple variété de cette dernière (4 ) . Outre sa taille beaucoup
plus élevée, sa floraison cb? deux mois plus p récoce , sa dio'icilé bien établie, ainsi (pic je le faisais l'cmar*
(¡lier tout à l ’h eure, la lleur olfre queb¡iies caractè re s différeiiLiels très tranchés, qui me font écarter com-
¡ib'teincnl ce ra¡)prochemenl. Les sépales n’on t rien de commun : é tro its, linéaires cliez le C. Imbnlosa,
(I ) Bol. in)}. iâlAJ.
(2) Les fouilles itiféi'icui'Cs élaioiil assez longiiemenl |iétio!écs pliez lu [datile tenue en pol, tandis qu’elles lo sont Irès potirlemciil
lorsque lu planlc esl eu ])leiuo Ierro.
(3) Turczaninow, .{ n im a d . in BiiU. Soc. im p . n a t. Mo sc., ISÔl, p. 272, ci Muxini. Docas XX, in A/ci. h iol. IX, I87G, p. .781).
( i ) lî'îiiicli., P la n t. D iir id . in iVo?£i'. A r c h , d u M u s ., 2' sèr., V, |i. Kiô.
mais évasés et presque dcltoi'des à leur extrémité, ils sont réllécliis et contournés après rau tlièse , tandis
q ue , chez le C. Da v id ia n a , élargis e l spathulés supérieurement, ils restent élab’s, sans jamais s’inlléchir en
dehors. Enfin on n’observe pas chez les étamines du premier ce filet très court e l c e lle anllière extraordinairement
allongée, dont un con n eclif, fortement apiculé, réunit les loges linéaires.
Le C. staus, dont j ’ai reçu diverses formes de Von S iebold lui-même il y a ¡dus de vingt an s, est laritôl
monoïque, tantôt dioïque, mais jamais d’une façon absolue. 11 en esl de cette plante ja¡)Ollaise comme de
deux Rosacées fort curieuses, les Exo c o rd a et N u ila lia , dont chaque semis donne à la fois des pieds mâles,
des pieds femelles et des individus monoïques, sans que cette séparation .sexuelle soit complètement tran-
éhéc , mais qui en définitive ne fructifient abondamment que s’il y a rapprochement de ces formes op¡^osées.
Le C. sla n s dio'ique a été considéré par Deeaisne comme l’e spèc e décrite par Siebold et Zuccarini (1),
tandis qu’il a fait de la forme à fleurs monoïques son C. kousaholau. Je ne crains pas d’affinncr (¡ii’il y a eu
là erreur de sa part, car, ainsi que je le disais tout à l’h eure, les semis de chacun de ces deux types reprod
uisent à la fois les uns et les autres, comme j’ai pu m’en assurer cet automne même. C’est là une pi-i;ii\(!
expérimentale qui ne peut la isse r plac e au moindre doute. Je m’empresse d’ajouter que la taille plu.s élevée
des plantes qui présentent la dioïcilé, leurs fleurs plus grandes, un peu plus longuement p édicellées ct
disposées en cymes beaucoup plu s lâch es, impliquent à ce s Clématites un faciès sensiblement différent de
c elui des plantes monoïques.
L’espèc e qui se rapproche évidemment le plus du C. sia n s serait sans contredit le C. S a v a iie r i,
mais l’origine de cette plante reste confuse, et l ’opinion mise en avant par M. Franehet (2) qu’e lle représente
un cas fort extraordinaire de polymorphisme fait toul naturellement naître des doutes sur sa
valeur.
Deeaisne nous dit bien qu’il a re çu, en 1877, cette espèce de M. Franehet sous le nom de C. stans,
e t ce dernier savant confirme pleinement cette assertion (3) ; mais il ajoute que a l’espèce a été établie sulla
moitié d’une plante, qu’il avait séparé en deux parties la souche d ’un C. s ta n s , élevé de graines que le
D’ Savatier lui avait envoyées du Japon, et que c ’est sur ce lte portion cultivée à l’École de Botanique de
Paris que Deeaisne a cru trouver des caractères suffisants pour distinguer son C. S a v a t i e r i s .
Sans vouloir trancher une question que le temps seul permettra d ’éclaircir d’une façon précise, qu’il
me soit du moins permis de discuter la probabilité en faveur de l’une ou de l’autre de ce s hypothèses.
La plante décrite sous le nom deC. S a v a tie r i doit-elle être considérée comme une variation ségrégative
du C. stans, ou est-il encore possible d ’admettre, malgré les assertions contraires si dignes de foi, qu’elle
p uisse constituer une espèce ?
J ’ai placé à Segrez, cô te à cote dans les mêmes plates-bandes de mes deux écoles, c ’est-à-dire dans des
conditions rigoureusement identiq u es, des individus mâles, d'autres femelles, d’autres enfin monoïques du
C. s ta n s et enfin le C. S a v a tie r i. Je n’ai pu constater aucune modification chez les uns ni les autres depuis
que je les cultive. Ce dernier continue à former une plante sous-frutescente, c ’est-à-dire franchement
ligneuse à sa base, qui émet de longues et robustes liges assurgentes, en môme temps que sarmenteuses, et
donne seulement, à la fin de rau tonm e , plus de deux mois après la Clémalite d’où e lle serait sortie , des
fleurs presque blanches, odorantes, disposées en petites cymes portées par des pédoncules courts et renflés.
A c e s caracières différcnliels diïjà fort tranchés qui séparent le C. S a v a tie r i du C. sla n s s ’eii joignent
(1) Sieb. et Zucc., F l. Ja p . (a n i. n a t., sect. 1, p. 69.
(2) L o c . c i t . , p. 211.
(3) A. Franehet, S u r le C lem a tis S a v a tie r i in B u ll. S oc. lin n é e n n e de P a r is , n“ 38, 1881, p. 298.
LAVALLÉE. Cîcmaliiies. 21