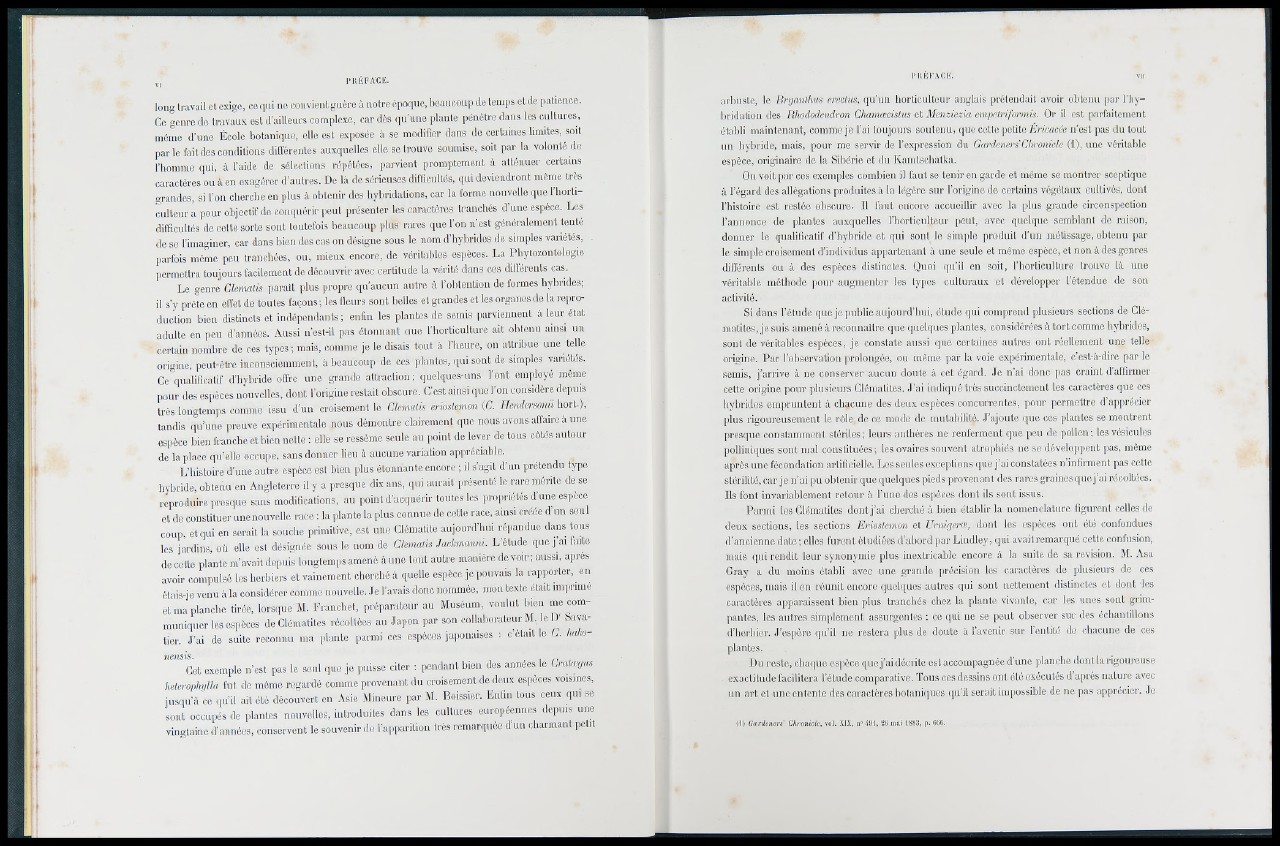
long Iravail c l exige, ce q u i no convient g u è re à n o tre èiioquo, b eau co u p do temps e t de [lalience.
Ce goure de trav au x est d’ailleurs complexe, ca r des q u ’u n e plan te pénètre, d an s les cu ltu re s ,
m ê iM d ’u n e École b o tan iq u e , elle est exposée à se modifier dan s de certaines limites, soit
p a r l e fait des conditions différentes auxque lles elle se trouve soumise, soit p a r la volonté de
l’homme qui, à l’aide de sélections répétées, p arv ien t p rom p tem en t à a tté n u e r ce rtains
ca ra ctè res ou à en exag érer d ’au tre s . De là de sérieuses difficultés, qui d ev ien d ro n t même très
g ran d es, si l'o n clierclie en plu s à o b te n ir des liybridations, ca r la forme nouvelle q u e l’h o rti-
eiiltciir a p o u r objectif de co n q u é rir p eu t p ré sen te r les caractères tran ch é s d ’u n e espèce. Les
difficultés de cette sorte so n t toutefois b eau co u p plus ra re s q u e l’on n ’est g én é ra lem en t ten te
de se l’imaginer, car dans b ien des cas on désigne sous le nom d’b ybride s do simples variétés,
parfois même p eu tranchées, o u , mieux encore, de véritab les espèces. L a Dbytozontologie
p e rm e ttra to u jo u rs facilement de d é couvrir avec ce rtitude la vérité d an s ces différents cas.
L e g en re Clemaks p a ra it plu s p ro p re q u ’aiicu n a u tre à l’olitention de formes hybrides;
il s’y prête en effet de toutes façons ; les fleurs so n t belles et g ran d e s et les organes de la repro-
d iicüon b ien distincts et in d é p e n d a n ts ; enfin les p lantes de semis p a rv ien n en t à le u r état
ad u lte en (leu d ’anné es. Aussi n ’est-il pas é to n n an t u u e l’h o rticu ltu re ait o b ten u ainsi u n
c e rtain n om b re do ces ty p e s; mais, comme je le disais to u t à l’h eu re , on a ttrib u e u n e telle
origine, iieut-être in consc iem ment, à b e au co u p de ces plantes, q u i so n t de simples v an e tes.
C cV m lifîc a tif d’h y b rid e offre u n e g ran d e a ttra c tio n ; q u e lq u e s-u n s l’o n t employé même
p o u r des espèces nouvellos, d o n t l’origine re sta it o bscu re. C’est ainsi q u e l’on considè re depuis
trè s longtemps comme issu d’u n croisement le Chm a lis erioslemon (C. Ilendersonu liort.),
tandis q u ’u n e p reu v e ex p é rimen tale n o u s d ém o n tre clairem en t q u e no u s avons affaire à u n e
espèce liien fran ch e et b ien n e tte ; elle se ressème seule au p o in t de lever de to u s côtés au to u r
de la pla ce q u ’elle occupe, san s d o n n e r lieu à a u c u n e v ariatio n ap|iréciable.
L ’histoire d’u n e a u tre espèce est b ien p lu s é to n n an te encore ; il s’agit d ’u n p ré ten d u type
hybride , o b te n u en A n g le te rre il y a p re sq u e dix an s, q u i a u ra it p ré sen té le ra re m e n te de se
rep ro d u ire p re sq u e san s modifications, au p o in t d ’a c q u é rir toutes les propriétés d’un e espèce
e t de co n stitu er u n en o u v e lle ra c e ; la p la n te la plu s c o n n u e de ce lte race , ainsi créée d’u n seu l
coup et q u i en serait la souche primitive, est u n e Clématite au jo u rd ’h u i rép an d u e d ans tous
les ja rd in s, où elle est désignée sous le n om de Clematis Jac kmanm. L ’élude q u e j ai faite
de cette p lan te m ’avait depuis lo ngtemps am en é à u u e to u t a u tre m an iè re d e v o ir; au ssi, après
avoir compulsé les h erb iers e t v a in em en t che rché à q u elle espèce je pouvais la rapi>orter, e ii
étais-je v en u à la considé rer comme nouvelle. J e l’avais donc nommée, m o n texte était imprime
et ma plan ch e tirée, lo rsq u e M. F ra n e h e t, p ré p a ra te u r a u Muséum, v o u lu t bien me m m -
miin iq u c r les espèces de Clématites réco ltée s au J ap o n p a r son co llab o ra teu r M. le D’ Sava-
tier. J ’ai de su ite re co n n u ma p la n te p arm i ces cspcees ja iionaises : c’e ta il le C. ha ;o
nensis. , , ,
Cet exemple n ’est pas le seul q u e je puisse citer ; p en d a n t bien des anné es le CraUegus
helerophglla fu t de même reg a rd é comme p ro v e n a n t d u croisemen l de deux espcces voisines.
ju sq u 'à ce q u ’il ail été d éco u v ert en Asie Mineure p a r M. Boissier, lin lln to u s ceux q u i se
so n t occupés de plantes nouvelles, in tro d u ite s d an s les cu ltu re s eu ro p é en n e s d epuis u n e
v in g tain e d ’anné es, co n se rv en t le so u v en ir de l’ap p a ritio n très rem a rq u é e d u n ijia rm a n t petit
l'UÉFACE. v„
aib iiste , le Ihiganlhus erectns, q u ’u n liorticiilteui' anglais p rélen d ail avoir o b ten u jiar l’iiy -
b rida lion des lihododtmdron Chamæcistus et Menziezia empeirifnrmis. Or il est p arfaitement
établi m a in te n an t, comme je l’ai to u jo u rs so u ten u , (|uc cette [lelite JirirMcée n ’est pas du tout
u n hybride , mais, p o u r me serv ir de l’expression du Gnrdeners’CJironkle (1), u n e vérilable
espèce, originaire de la Sibérie et du Kamtscb atk a.
On voit p a r ces exemples combien il fau t se te n ir en g a rd e et même se m o n tre r sceptique
à l’ég a rd des allégations |irodiiites à la légère s u r l’origine de ccrUiins végétaux cultivés, dont
l’histoire est resté e obscure- Il fau t encore accueillir avec la pin s g ran d e circonspection
l’an n o n c e de )ilantes anx(|uelles rh o rtic u lte u r peut, avec q u elq u e s em b lan t de raison,
d o n n er le qualificatif d’h y b rid e et q u i so n l le simple p ro d u it d’u n métissage, o b ten u par
le simple croisement d’individus a p p a rten an t à u n e seule et même espèce, e t n o n à des genres
différents ou à des espèces distinctes. Quoi q u ’il en so it, l’b o rtic iillu re trouve là u n e
v éritable mé th o d e p o u r au gm en te r les types cu ltu rau x et développer l’éten d u e de son
activité.
Si d an s l’étude q u e je publie au jo u rd ’hui, é lu d e q u i com prend p lusieurs sections de Clématites,
je suis am en é à re co n n a ître q u e q u elq u es plantes, considérées à to rt comme hybrides,
so n t de véritables espèces, je co n sta te aussi q u e ce rtaine s au tre s o n t réellem en t u n e telle
origine. P a r l’observation prolongée, ou même ]iar la voie expérimentale, c’est-à-dire p a r le
semis, j’arrive à n e co n serv er au c u n d o u te à cet ég a rd . J e n ’ai donc pas c ra in t d’affirmer
cette origine ]jour p lu sieu rs Clcmatiles. J ’ai in d iq u é trè s succinctement les ca ractères ([ue ces
h y b rid e s em p ru n te n t à ch a cu n e des deux espèces co n cu rren te s, p o u r pe rm e ttre d’apprécier
p lu s rig o u re u sem en t le rôle de ce mode de mutabilité . J ’ajo u te (¡ue ces plantes se m o n tren t
p re sq u e co n s tam m en t stériles; le u rs an lh è re s n e ren fe rm en t q u e peu de p o llen ; les vésicules
p o liinique s so n t mal co n stitu ée s; les ovaires so u v en t atrophiés ne se déveloiipent pas, même
ap rès u n e fécondation artificielle. Les seules exceptions q u e j ’ai constatées n ’in firmen t pas cette
stérilité, ca r je n ’ai p u o b ten ir q u e q u elq u es pieds ])rovenaiit des ra re s graines qu e j ’ai récoltées.
Ils fo n t in v a riab lem en t re to u r à l’u n e des espèces d o n t ils so n t issus.
P a rm i les Clématites d o n t j ’ai che rché à bien é tab lir la n om e n c la tu re fig u ren t celles de
d eux sections, les sections Kiiostemon et Urnigeroe, d o n t les espcces o n t été conlondues
d ’an c ien n e d a le ; elles fu re n t étudiées d’ab o rd p a r Lin d ley , q u i avait rem a rq u é cette conlusion,
mais t[ui re n d it le u r sy nonymie plu s inextric able en co re à la su ite de sa révision. M. Asa
C ray a du moins établi avec u n e g ran d e précision les ca ractères de p lusieurs de ces
espcces, ma is il en ré u n it encore q u elq u es au tres qui so n t n e ttem en t distinctes et d o n t les
ca ra ctè res ap p a ra issen t bien p lu s Iranclics chez la p lan te vivante, car les un es so n t g rim pantes,
les au tre s s im|ilen icn l assu rg cn tc s : ce cpii ne se p eu t o bserver s u r des écbaiilillons
d ’h erbier. J ’espère q u ’il n e re s te ra [ilus de d o u te à l’aveiiii' su r l’oiitilé de ch a cu n e de ces
plantes.
D u re s te , ch aq u e espèce q u e j ’ai décrite e st accompagnée d’u n e planche d o n t la rig o u reu s e
ex a c titu d e facilitera l’é tu d e comparative. To u s ces dessins o n t été exécutés d ’ap rès n a tu re avec
u n a r t et u n e en ten te des ca ra ctè res bo tan iq u es iju’il serait imiiossible de n e pas apprécier. Je
(I) Curdciion' Chronicle, vol. XIX, 11“ 491, mai 1883, p. G66.