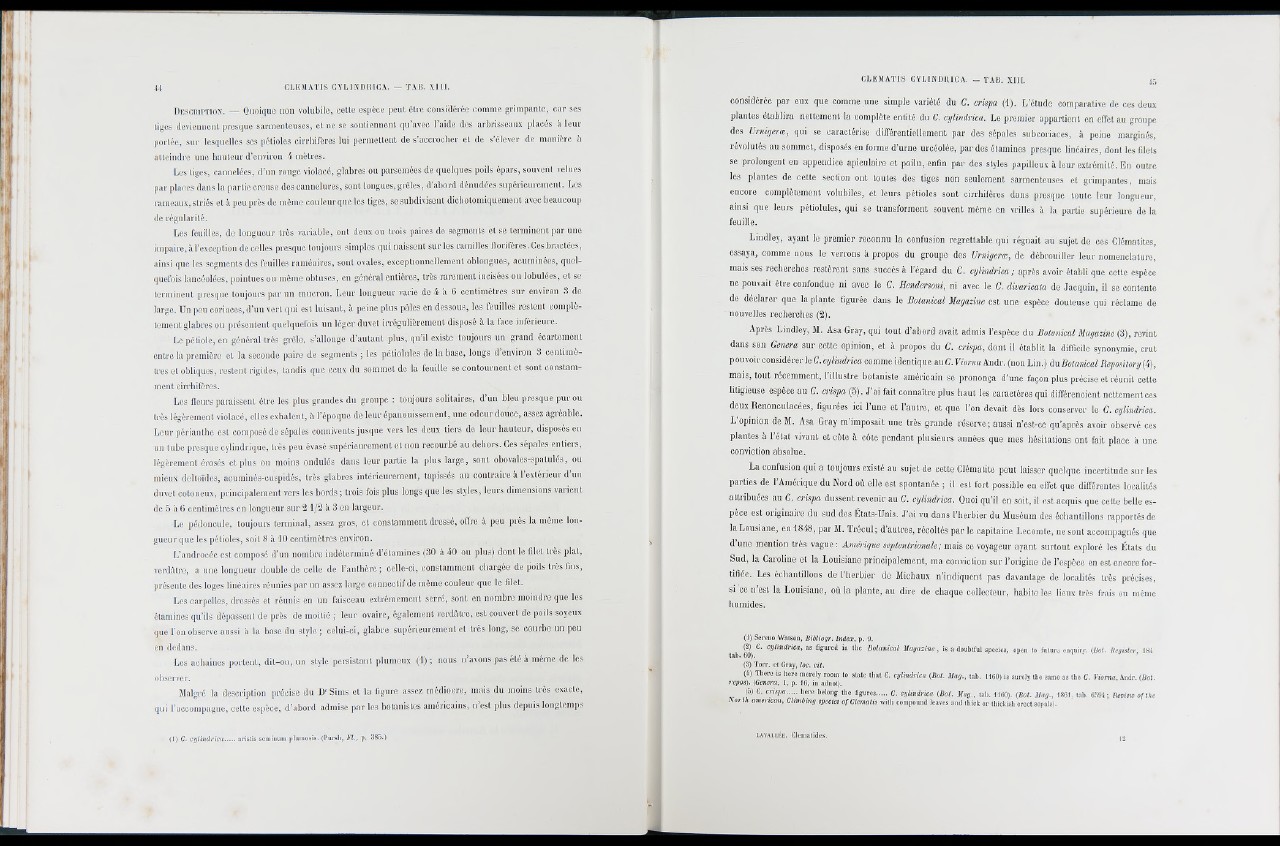
I liîsin iir a iis. — Oiu)ii|uc non volubilc, ccUc espèce peul êlrc considcrcc comme grimpante, car scs
liges ileviciincnt presque sarnicnlcusos, ct uc sc soulieniient qu’avec l’aide des arbrisseaux placés h leur
IKirléc, sur lesquelles scs pétioles cirrbilcres lui permettent de s ’accrocbcr ct de s’élever de inarnérc à
atteindre une bailleur d'environ -4 mètres.
Les tiges, ciiiineiccs, d ’un rouge violacé, glabres ou parsemées de q uelques poils épars, souvent velues
par places dans la parlie creuse des canuelurcs, son l longues, grêles, d'abord d énudée s supérieurcmcul. Les
rameaux, slriés c l à peu près de même couleur que les tiges, sc subdivisenl d id io lomiqu em en t avec beaucoup
de régularité.
Les feuilles, de longueur très variable, ou i deux ou trois paii-es de segmenis e l sc lerminenl par uue
impaire, iirex c ep lim i de ce lle s presque loujours simp le s qui uaisscnl sur les ramilles llorifères. Ces b ra d é e s,
ainsi que les segmenis des feuilles raméaires, s eu l ovales, cxccp lion n cllemc iil oblongnes, aciirainccs, quelquefois
lanc éolée s, poinlucs ou même ob lu ses, en général entièi-es, très rarement incisées ou lobu lée s, e l sc
terminent presque loujours par un miiei'on. Leur longueur varie de 4 a G centimètres sur environ 3 do
large. Un peu coriaces, d’un vert qui est luisan t, à peine plus pâles en d essous, les feuilles restent coiiiplè -
lemon l glabres ou présentent quelquefois un léger duvet irrégulièrement disposé à la face inférieure.
Le pétiole, en général très grê le, s ’allonge d 'au lant plus, qu’il existe toujours un grand écartement
entre la pi'einiérc et la seconde paire d e segm en is ; les p élio lu les de la base, longs d’ciiviroii 3 c en tim è tres
et obliiiucs, restent rigides, tandis que ceux du sommet de la feuille se contournent ct sont co iislam-
meut cirrliifères.
Les neurs paraissent être les plus grandes du groupe : toujours solitaires, d’un bleu presque pur ou
très légèrement violacé, e lles exb alen t, à l’époque de leur épanouissement, une odeur douce, assez agréable.
Leur périauthe est composé de sépales comüvciits jusque vers les deux tiers de leur hauteur, disposés en
un tube presque cylindrique, lié s peu évasé supérieurement ct non recourbé au dehors. Ces sépales entiers,
légèrement érosés ct jibis ou moins ondulés dans leur p arlie la plus large , son t ob ovale s-spatulé s, ou
mieux deltoïde s, acuminés-cuspidés, très glabres intérieur ement, tapissés au contraire à l’extérieur d ’un
duvet cotuncux, p rincipalement vers les bords ; trois fois plus longs que les styles, leurs dimensions varient
de 5 il G cenlimètres en longueur sur 2 1/2 à 3 en largeur.
Le pédoncule, toujours terminal, assez gros, e l constamment dresse, olfre â peu près la même longueur
que les pétioles, so it 8 ii 10 centim ètr es environ.
L’androcée est composé d’un nombre indéterminé d’é tamine s (30 à 40 ou plus) dont le filet très plat,
verdâtre, a une longueur double de c e lle de l’anthère ; ce lle -c i, eonstammenl chargée de poils très fins,
préscîUc des loges linéaires réunies par un assez large c om ie e lif de même couleur que le filet.
Les carpelles, dressés et réimis en un faisceau extrêmement serré, sont on nombre moindre que, les
élamines qu’ils dépassciil de prés de moitié ; leur ovaire, également verdâtre, est couvert de poils soyeux
que l’on observe aussi il la base du style ; ce lu i-c i, g labr e supérieurement ct très long, sc courbe un peu
en dedans.
Les aeliaiiies purtciit, d it -o n , un style persistant phiuicux (1) ; nous n’avons pas été â même de les
nbservcr.
Malgré la description précise du li' Sims ct la figure assez médiocre, mais du moins très exacte,
qui rac cou ipagu e, cette espèce, d ’abord admise par les botanistes américains, ii’csl [dus depuis luiiglcinps
( I ) C. cylindrica a ris lis scniiiiuiu |ilu in o sis. (l'u rs li, h'I., p. 385.)
considérée par eux que comme une simple variété du C. crispa ( i ) . L ’étude comparative do ce s deux
p lanles établira nettement la complète entité du C. c y lin d rica . Le premier apiiarlient en effet au groupe
des Urnigerm, qui se caractérise d ilférentiellcment par des sépales subcoriaces, â peine margines,
l'évolulés au somm et, disposés en forme d’urne urcéolée, par des étamines presque linéaires, dont les filets
sc prolongent en .appendice apiculaire ct p oilu , enfin par des styles papilleux â leur extrémité. En outre
les plantes de ce lte see lion ont toutes des liges non seulement sarmenteuscs et g rimpantes, mais
encore complètement volubiles, et leurs pétioles sont cirrliifères dans presque toute leur longueur,
ainsi que leurs p élio lu les, qui se transforment souvenl même en vrilles à la partie supérieure de la
feuille.
Lindley, ayant le premier reconnu la confusion regrettable qui régnait au sujet de ce s Clématites,
essaya, comme nous le verrons à propos du groupe des Urnigeroe, de débrouiller leur nomenclature,
mais ses recherclies restèrent sans succès â l’égard du C. c y lin d r ic a ; après avoir établi que cette espèce
ne pouvait être confondue ni avec le C. H e n d e r sm i, ni avec le C. diva rica ta de Jacquin, il se contente
de déclarer que ta plante figurée dans le B o ta n k a l Magazine est une espèce douteuse qui réclame de
n ouvelles recherches (2),
Après Lindley, M. Asa Cray, qui tout d’abord avait admis l’espèce du B o ta n k a l Magazine (3), revint
dans son Genera sur cette opinion, et â propos du C. crispa, dont il établit la difficile synonymie, crut
pouvoir considérer \aC . c y lin d rica comme identique au C. Viorna Andr. (non L in .) du Bo lamca l Beposilorg (4),
m a is , lo u t récemment, l ’illustr e botaniste américain se prononça d’une façon plus précise et réunit cette
litigieuse espèce au C. crispa (5 ). J ’ai fait connaître plus haut les caractères qui différencient nettement ces
deux Renon cu lacée s, figurées ici l’une e l l’aulre, et que l’on devait dès lors conserver le C. cy lin d rica .
L’opinion de M. Asa Cray m ’imposait une très grande réserve ; aussi n’est-ee qu’après avoir observé ces
plantes â l ’état vivant et côte à côte pendant plusieurs aimées que mes hésitations o n l fait p lace à une
conviction absolue.
La confusion qui a toujours existé au sujet de cette Clématite peut laisser quelque incertitude sur les
parties de l ’Amérique du Nord où e lle e s l spontanée ; il e st fort possible en effet que différentes localités
attribuées au C. c rispa dussent revenir au C. cy lin d r ica . Quoi qu’il en so it, il est acquis que cette belle esp
èce est originaire du sud des États-Unis. J’ai vu dans l'herbier du Muséum des échantillons rapportés de
laL o u sia n e , en 48-48, p arM. Trécul; d’autres, récoltés p a r le capitaine Lecomte, ne son t accompagnés que
d ’une mention très vague: Am é r iq u e sep ten lr io n a le ; mais ce voyageur ayant surtout exploré les États du
Sud, la Caroline et la Louisiane principalement, ma conviction sur l'origine de l ’espèce en est encore fortifiée.
Les écliantillons de l’hcrbier de Micliatix n’indiquent pas davantage de localités très précises,
si ce n’est la Louisiane , où la plante, au dire de chaque colicctciir, habite le.s lieux très frais ou même
humides.
(1) Sereno VValson, Bibliogr. Index, p. 9.
lab 60) J*»'“ ’“'“ ' nm u cm , . is s âo n b tfu l species, open lo fnlnee cnqnin-, (Bot. H,giütr. IS l
(3) T o rr. c t Gray, loc. cit.
( i) Tlicre is h e re m e re ly room lo s la te th a t C. cylindrica (Bot. Mag., la b . tI6 0 ) is su rely Ihe same as Ihe C. Andr. (Bot.
repos). (Genera, I, p. 16, in adiiol). / J . v
(5) C. crispa..... h e re belong th e figures C. cylindrica (Bol. Mag., tab . H 6 0 ). (Bot. .Mag., i8 6 f . lab . 6 5 9 4 ; lieview of the
IS or til amencan. Climbing species o f Clemalis wiih compound leaves an d th ick or thickisli e re c t sepals).
L.AVA1.LÉE. Cienialidcs.