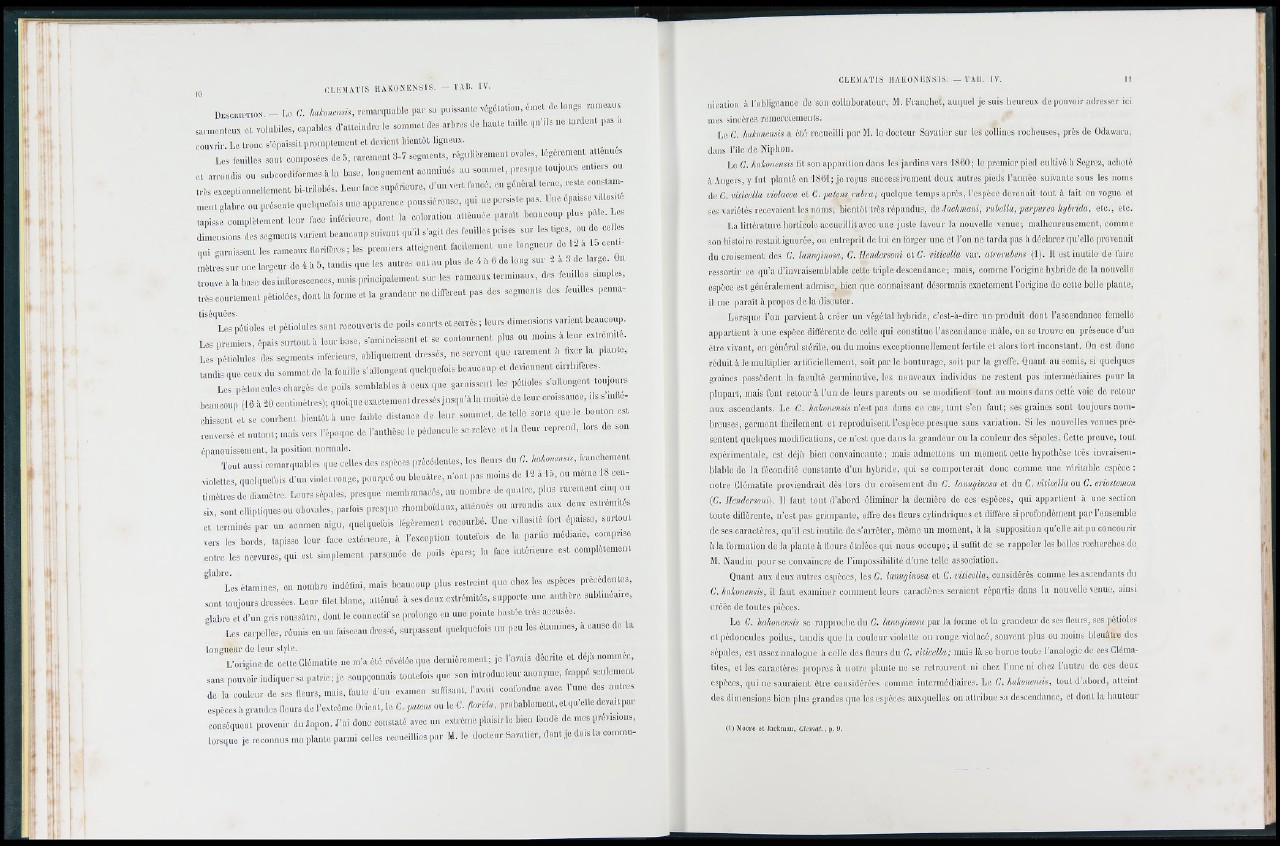
Il !
DESciumo,-.. - Lr c . h a io m m i s , .•c.n»«ii.ablo par sa piiissa.ilc végcUUioii, êin cl de longs ramoanx
san nculcu x ol volnbilos. oajiablos d'alloindro lo sommol dos arbres do baulo Udllo qu ’d s no lardonl pas a
couvrir. Lo tronc s ’épaissit promptcnient ct devient bientôt ligneux. ^ ^
Les feuilles sont eo,„posées do 5 . rare.nonl 3 -7 segments, rcgnlièrenienl ovales, légèrement altcnnes
K arrondis on snbeordiformes à la base, longnement aeuminès au somm et, presque toujours eutiers ou
L è s oxoeptiounellemeut bi-trilobès. Leur lace snpèrieuro. d’uu vert Ibucè, ou général terne, reste eoustam-
mcul elabre ou présente quelqnelbis une apparence p oussiér eu se, qui ne persiste pas. Uue epa.sse vdlosile
tapissé eomplétetneul leur l'aee inférieure, dont la coloration atténuée parait beaucoup plus pale. Les
dunctisious des segments varient beaucoup suivant qu’il s’agit dos feuilles jirises sur les liges, ou t e celles
,,u i garnissent les rameaux llorifères; les pre.uiers a tle ig .ieu l fae ilemeu t uue longueur de i ù a lu ceti .-
.„êtres sur uue la.gen r de 4 à 5 . tandis ,,u e les autres ont au plus de 4 à (i de long sur -2 a do la. go. Ou
trouve à la base des runorcseeuees. .„ a .s priueipalement su r les rameaux teruuuaux, des leu d ic s simples,
t r è s e o u r lem e u tp é lio lé e s ,d o „ t la fo rm e e lla g .am d e u r „ e d .f f è .- e ,.lp a s des seg .n eu ls dos Icu.Ues pouualisé
(|u6es. . . , ,
Les pétioles c l p éliolules son t reeonverts de poils courts et serrés ; leurs dimens.ons van en t bcaueoup.
Les premiers, épais surtout à leur base, s’a .niueissent et se con lourncnt plus ou n.oms à leur extrémité.
Les péliolules des segments .uférieu.-s, obllt,„erneut d ressés, ne sorvcut q ,.e ra.-eme„t à llxer la plante,
taudis que ceux du sommet de la feuille s ’a llong ent ijuclipiefois beaucoup ct deviennent cirrhiferes.
Les pédoueules chargés de poils sem blab le s à ceux que garuisseul les pétioles s’a llon g cn l toujours
beaucoup (16 à 2 0 centimetresl; quoique cxae tem eiü dressés jusqu’il la moitié de leur croissan ce , ils s ii.nc -
cbisseut e l se eourbeul b ie .itè là uue faible dislau ee de leur somm et, de telle sorte que le bouton est
renversé et uutaut; mais vers l’époque de l’authèse le pédoueule se re lève et la lleur reprend, lors de sou
éiianouiRsenieiit, la posilioii iiornicile.
Tout aussi re.naripiables que c e lle s des espèc es ju-écédcnlcs. les Ileurs du C. h a kom um s , Irauchcmcut
violettes, q uelquefois d’uu violet rouge, pouiqiréou bleuâtre, i.’ou l pas moins de 12 à 15. ou même 18 ec .i-
timêlres de diamètre. Leurs sépales, presque .iierabranacés, au nombre de ijuatre, jibis raremoul ciuij ou
six son t elliptiques ou obovales. parfois presque rhomboïdaux, atténués ou arrondis aux deux extremiles
et ’terunués par un ac.imeu aigu, quelquefois légèrement recourbé. Une villosité fort épaisse, surtout
vers les bords, lapisse leur face exténour e, i. l’exeeptiou toutefois de la partie médiane, comprise
entre les nervures, qui est simplement parsemée de poils épars; la faeo iulérieure e st complètement
étamines, eu nombre indéfini, mais beaucoup plus restreint que chez les espèces p réc éd en tes,
sont toujours dressées. Leur filet blan c, atténué à ses deux extrémités, supporte une anthère subbneaire,
-lab r e et d’un gris roussîitre, dont le con n e c lif se prolonge eu une i.oiiite luistcc très accusée.
Les carpelles, rciu.is en mi faisceau dressé, siirpassciil .juckiuefois un peu les étaiiiiiics, i. cause de la
longueur de leur slylü.
L’origine de cette Clématite ne m’a été révélée que dcn iié rem eiit; je Tavais décrite ct dcpi uominec,
sans pouvoir indiquer sa patrie ; je soupçonnais toutefois que son iulroduelcur anonyme, frappé seu lement
d e la couleur de ses Ileurs, mai.s, faute d'iu. examen suffisaut, l’avait confondue avec l ’une des autres
espèces i. grandes (leurs de l ’extrè.nc Urie.it, le C. patens ou le U. ß o r id a . probablement, et qu’elle d cvaitpar
conséquent provenir du Japon. J ’ai donc constaté avec un extrême plaisir le bien fondé de mes prévisions,
lorsque je reconnus ma plante parmi ce lle s re cueillie s par M. le doclei.r Savaticr, dont je dois la eommu-
C L E M A T I S I IA K Ü eN E iN S I S . - T A B . IV . 11
iiicution à l’obligcaiicc de sou colhiboralüur, M. F r a iid ic t, uuîiuoI je suis Ifcurcux de pouvoir adresser ici
mes sincères remerciements.
Le C. hukommsis a été recueilli par M. le docleur Savaticr sur les colline s rocheuses, près de Odawara,
dans n i e de Niphon.
Le C. hakoiiensis lit son apparition dans les jardins vers -1800; le premier pied cultivé à Segrez, acheté
à.Vti'^crs, y l u t planté eu 18GI; je reçus successivement deux autres pieds l’année suivante sous les noms
de C. v itic e lla violacea c l C. p a ten s r u h ra ; quelque temps après, l’e sp èc e devenait tout à lait eu vogue ct
s c s v a r i é t é s recevaient les noms, bientôt très répandus, i\(i J a c km a n i, riiùeUu, pui-purea h y b r id u , e t c ., etc.
La littérature horticole a ccue illit avec une ju ste laveur la nouvelle venue; malheureusement, comme
son histoire restait ignorée, on entreprit de lui eu forger uue et l ’on ne larda pas à déclarer qu’elle provenait
du croisement des C. laiiuy inosa, C. Hendevsoni et C. vitic e lla var. alro n ib e n s ( i ) . Il e st inutile de faire
ressortir ce qu’a d’invraisemblable c e lle triple descendance; mais, comme l’origine hybride de la nouvelle
espèce est généralement admise, bien que connaissant désormais exactement l’origine de cette belle plante,
il me parait à propos de la discuter.
Lorsque l ’on parvient à créer un végétal hybride, c ’esl-à -dirc un produit dont l ’ascendaiice femelle
appartient à une espèce différente d e ce lle qui constitue l’ascendance mâle, on se trouve en présence d’uu
être vivant, eu général stérile, ou du moins cxccplionnellcmcnL fertile ct alors fort inconstant. On est donc
réduit à le muUiplicr artificiellement, soit par le bouturage, soit par la greiTe. Quant au semis, si quelques
graines p ossèdent la faculté gcrminalivc, le s nouveaux individus ne restent pas intermédiaires pour la
plupart, mais font retour à l’iiii de leurs parents ou se modifienl tout au moins dans ce lte voie de retour
aux ascendants. Lc C . n’est pas dans ce cas, tant s’cn faut; ses graines sont toujours nombreuses,
germent facilement c t reproduisent r c sp é c c presque sans variation. Si les nouvelles venues présentent
quelques modifications, ce n’est que dans la grandeur ou la couleur des sépales. Celte preuve, tout
expérimentale, est déjà bien con vaincante; mais admettons un moment cette hypothèse très invraisemblable
de la fécondité constante d’iui hybride, qui se comporterait donc comme une véritable espèce :
notre Clématite proviendrait dès lors du croisement du C. lanuginosa et du C. v itic e lla ou C. eriostemon
(C. llen d e r so n i). Il faut Lout d’abord éliminer la dernière de ce s espèces, qui appartient à une section
toute différente, n’e st jias grimpante, ofl're des fleurs cylindriques et diffère si profondément par l ’ensemble
de ses caractères, qu’il est in u tile d e s’arrêter, même un moment, à la supposition qu’e lle ait pu concourir
à la formation de la plante ii Ileurs étalé es qui nous o ccup e; il suffit de se rappeler les belles recherches de
M. Naudin pour sc convaincre de r im p o ssibilité d’une te lle association.
Quant aux deux autres espèces, les C. lanuginosa et C. vitic e lla , considérés comme les asceiidanls du
6’. hakoncnsis, il faut examiner eomment leurs caractères seraient répartis dans lu nouvelle venue, ainsi
cr éé e de toutes piè ce s.
Lo C. hakoncnsis sc rapproche du C. lanuginosa par la forme ct la grandeur de ses fleurs, ses pétioles
et pédoncules p oilu s, tandis (¡uc la couleur violette ou rouge violacé, souvent plus ou moins bleuâtre des
sépales, est assez analogue à c e lle des Ileurs du C. v itic e lla ; mais lu sc borne toute l'analogie de ces Clématites,
ct les caractères propres à notre plante ne sc retrouvctiL ni chez l’une ni chez l’autre de ce s deux
espèces, qui ne sauraient être considérées comme iiiLcnnédiaires. Lc C. liukonensis, tout d’abord, atteint
des dimensions bien plus grandes que les espèces auxfjuelles on attribue sa descendance, e l dont la hauteur
(1) iMoore e t .lackman, Clemat., p. 9.