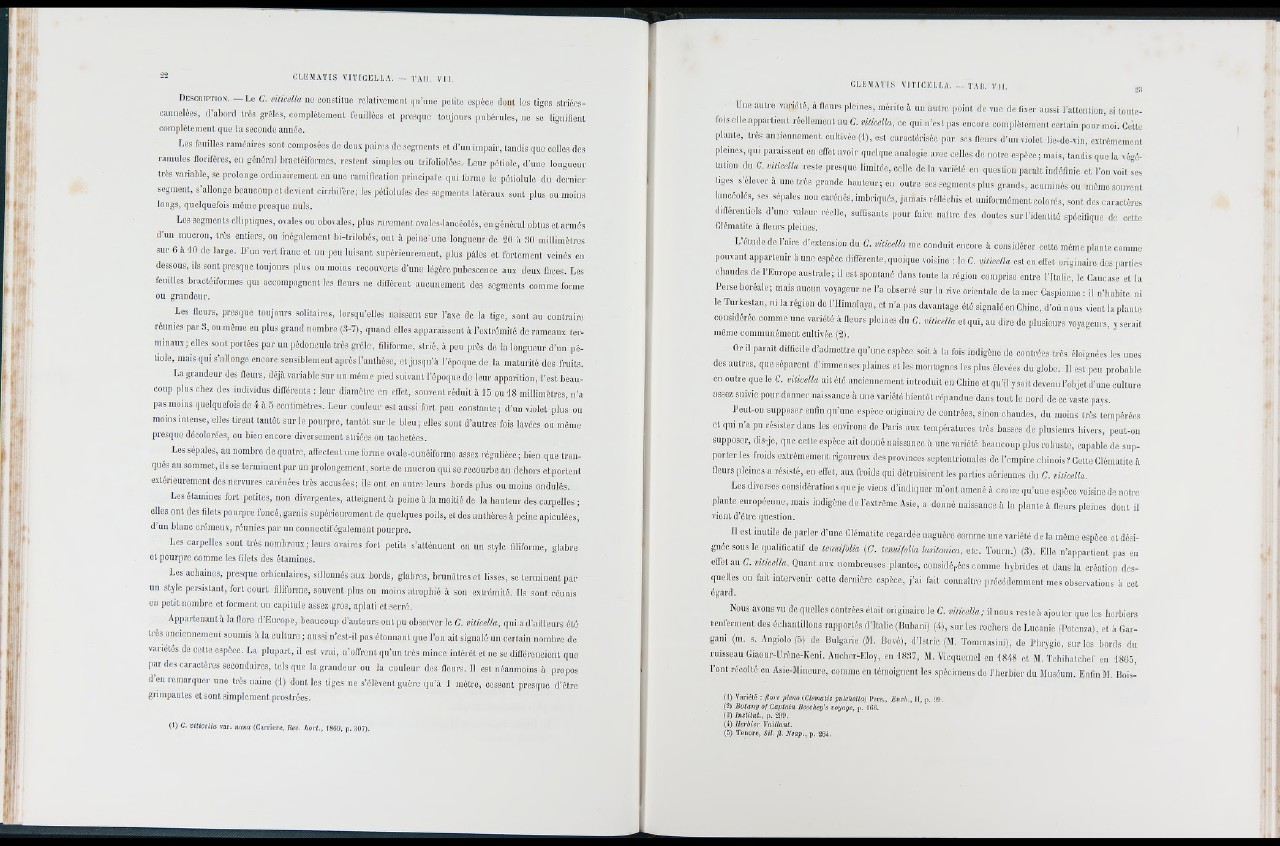
D i s c r i p t io x . — l.c C. r ilic d la ne con.sliUic rchilivemeiU qu'une p etite espèc e dont les liges slriéc s-
cannclée s. d’aboi'd 1res gi-ôles, coin iilè lemcn t fouillées ol presque lonjours pubcrules, iic sc ligiiificnl
complètement que la seconde année.
Les feuilles raméaires sont composées de deux paires de segmciiis ct d ’un impair, tandis que ce lle s des
ramilles florifères, en général bracléiformes, rcslont simp le s ou Irifolioléos.-Leur p c lio le , d'une longueur
très variable, se prolonge ordinairemenl en imc ramificalioii lu iiicip a le qui forme le p c lio lu le du dernier
segment, s ’a llonge beaucoup e l devient chTliifèrc; les p éliolules des scgm eiils latéraux sont plus ou moins
longs, quelquefois même presque n uls.
Les segments cllipiique s, ovales ou obovales, plus rarcineiit ovalcs-lanccolés, en général oblus et armés
d’un mucron, très en licrs, ou inégalement bi-lr ilob és, on l à p e in e 'u n e longueur de 2 0 ii 30 m illlm èlrc s
sur 6 à 10 de large. D’un verl franc et un peu luisan t supérieurement, plus pâles e l for lcment veinés eu
dessous, ils so n l presque toujours plu s ou moins recouverts d’une légère pubescence aux deux faces. Les
feuilles bracléiformes qui accompagnent les fleurs ne difl’èrcnt luicuiicment des segmenis com me forme
ou grandeur.
Les fleurs, presque toujours so lila ire s, lorsqu’elles naissent sur l’axe de la tig e, sont au contraire
réunies par 3 , ou même en plus grand nombre (3 -7 ), quand elles apparaissenl à l ’extrémilé de rameaux ler-
minaux ; e lle s sonl portées par un pédoncule très g rê le, filiforme, slr ié , il peu près de la longueur d’un pétiole,
mais qui s ’allonge encore sensiblement après l’a iiüièse , ct ju squ ’il l ’époque de la maturité des fruits.
La grandeur des fleurs, déjà varinide sur un même pied suivant l ’époque d e leur apparition, l ’e st beaucoup
plus chez des individus différents : leur diaiuèlre on effet, souvent réduit à '15 ou '18 millimétr és, n’a
pas moins quelquefois de 4 à 5 centimètres. Leur couleur est aussi fort peu con sta iile ; d ’un violet plu s ou
moins intense, elles tirent tantôt sur le pourpre, tantôt sur le b leu ; elles sont d ’autres fois lavées ou même
presque décolorées, ou bien encore diversement striées ou tachetées.
Les sépales, au nombre de quatre, affccteut une forme ovale-ciinéiforme assez régulière ; bien que tronqués
au sommet, ils se terminent par un prolongement, sorte de mucron qui se recourbe au dehors ct portent
extcneurement des nervures carénées très a ccusé es; ils ont en outre leurs bords plus ou moins ondulés.
Les élamines fort p etite s, non divergentes, atteignent à p eine à la moitié de la hauteur des carpelles ;
e lle s ont des filets pourpre foncé, garnis supérieurement de q uelques poils, et des anthères à peine apiculé es,
d'un b lanc crémeux, réunies par un com ie c tif également pourpre.
Les carpelles son t très nombreux ; leurs ovaires fort petits s’a tténuent en un style filiforme, glabre
cl pourpre comme les filets des étamines.
Les achaines, presque orbiculaires, sillon né s aux bords, glabres, brunâtres ct lisse s, se terminent par
un style persistant, fort cou rt fllifon ne , souvent plus ou moins atrophié à son extrémité. Ils son t réunis
CI) petit nombre et forment un capitule assez gros, aplati e t serré.
Appartenant à la flore d ’Europe, beaucoup d’auteurs ont pu observer le C. v itic e lla , qui a d ’ailicurs été
très anciennement soumis à la culture ; aussi n’est-il pas étoimant que l ’on ait signalé un certain nombre de
variétés de cette esp èc e. La plupart, il est vrai, u ’oifrent qu’un très m in ce intérêt et ne se différencient que
par des caractères secondaires, tels que la grandeur ou la cou leu r des fleurs. Il esl néanmoins à propos
d en remarquer une très naine ( i ) dont les tiges ne s ’élèvent guère qu’à 1 mètre, ce ssen t presque d ’être
grimpantes et son t simplement prostrées.
( i ) C. viticella v a r. nana (C a rr iè re , Rev. hort., 1869, p . 307).
C L E .M A T IS V I T I C E L L A . — T A U . V I I .
Une autre varieté, à fleurs p le ine s, mérite à un autre point de vue de fixer aussi l ’attention, si toutefois
elle appartient réellement au C. v ü k d l a , ce qui n’e st pas encore com iilèlemeiit certain pour moi. Cette
plante, très aiieicmiemeut cultivée ( i ) , est caractérisée par scs fleurs d’un v io let lie-do-vin, extrômemeiit
p leines, qui paraissent en effet avoir quelque analogie avec c e lle s do notre espèce; mais, tandis que la végétation
du C. n tic eU a reste presque limitée , c e lle de la variété en question paraît indéfinie et l’on voit ses
tiges s’ffievcr à une très grande liaulciir; en outre scs segments plus grands, aetiininés ou même souvent
lancéolés, ses sépales non carénés, imbriqués, jamais réfiéchis ct uniformément color és, sont dos caractères
différentiels d ’une valeur ré elle, suffisants pour faire naître des doutes sur l’identité spécifique de cette
Clématite à Ileurs pleines.
L’étude de l ’aire d’extension du C. v i t k d l a me conduit encore à considérer cette même plante comme
pouvant appartenir à une espèce différente, quoique voisine : le C. v itic d la est en effet originaire des parties
cliaudes de l’Europe australe; il est spontané dans toute la région comprise entre l ’Ita lie , le Caucase et la
Perse boreale; mais aucun voyageur ne l’a observé sur la rive orientale de la mer Caspienne : il n’Iiabitc ni
le Turkestan, ni la région de r ilim a la y a , et n ’a pas davantage été signalé en Chine, d’où nous vient la plante
considérée comme une variété à fleur., ple ine s du C. v i t k d l a e l qui, au dire de plusieurs voyageurs, y serait
même communéraont cultivée (2).
Or il paraît difficile d ’admettre qu’une espèc e soit à la fois indigène de contrées très éloignées les unes
des autres, que séparent d’immenses plaines et les montagnes les plus élevées du globe. Il est peu probable
en outre que le C. v i t k d l a ait été anciennement introduit eu Cliine et qu’il y so lt devenu Tobjetd’iine culture
assez suivie |)Our donner naissance à une variété Jiienlôt répandue dans tou t le nord de ce vaste pays.
Peut-on supposer enfin qu’une espèc e originaire de contr ées, sinon cliaudes, du moins très tempérées
et qui n’a pu résister dans les environs de Paris aux lempcraturcs très b asse s de plusieurs Itivers, peut-on
supposer, dis-je, que cette espèce a it donné naissance à une variété beaucoup plus robuste, capable de supporter
les froids extrêmement rigoureux des provinces septentrionales de l’empire cliinois? Cette Clématite à
fleurs plenie s a résiste, en effet, aux froids qui détruisirent les parties aériennes du C. v i t k d l a .
Les diverses coiisidéralions que je viens d ’indiquer m ’on t amené à croire qu’une espèc e voisine de notre
plante européenne, mais indigène de l’extrèine .Asie, a donné naissance à la plan te à fleurs ple ine s dont il
vient d’être question.
Il est mutile de parler d’une Clématite regardée naguère comme une variété de la même espèce et désignée
sous le qualificatif de tc im ifo lia (C. ic im ifo lia lu s itm ia i , e tc . Toiirii.) (3 ). Elle n’appartient pas en
effet au C. v i t i c d la . QuaiU aux nombreuses plantes, considé,.ées comme liybrides et dans la créalioii desq
ue lle s on fait intervenir cette dernière espèce, j ’ai fait connaître précédemment mes observations à cet
égard.
Nous avons vu de que lle s contrées était originaire le C. v itic e lla ; il nous reste à ajouter que les herbiers
renferment des éc liantilloiis rapportes d’Italie (Bnbani) (.t), sur les rochers de Lucanie (Potenza), et à Gar-
gam (m. s. Angiolo (5) de Bulgarie (M. Bové), d'istr ie (.M. Tommasini), de Plirygio, sur les bords du
ruisseau Giaour-Urènc-Keni. Auclicr-Eloy, en 1837, M. Vicqucmcl en 18-48 et M. Tehilmtclief en 1 8 6 3 ,
l ’ont récolté en A sie -llin cu r c , comme en témoignent les spécimens d e l ’iierbier du Muséum. Enfin M. Bois-
(1) Variété : flore pieno (Clemalis pulcheUa) P e rs ., Ench., II, p. 99.
(2) Botany o f Capiain Becchey’s voyage, p. 166.
(3) Institut., p. 299.
(4) Herbier Vaillant.
(5) T e n o re , SU. fl. Neap., p. 264,