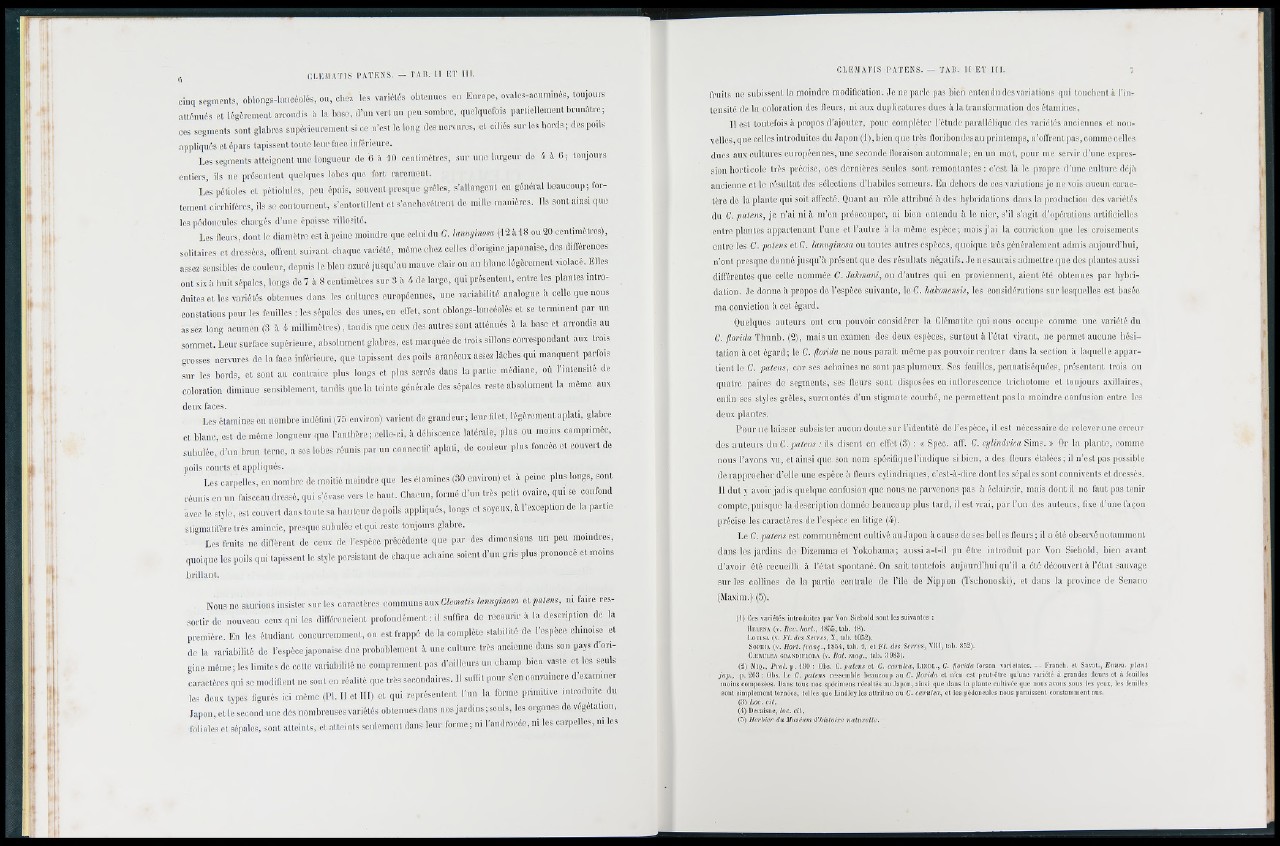
cinq scgraonls, olilongR-hnicéolés, ou , chez les vnriélés oblcnues en Europe, ovalcs-ac iiininé s, lonjours
alténuc's et légcremcnUiTOntlis il bi liase , d’u iir e iT u ii peu sombre, ipiolqucfois parlielleraeiU bnm.Tlre;
ces segments ¡ont glabres supérieurement si ce n'est le long des nervures, et ciliés sur les bords ; des poils
appliqués et épars tapissent toute leur face inrérieurc.
I,cs segments allcignenl une longueur de, C à -10 centimètres, sur une largeur do 4 il C; loiijoiirs
cniicrs, ils no préscutcnt quelques lobes que fort rarement.
Les pétioles c l p é lio liilc s, peu ép a is, souvent presque grêles, s’a llongcnl ou goncral beaucoup-, fortement
cirrbifères, ils se contouraeiit, s’enlortillen l et s ’enchevêtrent de mille manières. Ils sont ainsi que
les pédoncules chargés d’une épaisse villosité .
Les Ileurs, doiU le diamètre est à peine moindre q n e c ch ü d n C. lamiiiinosa ( l^ i i lS on 20 centimètres),
solitaires c l dressées, offrent suivanl chaque variété, même cbcz c e lle s d’origine japonaise , des diffm-enccs
assez sensibles de couleur, depuis le bleu azuré ju squ ’au mauve, clair ou au b lan c légèrement violacé. Elles
ont six il lia it sépales, longs de 7 il 8 cenlimètres sur 3 à 4 de large, qui présentent, entre les plantes introduites
e l les variétés obtenues dans les cu llur es européennes, une variabilité analogue è ce lle que nous
constations pour les feuilles : les sépales des unes, en ofrct, sont oblongs-laucéolés c l se lcrminent par un
,TS sez long aciimeii (3 ii -4 m illin iè ir e s ), tandis que ceux des autres sont atténués à la base c l arrondis au
sommet. Leur surface supérieure, absolument glabres, est marquée de trois sillons correspondant aux trois
grosses nervures de la face inférieure, que tapissent des poils aranéeux assez biches qui manquent parfois
sur les liords, c l sont au contraire plus longs et plus serrés dans la partie médiane, où l ’mlen silo do
coloration diminue sensiblement, tandis que la teinte générale des sép.ales reste absolument la même aux
deux faces.
Les étamines en nombre indéfini (75 environ) varient de grandeur; lenr filet, légè remen t aplati, glabre
c l blanc, est de même longueur (,ue l'aïUhcre; ce lle -c i. ii d éhiscence latérale, plus ou moins comprimée,
.subidée, d’un brun terne, a scs lobes réunis par un co n n e c lif aplati, de couleur plus foncee et couvert de
poils courts et appliques.
Les carpelles, en nombre de moitié moimlrc que les élamines (30 environ) e l il peine plus longs, sont
réunis en un faisceau dressé, qui s’évase vers le haut. Chacun, formé d’nn très petit ovaire, qui se confond
avec le style, est couvert dans toute sa b a illeu r de poils appliqués, longs et soyeux, il l ’exception de la partie
sligmalifêre très amincie, presque subiilée et qui reste toujours glabre.
° Les fruits ne diffèrent de ceux de l ’espèce précédente que par des dimensions un peu moindres,
quoiipie les poils qui tapissent le style persistant de chaque achaine soient d’un gris plus prononcé et moins
brillant.
Nous no saurions insister sur les caraetè rc s communs aux r j-om lis lanuginosa et p a ïe n s , m faire ressortir
de nouveau ceux qui les différencient profondément : il suffira de recourir ii la description de la
première. En les éliidiaiit conciirrcmmenl, on est frappé de la complète staluhlé de l’c sp ec e chinoise et
de la variabilité de l’espèce japonaise due probal.lement il une c i.lt,irc très ancienne dans son pays d’origine
même; les limites de c e tte variabilité ne comprennenl pas d’a illeurs un champ bien vaste c l les seuls
earaclères qui se modifient ne sont ou réalité que très seeoudaii'es. Il suffit pour s’cn convamerc d ’examiner
les deux tvpes figurés ici même (l'I. Il e l III) e l ipii représentent l ’un la forme primitive inlrod.iile du
,lapon, et ffi second une des nombreuses variétés obtenues dans nos jardins ; seu ls, les oi-ganes de végétation,
folioles et sépales, sont atteints, et a lle iiils seiilenienl dans leur forme; ni 1 aiidrocce, m les (-„aipelles, m les
C L E M A T I S l 'A T E N S . ~ T A U . I l E T I I I . 7
fruits ne snbisscnl la moindre modification. Je ne parle pas bien entendu desvarialioiiR qui tonclienl à l’ii)-
ic iisité de la coloration des fleurs, ni aux duplicatnres dues à la transformation des élamines,
Il est toutefois à propos d’ajouter, pour compléter l ’étude paralléliquc des variétés ancioniios et non-
Yclles, que celles introduites du Japon ( i) ,b i e i i que très lloril)Oiidesau printemps, ii’o lfrentpas, comme celles
dues aux cultures européennes, iinc siîcon d c lloraison automnale; en un mot, pour me servir d ’une expression
h o rtico le très précise, ces dernières seu les son l remontantes : c ’est là le propre d ’une cnltnrc déjà
ancienne et le résultat des sélections d’habiles semeurs. En dehors do ces variations je ne vois auciiu caractère
de la plante qui soit aiïecté. Quant au rôle attribué à des liybridalions dans la jiroductioii des variétés
du C. p a ïe n s , je n’ai ni à m ’cn préoccuper, ni bien ('nlendu à le nier, s’il s’agit d’ojiératioiis artificielles
entre plantes apparlenanl l’uiie c l l’autre à la môme e sp è c e ; mais j ’ai la conviction que les croisements
entre les C. p a ïen s e l C. lanuginosa ou toutes autres espèces, quoique très généralenienl admis aujourd’liiii,
n’ont presque donné ju squ ’à présent que des résultats négatifs. Je ne saurais admettre que des plantes aussi
différentes que ce lle nommée C . Jalcmani, ou d’autres qui en proviennent, a ien t été obtenues par hybridation.
Je donne à propos de l’espèce suivante, le C. hahonensis, les considérations sur lesquelles est basée
ma conviction à cet égard.
Quelques auteurs ont cru pouvoir considérer la Clématite qui nous occupe comme une variété du
C. ß o r id a Tliunb. (2 ), mais un examen des deux espèces, surtout à l ’étal vivant, ne permet aucune hésitation
il ce t égard; le C. ßorida ne nous paraît môme pas pouvoir rentrer dans la section à laquelle appartient
le C. p a ïe n s , car scs achaines ne sonl pas plumeux. Scs feuilles, peniialiséquées, présentent trois on
quatre paires de segments, ses fleurs son l disposées en indoresconce Iriehotome c l lonjours axillaircs,
enfin ses styles grêles, surmontés d'un stigmate courbé, ne permeLLcnt pas la moindre confusion entre les
deux plantes.
r o iir ne laisser subsister aucun doute sur l ’identité de l’esp éc c, il est nécessaire de relever une erreur
des au teu r s du C. p a ïe n s : ils disent en elTet (3) : « Spec. aff. C. c y lin d rica Siins. » Or la plante, comme
nous l ’avons vu, e l ainsi que son nom spécifique l’inil¡que si bien, a des Ileurs étalées; il n ’est pas possilile
derap p ro cb cr d ’e lle une espèce à ileurs cylindriques, c ’est-à-dire dont les sépales so iitcom iiv eiils et dressés.
11 dut y avoir jadis quelque confusion que nous ne parvenons pas à éclaircir, mais dont il ne faut pas tenir
compte, piiis([nc la description donnée beaucoup plus lard, il est vrai, pai- riin des auteurs, fixe d ’une façon
précise les caractères de l'espèce en litige (4).
Le C .p a to is est communément cultivé au Japon à cause de ses belles fleurs; il a été observé notamment
dans les jardins de Dizcmma et Yokohama; aussi a -t-il pu ôlre inlroduit par Von Siebold, bien avant
d ’avoir été re cueilli à l ’éta l spontané. On sait louLclois aujourd’luii qu’il a été découvert à l’état .sauvage
sur les colline s de la partie centrale de l’île de Nippon (^ïsclionoski), et dans la province de Senano
(Maxim.) (5).
(1) Ces v a rié té s in tro d u ites p a r Von Siebold sont les suivanins ;
Helena (v. Rev. hort., 1855, tab. 18).
boüiSA (V. F l . des Serres, lal). 1052).
So p h ia (v, Hort. [ranç.., 1851, tab. 1, e t F l . des Serres, Y]!I, lab . 852).
C.i-nui.EA GHANDiFLORA (v. üol. mag., lab . 3983).
(2) Miû., Prol. p . 190 : Obs. C. patens c l C. ca’i-ulca, L in d i.., C- florida forsan varic ia tes. - - Francli. e l Sa v a l., Eîiwm. plant
jap., p . 263 : Ohs. l.c C. païens ressemble beaucoup au C. florida e l ii’en e s l p eu l-ô lre q u ’une v a riclé à g ran d e s Ileur.s e l à feuilles
moins composées. Dans tous n o s spécimens reco llé s au Japon, ainsi (jue dans ta p ia u le cullivce que nous avons so u s les yeux, les feuillus
sont s im p lem en l le rn é c s , Icllcs que Lindley le s a llrib u c au C. caaulea, e l le s pédoncules nous p a ra is se n t conslammenl nus.
(3) Loc. cit.
(•i) Deeaisne, loc. cil.
(5) Herbier du Muséum d'Insloire naturelle.