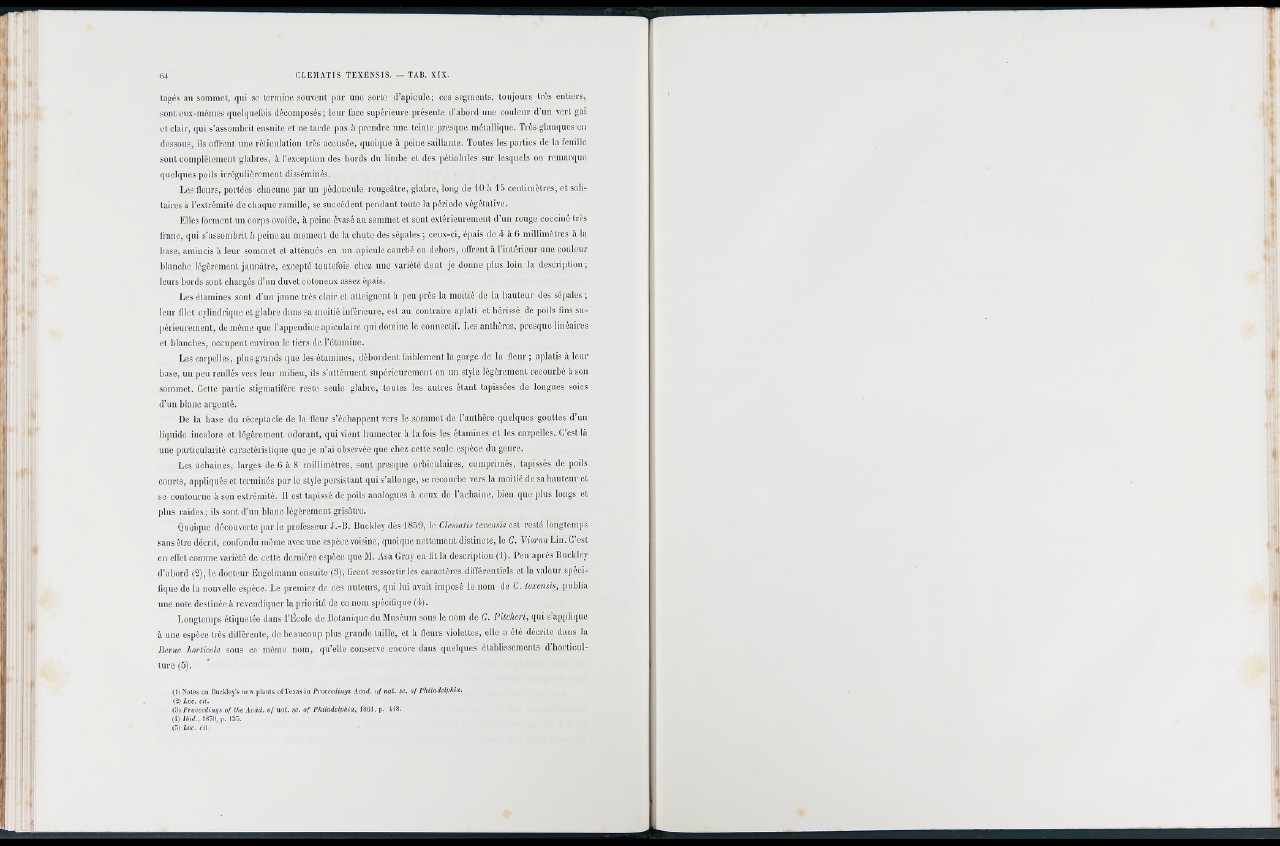
tagés au sommet, qui sc termine souvenl par une sorte d ’ap iculc ; ce s segments, loujours très enlicrs,
sont eiix-mcme s quelquefois décomposés; leur face supérieure présente d’abord une couleur d ’un vert gai
ot clair, qui s ’assombrit ensuite ct ne tarde pas à prendre une teinte presque métallique. Très glauques en
dessous, ils oiTrenl une ré ticulalion 1res a ccusé e, quoique à peine saillante. Toutes les parties de la feuille
son t complètement glabres, à l ’exception des bords du limbe c l des p élio lu les sur lesque ls on remarque
(ILiebiiies poils irrégulièrement disséminés.
Los fleurs, portées cliacune par un péd oncule rougeâtre, glabre, long de '10 à '15 centimètr es, c t solitaires
à l’extrémité de cliaque ramillc, sc su ccèdent pendant toute la période végétative.
Elles forment un corps ovoïde, à peine évasé au sommet e l sont cxlérieuremeiiL d ’un rouge coc citié très
franc, qui s ’assombrit à peine au monieiil de la chute des sépales ; c eux -ci, épais de 4 à G millimètres à la
base, amincis à leur somm et ct altén u és en un ap icule courbé eu dehors, oiTrenl à l ’intérieur une couleur
blaiiclio légcremenl jaunâtre, excepté toutefois chez une variété dont je donne plus loin la description;
leurs bords sont cliargés d’un duvet coloneux assez épais.
Les étamines sont d’un Jaune très clair e l atteignent à peu près la moitié de la hauteur des sépales ;
leur filet cylindrique et glabre dans sa moitié inférieure, est au contraire aplati e l hérissé de poils lins su -
])érieurcmcnt, de môme que l’appendice apiculaire qui domine le con n eclif. Les anthères, p resque linéaires
et b lanches, occupent environ le tiers de l’étamine.
Les carpelles, plus grands que les étamines, débordent faiblement la gorge de la fleur ; aplatis à leur
base, un peu renflés vers leur milieu, ils s’a tténuent supérieurement en un slyle légè rement recourbé à son
sommet. Celte partie stigmatifère reste seu le glabre, toutes les autres é tant tapissées de longues soies
d ’un blanc argenté.
Do la base du réceptacle de la fleur s’échappent vers le sommet de l ’anthère q uelques gouttes d’un
liquide incolore e t légè remen t odorant, qui vient humecter ù la fois les élamines et les carpelles. C’est là
une particularité caractéristique que je n’ai observée que chez c e lte seule e sp èc e du genre.
Los achaine s, larges de G à 8 millim ètr es, sont presque orbiculaires, comprimés, tapissés de poils
courts, a])pliqués et terminés par le style persistant qui s ’a llonge, se recourbe vers la moitié de sa hauteur et
se contourne à son extrémité. Il est tapissé de poils analogues à ceux de l ’achainc , bien que plu s longs et
plus raides ; ils son t d’un b lanc légè remen t grisâtre.
Quoique découverte par le professeur J .-B . Buckley dès '1859, le Clemalis tex en sis est resté longtemps
.sans être décrit, confondu même avec une espèce voisine, quoique n e llem en t distin cte, le C. Tfonirt Lin. C’est
en effet comme variété de c e tte dernière espèce que M. Asa Gray en fit la description {'!). P eu après Buekley
d’abord (2), le docteur Engelmann ensuite (3 ), firent ressortir les caractères d ifférentiels ct la valeur sp écifique
de la nouvelle espèce. Lc premier de ce s auteurs, qui lui avait imposé le nom de C. te x en sis, publia
une note desLince à revendiquer la priorité de ce nom spécifique (4 ).
Longtemps éLi([uetéc dans l’École de Botanique du Muséum sous le nom de C. PUch eri, qui s ’applique
à une espèce très différente, de b eaucoup plus grande taille, et à Ileurs violettes, elle a été décrite dans la
Revue horticole sous ce même nom, qu’e lle conserve encor e dans que lq u es établissements d ’h o rü cu l-
turc (5).
(1) Notes on Bucktey’s new plaiils of Texas in Pro c ccd tn ys A c a d , o f n a t. sc. o f P h ila d e lp h ia .
(2) Loc. cU.
(Z) P ro c e e d in g s o f Ihe A c a d , o f n a t. sc . o f P h ila d e lp h ia , 1861, p- i i8.
( i ) 1870, p. 135.
(o) Loc. c it.