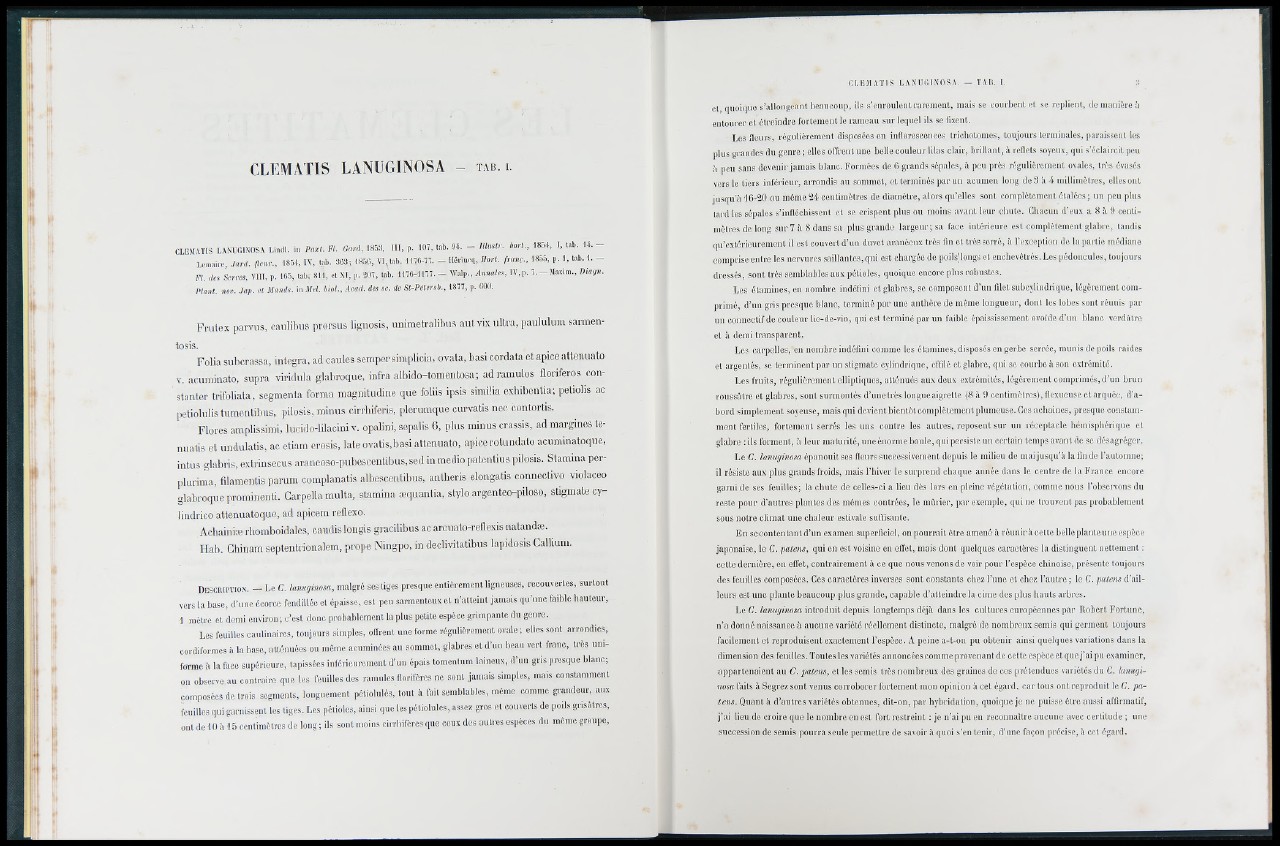
CLEMATIS LANUGINOSA - t a g . i.
CLIÍ.M,\TIS LANUGINOSA L i iu ü . ¡n / t o i . F i Gtml, 1 8 5 3 , I I I , p . 1 0 7 , la b . IH. - lllm tr . I,ori., 185-1, I , la b . L i. -
I .a „ .a i.T , Jar,l. fleur., 1 8 5 1 , IV , la b . 3 0 3 ; 1 8 5 0 , VI, la b . 1 1 -0 -7 7 . - I lé r im a ,, llort. frane., 1 8 5 5 , 1 , la b . I . -
FI. lier Serres, V i l i , p . 105, la b . 8 1 1 , c l X I , p . -207, la b . 1 1 7 0 -1 1 7 7 . - AValp., A«»a/fs, IV , p . 7. - M a s lm . , / l i i l j » .
l ’iaiil. m e . J u f. el MamU. la .Ifrl. i / o L , , l c « i i . * s sr. * St-Pétersl>., 1 8 7 7 , p . 0 0 0 .
F n itc x p a rv u s, caulitnis p ro rsu s lignosis, iin ime tralilm s au t v is iillra , p au lu lum san n en -
tosis.
F o l ia s u b c r a s s a , in te g r a , a d c a n le s s em p e r Simp lic ia , o v a ta , b a s i c o rd a l a e t a p ic e a tt e n u a to
V . a c um in a to , s u p r a v i r id u la g la b ro q u e , in fr a a lb id o - tom e n to s a ; a d r a m u lo s flo rífe ro s con-
s t a n t e r tr ifo l i a t a , s e gm e n ta fo rm a m a g n i tu d in e q u e fo liis ip sis s im ib a e x b ib e n tia ; p e lio b s ac
p e lio b ilis tum e n t ih u s , p ilo s is , m in u s c irrh if e ris , p l e r u m q u e c u rv a tis neo, c o n to r tis .
F lo re s amplissimi, lu c id o -lilacin iv . opalini, sepalis 6, p lu s m in u s crassis, ad m a rg in es te-
n u a tis el u n d u la tis , ac eliam erosis, la te o v a tis,b a si a tten u a to , apice ro tu n d a to acum in a to q u e ,
in tu s g k ib ris .e x trin se cu sa ra n eo so -p u b e s c en tib u s, sed in m edio p a tcn tiu s pilosis. Stam in a peip
lu rim a , filamentis p a rum complanatis alb escen tib u s, an tb e ris elongatis conne ctivo violaceo
g la b ro q u e p romin en ti. Carpella mu lta, stam in a æ q u an tia , stylo a rg en teo -p ilo so , stigm ate cy-
lindrico a tten u a to q u e , ad apicem reflexo.
Acbainiie rhomboidales, candis longis g racilib u s ac arcuato-roflexis n a tan dæ .
I la b . Chinara sep ten trio n a lem , p ro p e Ning p o , in declivitalibus lapidosis Calbum.
D e s c r i p t io n . — L c C. lanuginosa, malgré sos liges presque en lié r em en l ligneuses, recouvertes, surtout
vers la base, d’une écorce fendillée et épaisse, est peu sarinenleux et n’atteint jamais qu’une faible hauteur,
1 mùlre et demi environ ; c’esl donc probablement la plus petite espèc e grimpante du genre.
Les feuilles canlinaires, toujours simp le s, offrent une forme régulièrement o v a le; elles sont arrondies,
cordiformes à la base, atténuées ou m im e aciirainéos au somm et, glabi'cs et d’nn beau vert franc, 1res nm-
forine à la face supérieure, tapissées inlérieuremenl d’un épais loracnium laineux, d ’nn gris presque libine;
on observe au contraire que les feuilles des ramilles norifércs ne so n l jamais simp le s, mais coiistaranionl
composées de trois segments, longuement pétioUilés, tout à fait semblables, même comme grandeur, aux
reuiUcs qui garnissent les tiges. Les pétioles, ainsi que le sp é tio lu le s, assez gros et couverts de poils g r isitr c s,
ont de 10 il 1 5 cenliraélrcs de long ; ils sont moins cirrhifcrcs que ceux d es autres espcc es du racine gi'oupc.
(H, (luoiqiio ii’allon!icaiU beaucoup, ils s’enroulent rarement, mais se eourlicnt et se replient, de manière à
entourer et étreindre i'ortement le rameau sur lequel ils se fixent.
Les fleurs, réj^nilièrcmenl disposées en inflorescences Iricholomcs, toujours terminales, paraissent les
plus grandes du genre ; e lle s offrent une belle couleur lila s clair, brillant, à reflets soyeux, qui s’éclaircit peu
il peu sans devenir jamais blanc. Formées de 6 grands sépales, à peu près régulièrement ovales, très évasés
vers le tiers inférieur, arrondis au sommet, c l terminés par un acumcn long d c 3 ii 4 millimètres, elles ont
jusqu’à 1 0 -2 0 ou môme 2 4 centimètres de diamètre, alors qu’elles sont coinplètemcnl étalées ; uti peu plus
tard les sépales s’infléchissciU et se crispent pins ou moins avant leur c liu le . Chacun d’eux a 8 à 9 cenli-
môlres de long s u r ? à 8 dans sa plus grande largeur; sa face intérieure est complètement glabre, tandis
qu’extérieurement il est couvert d ’un duvet araiiécux très fin et très serré, à l’exceplioii de la partie médiane
comprise entre les nervures sa illan te s, qui est chargée de poilsdongs et enchevêtrés. Les ])édoncules, toujours
dressés, son l très seml)lab!es aux pétioles, quoique encore plus robustes.
Les étamine s, en nombre indéfini et glabres, se composent d’un filet subcylindriquc, légèrement corn-
primé, d’un gris presque blanc, terminé par une anthère de même longueur, dont les lobes sont réunis par
un con n cclif de couleur lie-d e-vin , qui est terminé p a rm i faible épaississement ovoïde d’nn b lanc verdâtre
c l à demi transparent.
Les carpe lle s, en nombre indéfini comme les étamines, di.sposés en gerbe serrée, munis de poils raides
c l argentés, se terminent par un stigmate cylindrique, effilé e l glabre, qui se courbe à son extrémité.
Les fruits, régulièrement clliplifp ies, atténués aux deux extrémités, légèrement comprimes, d’un brun
roussàtrc et glabres, son l surmontés d’une très longue aigrette (8 à 9 centimètres), flexucuse et arquée, d ’abord
simplement soyeuse, mais qui devient b ientôt complètement plumeuse. Ces achainc s, presque constamment
fertiles, fortement serrés les uns contre les autres, reposent sur un réceptacle hémisphérique et
glabre :ils forment, à leur maturité, une énorme boule, qui persiste iin certain temps avant de se désagréger.
L e C. lanuginosa épanouit ses llenrs successivement depuis le milieu de mai jusqu’à la fin de rauloinne;
il résiste aux plu s grands froids, mais l’hiver le surprend chaque année dans le centre de la France encore
garni de ses feuilles; la chute de ce lle s-c i a lieu dès lors en pleine végétation, comme nous l’observons du
reste pour d’autres p lante s des mêmes contrées, le mûrier, par exemple, (ini no trouvent pas ju-obablcmcnt
sous notre climat une chaleur estivale suffisante.
E n se contentant d’iin examen superficiel, on pourrait être amené à réunir à ce tte belle plante une espèce
japonaise, le C. p a ïen s , qui en est voisine en efTct, mais dont quelques caractères la d istinguent nettement :
c e tte dernière, en effet, contrairement à ce que nous venons de voir pour l’espèce ch inoise, présente toujours
des feuilles composées. Ces caractères inverses son t constants chez l’une et chez l’autre ; le C. p a ïen s d'ailleurs
est une plante beaucoup p lus grande, capable d ’atteindre la cime des plus hauts arbres.
Lc C. ÎÉïiWÿiMOM introduit depuis longtemps déjà dans les cultures européennes par Robert Fortune,
n’a donné naissance à aucune variété réellement distin cte, malgré de nombreux semis qui germent toujours
fac ilement c l reproduisent exactement l’espèce. A peine a-t-on pu obtenir ainsi quelques variations dans la
dimension des feuilles. Toutes les variétés annoncées comme provenant de cette espèce e l que j ’ai pu examiner,
appaiTenaienl au C. p a ïe n s , e l les semis très nombreux des graines de ce s prétendues variétés du C. la nw ji-
nosa faits à Segrez sont venus corroborer fortement mon opinion à cet égard, car tous ont reproduit le C. pa ïe
n s . Quant à d ’autres variétés obtenues, d it-on , ]iar hybridation, quoique je ne puisse être aussi affirmatif,
j ’ai lieu de croire que le nombre eu est fort restreint ; je n’ai {)U en reconnaître au cu ne avec certitude ; une
.succession de semis pourra soûle permettre de savoir à quoi s’cn tenir, d’une façon précise, à cet égard.