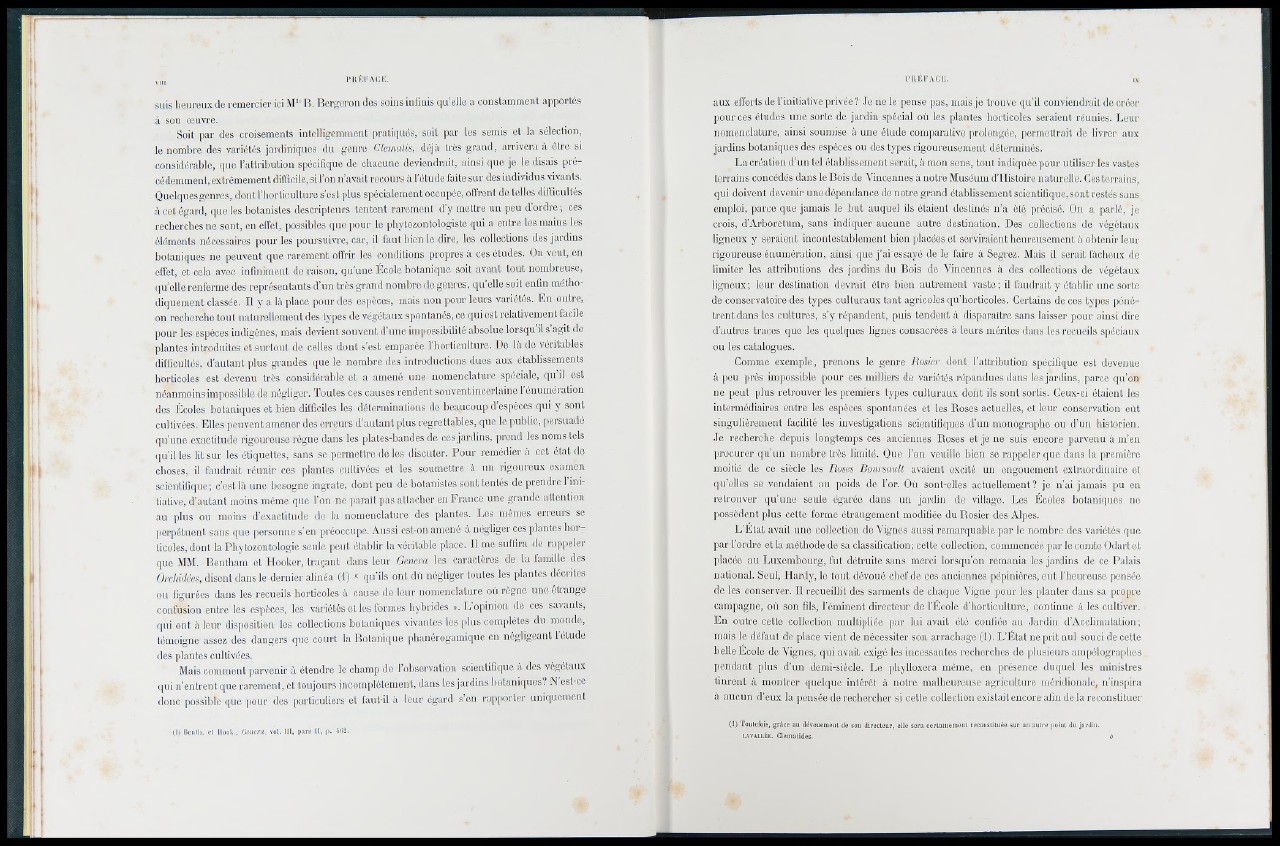
suis lieu rcu x do remercier ici M"" lî. Bergeroii des soins inliuis cm'clle a co n stam m en t apportés
à son oeuvre.
Soit p a r des croisements intelligemment pratiqués, soit p a r les semis et la sélection,
le n om b re des variétés ja rd in iq n e s d u g en re Clematis, déjà trè s g ra ïu l, a rriv era a être si
considérable, q u e l’a ttrib u tio n spécifique de ch a cu n e deviendrait, ainsi q u e je le disais précédemment,
extrêmem en t difficile, si l’on n ’avait reco u rs à l’é lu d e faite su r des individus vivants.
Quelques gen res, d o n t l’h o rticu ltu re s’est |ilus sp écialement occupée, offrent de telles difficultés
à cet éga rd, q u e les b otanistes d escripteurs te n ten t ra rem e n t d ’y m e ttre u n peu d’o rd re ; ces
reche rches n e so n t, en effet, possibles q u o iio iir le pbytozontologiste q u i a en tre les ma ins les
éléments nécessaires p o u r les pou rsu iv re, car, il fau t bien le dire, les collections des ja rd in s
b o tan iq u e s n e p eu v en t q u e ra rem e n t offrir les conditions p ro p res à ces études. Ou veut, en
effet, et cela avec infiniment de raison, q u ’u n e É co le b o ta n iq u e soit av an t to u t n omb reu se ,
q u 'elle ren ferm e des rep ré s en tan ts d’u n trè s g ra n d n om b re de gen res, q u ’elle soit enfin métho-
dicpiement classée. Il y a là place p o u r des espèces, mais n o n p o u r le u rs variétés. E n o u tre ,
on reclierebe to u t n a tu re llem en t des types de vég é tau x sp o n tan é s, ce c[ui est rela tiv em en t facile
p o u r les espèces indigènes, mais devient so u v en t d ’un e impossibilité ab so lu e lo rsq u il s ag it de
p lan te s in tro d u ite s et su rto u t de celles d o n t s'e st em p a ré e l'h o rticu ltu re . De là de v éritables
difficultés, d’a u ta n t p lu s g ran d e s q u e le n om b re des in tro d u c tio n s d ues au x établissements
horticoles est dev en u 1res co n sid é rab le et a am en é u n e n om e n c la tu re spéciale, c[u il est
néanmo in s impossible de négliger. To u tes ces causes re n d e n t so u v en t in c ertain e l’én um é ra tio n
des Ecoles b o tan iq u es et bien difficiles les détermin atio n s de b e au co u p d espèces q u i y so n t
cultivées. Elles p eu v en t am en e r des e rreu rs d ’a u ta n t plu s reg re ttab le s , q u e le public, p ersu ad é
f|ii’u n e exactitude rig o u re u se règ n e d ans les pla tes-b an d es de ces ja rd in s , p ren d les n om s tels
iju ’il les lit s u r les étiq u eltes, san s se p e rm e ttre de les d iscuter. P o u r rem éd ier à ce t é ta t de
choses, il fau d ra it ré u n ir ces p lantes cultivées et les so um e ttre à u ii rig o u re u x examen
scientifique; c’est là u n e b esogne in g ra te , d o n t peu de b o tan iste s so n t tentés de p ren d re 1 initiative,
d 'a u ta n t moins même q u e l’on n e p a ra ît pas a tta ch e r en F ra n c e u n e g ra n d e a tten tio n
au p lu s ou mo ins d’ex a c titu d e de la n om e n c la tu re des plantes. Les mêmes e rreu rs se
|ie rp é lu e n t sans q u e p e rso n n e s’en préoccii[ie. A u ssi est-on am en é à n égliger ces p lan tes h o rticoles,
dont la P h ylozontologie seule p eu t étab lir la v éritab le place. Il me suffira de rapiieler
q u e JIM. B en th am et Hooker, tra ç a n t dans le u r Généra les ca ra ctè res de la famille des
Orchidées, d isen t dan s le d e rn ie r alin éa (I) « q u ’ils o n t dû n ég lig er toutes les p lan te s décrites
ou figurées dan s les recue ils horticoles à c au se de le u r n om e n c la tu re oii règ n e u n e é tran g e
confusion en tre les espèces, les v a r i é t é s et les formes h y bride s ï. L ’opinion do ces savants,
(pii o n t à le u r disposition les colleclions b o tan iiiu e s vivantes les p lu s coni[ilèles d u monde ,
témoigne assez des d an g e rs q u e c o u rt la B o ta n iq u e p b an é ro g am iq u e en n ég lig e an t 1 etude
lies p lantes cultivées.
Mais comment p a rv en ir à é ten d re le champ de l’o bservation scienlifique à des vég é tau x
i|iii n ’en tre n t q u e ra rem en t, et to u jo u rs in com p lè tem en t, d an s les ja rd in s b o ta n iq u e s? N est-ce
d onc ]iossible q u e p o u r des p articu liers e t faut-il à le u r ég a rd s’en rap p o rlc r u n iq u em en t
0 ) üeiilli. 01 llo o k ., Généra, vol. 111, p a rs II, ¡i. 4(>'2.
au x efforts de l’initiative privée ? J e ne le pense pas, mais je tro u v e q u ’il eonviendrait de créer
p o u r ces étu d es u n e sorte de ja rd in spécial ofi les p lan tes horticoles s eraien t réunies. L e u r
n omen clatu re, ainsi soumise à u n e é tu d e comparative prolongée, p e rm e tlra it de livrer aux
ja rd in s b o tan iq u e s des espèces ou des types rig o u re u sem en t déterminés.
L a création d 'u n tel établissement serait, à mon sens, to u t in d iq u ée p o u r utiliser les vastes
te rra in s concédés d ans le Bois de Vincennes à n o tre J lu s é um d’I listoire na tu re lle . Ces te n a in s ,
q u i doivent devenir u n e dépendance de n o tre g ra n d établissement scientifique, so n t restés sans
emploi, parce q u e jam a is le b u t au q u e l ils éta ien t destinés ii’a été précisé. On a parlé, je
crois, d ’A rb o re tum , sans in d iq u e r a u c u n e a u tre d e stination. Des collections de végétaux
lig n eu x y se ra ien t in co n te stab lem en t b ien placées e t serv iraien t h eu reu s em en t à o b ten ir leur
rig o u re u se én um é ra tio n , ainsi q u e j ’ai essayé de le faire à Segrez. Mais il serait fâcheux de
limiter les a ttrib u tio n s des ja rd in s d u Bois de Vincennes à des collections de végétaux
lig n eu x ; le u r destin atio n devrait ê tre b ien au trem en t v a s te ; il faudiaiit y étab lir u n e sorte
de co n serv ato ire des types c u ltu rau x tan t agricoles q u ’horticoles. C ertains de ces types p én ètre
n t d ans les cu llu re s, s ’y rép an d e n t, pu is te n d en t à disp ara ître san s la isse r p o u r ainsi dire
d’au tres tra ces q u e les q u elq u es lignes consacrées à leu rs mé rite s dan s les recueils spéciaux
o u les catalogues.
Comme ex emp le, p ren o n s le g en re Rosie)' d o n t r a tlrib u lio n spécillque est devenue
à peu près impossible p o u r ces milliers de variétés rép an d u e s dan s les ja rd in s , parce q u ’on
n e p eu t plus re tro u v e r les p remiers types c u ltu rau x d o n t ils so n l sortis. Ceux-ci é taien t les
in terméd iaire s en tre les espèces spontané es et les Roses ac tuelles, e t le u r conservation e û t
sin g u liè rem en t facilité les investigations scientifiques d’uii mo n o g rap b e ou d 'u n historien.
J e rech e rch e depuis longtemps ces anc iennes Roses et je n e suis encore p a rv en u à m ’en
p ro cu re r q u ’u n n om b re très limité. Que l’on veuille bien se rap p e le r q u e dan s la première
moitié de ce siècle les Roses Boursault ava ient excité u n en g o u em en t ex trao rd in aire et
q u ’elles se v en d a ien t au poids de fo r. Oi'i sont-elles a c tu e llem e n t? je n ’ai jamais [lu en
re tro u v e r q u ’u n e seule égarée dan s u n ja rd in de village. Les Écoles b o tan iq u e s ne
p o ssèd en t p lu s cette forme é tran g em e n t modifiée du Ro sier des Alpes.
L ’É ta t ava it u n e collection de J'ig n e s aussi rem a rq u ab le p a r le n om b re des variétés i|u e
p a r l’o rd re et la m é th o d e de sa classification; cette collection, commencée p a r le comte Odart et
placée au Lu x em b o u rg , fu t d étru ite san s merci lo rsq u ’on rem an ia les ja rd in s de ce Pala is
n a t io n a l Seul, H a rd y , le to u t dévoué chef de ces anc iennes pépinières, eu t l’h eu reu se pensée
de les conserver. Il recueillit des sa rm e n ts de chaque Vigne iio u r les p la n te r dans sa propre
c ampagne, où son fils, l’ém in en t d ire c leu r de l’Ecole d’h o rticu ltu re , co n tin u e à les cultiver.
E u o u tre ce lle collection multipliée |ia r lui ava it été confiée au J a rd in d’Acclimatation ;
mais le d é fau t de place vien t de n éc essiter son a rra ch ag e (1). L ’E ta t ne p rit n u l souci de celte
belle École de Vignes, q u i avait exigé les in c essan tes re ch e rch es de |)lusieurs ampélo g rap b e s
p e n d a n t p lu s d ’u n demi-siècle. L e phylloxéra même, en présence duipiel les ministres
tin re n t à m o n tre r q u el(|u e in té rê t à n o tre ma lh eu reu se ag ricu ltu re méridionale, n ’inspira
à a u c u n d ’eux la pensée de re ch e rch e r si ce lle collection existait encore afin de la re co n stitu e r
(1) Toutefois, grâc e au dévouemeiil de son d ire c te u r, e lle se ra ceiTainenieiU reco iislitu ée s
LAVALLÉE. Clcmalides.
n au tre p oint d u Jardin.
»
ill i