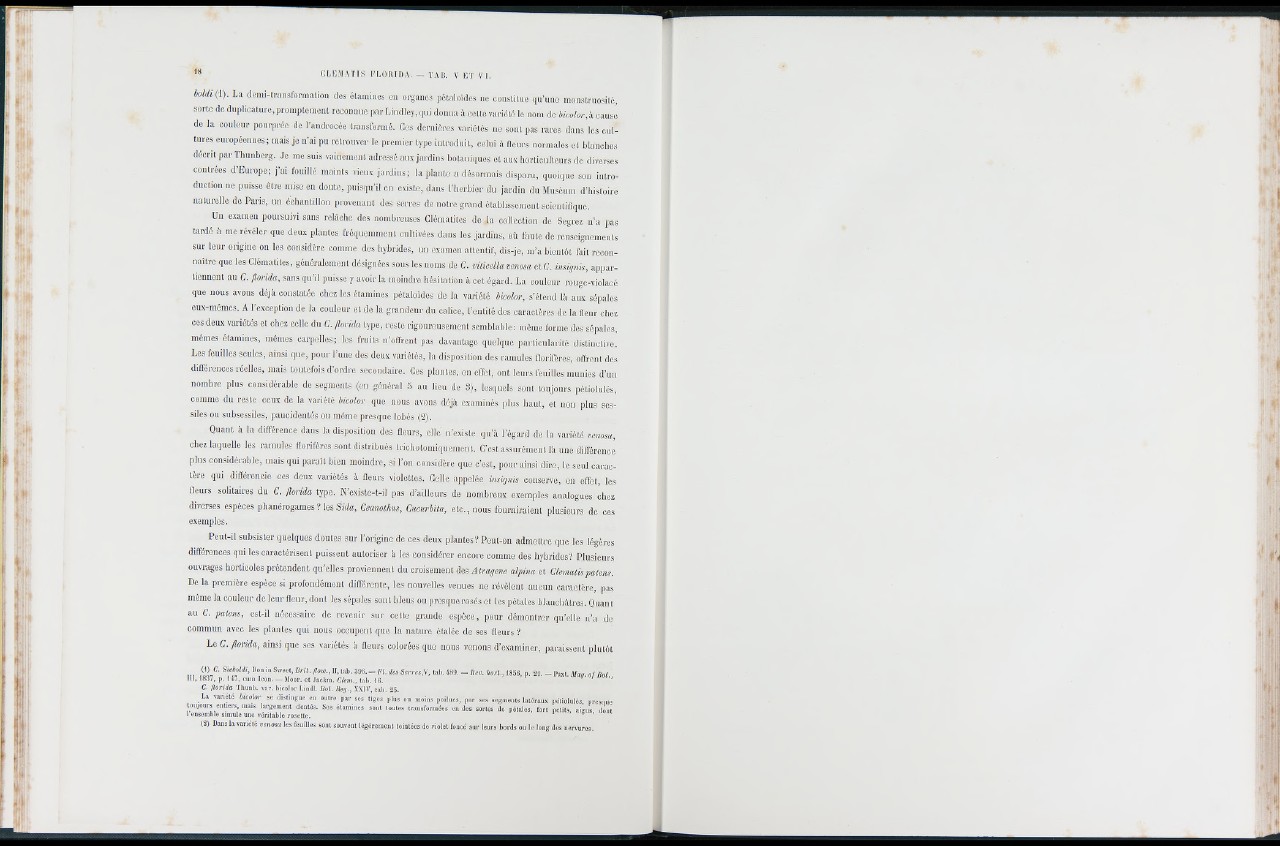
b o ld i{ \) . La dcmi-lransformaüon des élamines en organes iiclaloMes ne eon sliu .e qn’une monslrnosilé,
ser lo de duphcaUirc, promptement reeonmie par Lindley, qui doiiua à cette variété le nom de bicolor, il cause
de la couleur pourprée de l'androcée transformé. Ces dernières variétés ne sont pas rares d a iis ’les cu llures
européennes ; mais je n’ai pu retrouver ie premier type introduit, celui à Ileurs normales et blanches
décrit par Thunberg. Je me suis vainement adressé aux jardins botaniques ct aux horticulteurs de diverses
contrées d ’Europe; j ’ai fou illé maints vieux jardins; la plante a désormais disparu, ,,unique sou introduction
ne puisse être mise en doute, puisqu’il eu existe, dans rhcrbior du jardin du Jluséum d ’histoire
n aturelle de Paris, uii échaiitilloii iirovenaiit des serres de notre grand établissement scicutilique.
ü n examen poursuivi sans relâche des nombreuses Clématites de la co llec tion de Segrez n ’a pas
tardé ¡L me révéler que deux plantes fréquemment cultivées dans les jardins, où faute de renseignements
sur leur origine on ies considere comme des liybrides, un examen attentif, dis-je, m'a bientôt fait reconnaître
que les Clématites, généralement désignées sous les noms de C. m /ic e lla venosa e l C. in sig n is , appartiennent
au C. ß o rid a , sans qu’il puisse y avoir la moindre hésitation à ce t égard. La couleur rouge-violaeé
que nous avons déjà constatée chez les élamines pétaloïde s de la variété bicolor, s ’étend là aux sépales
eux-mêmes. A l ’exception de la couleur et de la grandeur du ca lice , rentitc des caractères de la lleur chez
ce s deux variétés et chez c e lle du C. ß o r id n type, reste rigoureusement semblable : même forme des sépales,
mêmes étatnines, mêmes earpc lle s; les fruits u ’offrcut pas davantage quelque particularité d istin ctive’
Les feuilles seu les, ainsi q ue , pour l’une des deux variétés, la disposition des ramulcs llorifères. offrent des
différences réelles, mais toutefois d'ordre secondaire. Ces plantes, en effet, ont leurs feuilles munies d’uii
nombre plus considérable de segments (en général 5 au heu de 3 ), lesque ls sont toujours pétiolulé s,
comme du reste ceux de la variété b k o to r que nous avons déjà examinés iiliis liaut, et non plus ses^
siles ou stihsessile s, paucidentés ou même presque lobés (2).
Quant à la différence dans la disposition des fleurs, elle n’existe qu ’à l ’égard de la variété roñosa,
chez laquelle les ramules llorilères sont distribués Iricliotoiuiqucment. C’est assurément là une différence
plus considérable, mais qui paraît bien moindre, si l’on considère que c ’est, pour ainsi dire, le seul caractère
qui différencie ces deux variétés à fleurs violettes. Celle appelée in s ig n is conserve, eu effet, les
Ileurs solitaires du C. ß o n d a type. N ’existe -t-il pas d ’ailleurs de nombreux exemple s an alogues chez
diverses esp èc es phanérogames ? les S id a , C eam tliu s, Cucurbita, e t c ., nous fourniraient plusieurs de ces
exemples.
P eu t-il subsister quelques doutes sur l ’origine do ce s deux plantes? Peut-on admettre que le s légères
différences qui les caractérisent puissent autoriser à les considérer encore comme des hybrides? Plusieur s
ouvrages horticoles prétendent qu’e lle s proviennent du croisement des A lra g e n e a lp in a et C lematis p a te n s .
De la première espèce si profondément différente, les nouvelles venues ne révèlent aucun caractère, pas
même la couleur de leur fleur, dont les sépales son t bleus ou presque rosés ct les pétales blanchâtres. Quant
au C. p a te n s , est-il nécessaire de revenir sur c e tte grande e sp è c e , pour démontrer qu'elle n’a de
commun avec les plantes qui nous oceiipent que la nature étalée de ses fleurs ?
Lc C. ß o rid a , ainsi que scs variétés à fleurs colorées que nous venons d’examiner, paraissent plutôt
II. I«l). S 9 6 . - F i . d,s Senas.Y, lab. 489. - Her. ho,-I., 1856, p . 21. - Paxl. ¡ Im . ot Hot
HI, 1 8 3 j, p. 117, cum Icon. — Moor, e t Ja ckm. Clem-, la b . 1 6 .
C. florida Tliunb. vnv. bicolor Lindl. Hot. iiuiiuu iiiu iiu .va:-,ijicoior i.iiiui.isot.lHiee<ijj..,, X. \ .\\I1VV,, ttaabb.. 2255..
La v a ríe te bicohr s c d is ln ifu n on o u tre p a r ses lig e s plus o u moins p o ilu e s, p a r se s segm en is la térau x p é tiolulés p resn u e
to u jo u rs en tiers, ma is la rg em e n t d en tés. Ses é tam in es so n t toutes tran s fo rm é es on des so rte s de p é ta le s, fo rt p e tits a iàu s dont
l’ensemble sim ule un e v é rilab le ro s e tte . . a ig u s, uoiu
(2) Dans la v a rié té u e n o sa les feuilles so n t souvent lé g è rem en t te in té es de violet foncé su r le u rs b o rds o u ïe long des n e rv u re s .
m