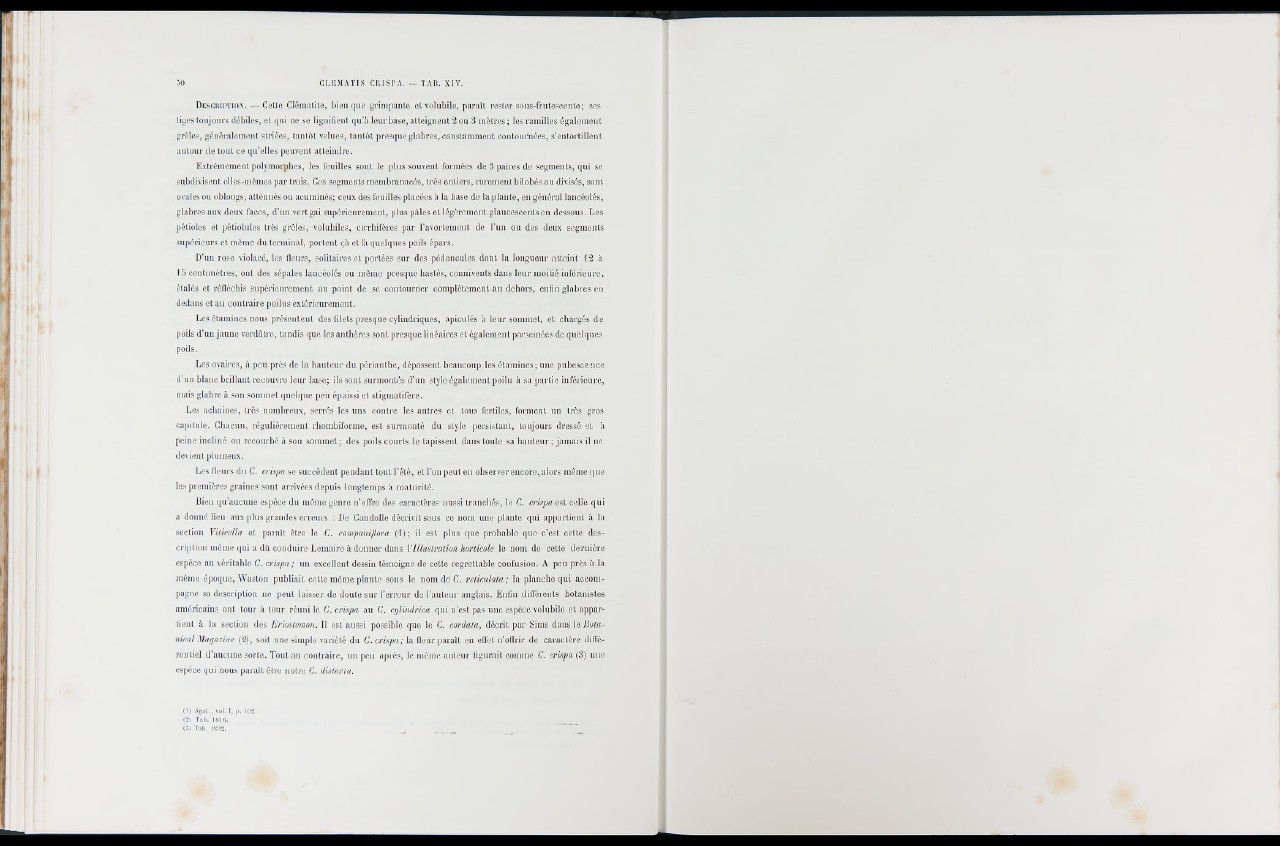
D e s c r ip t io n '. — Celle Clématite, bien que grimpante ct volubilc, paraît rester sous-frutescente; ses
tiges loujours débiles, et qui ne sc lignifient qu’à Icu rb a se,a tteign en t 2 ou 3 mè tre s; les ramilles cgalcmetU
grêles, généralement striées, tantôt velu es, tantôt presque glabres, constamment contournées, s’entortillent
autour de tout ce qu'elles peuvent atteindre.
ExLrC'mcment polymorphes, les feuilles son t le plus souvent formées de 3 paires de segments, qui se
subdivisent elles-mêmes par trois. Ces segments membranacés, très entiers, rarement b ilobés ou divisés, sont
ovales ou oblongs, atténués ou acuminés; ceux des feuilles plac ée s à la base de la plante, en général lancéolés,
glabres aux deux fac es, d'un vertgai supcrieurcmeiit, plus pâles et légèrement g lauc escenls en dessous. Les
pétioles ct pétiolulés très grêles, volubiles, cirrliifères par ravoiTcment de ru n ou des deux segments
supérieurs et même du terminal, portent çà et là q uelques poils épars.
D'nn rose violacé, les fleurs, solilaires et portées sur des pédoncules dont la longueur atteint 12 à
15 centimètres, ont des sépales lanc éo lés ou même presque haslés, connivents dans leur moitié inférieur e,
étalés ct réfléchis supérieurement au point de se contourner complètement au dehors, enfin glabres en
dedans et au contraire poilus extérieurement.
Les élamines nous p résentent des filets presque cylindriques, apiculés à leur sommet, ct chargés d e
poils d'un jau n e verdâtre, tandis que les anlhères sont presque linéaires et égalemen t parsemées de q uelques
poils.
Les ovaires, à peu près de la hauteur du périauthe, dépassent beaucoup les étamine s; une p u b e sc en c e
d’un blanc brillant recouvre leur base; ils sont surmontés d’un style également poilu à sa partie inférieur e,
mais glabre à son sommet i[uelque peu épaissi et stigmatifère.
Los achaines, très nombreux, serrés les uns contre les autres ct tons fertiles, forment nn très gros
capitule. Chacun, régulièrement rhombiforme, est surmonté du style persi.slanl, toujours dressé et à
peine inc lin é ou recourbé à son somm et; des poils courts le tapissent dans toute sa hauteu r; jamais il ne
devient plumeux.
Les fleurs dn C. crispa se su ccèdent pendant tout l ’é té , ct l’on peut en observer encore, alors même que
les premières gi-aines son t arrivées depuis longtemps à matur ité.
Bien ([u’aiicune espèce dn même genre ii’oiTi-e des caractères aussi tranchés, le C. crispa est c e lle ([ui
a donné lieu aux plus grandes erreurs : De Candolle décrivit sous ce nom une plante qui appartient à la
section V itic ella et paraît être le C. cam paniflora Çl); il est plus que probable que c’est c e lle description
même ([ui a dû conduire Lemaire à donner dans V Illu s tra tio n horticole le nom de cette dernière
espèce au véritable C. c r isp a ; un exc ellent dessin témoigne de cette regrettable confusion. A peu près à la
même époque, Waslon p ubliait c e lte môme plan te sous le nom de C. re ticu la ta ; la planche tiui accom-
jiagne .sa description ne peut laisser de doute sur l’erreur de l ’auteur anglais. Enfin dilfórents botanistes
américains on t tour à tour réuni le C. crispa au C. c y lin d rica qui n’est pas une espèce volubilc et appartient
à la section des Erio stemo n . Il est aussi possible que le C. cordata, décrit par Sims dans le B o ta -
n ica l Magazine (2), soit une simple variété dn C. c r isp a ; la lleur paraît en clfet n’ollVir de caractère dilfc-
rentiel d’aucune sorte. Tout au contraire, nn ¡)cu api'ès, le même auteur figurait comme C. crispa (3) une
espèce (¡ui nous parait être notre C. d isto r ta .
I l ) S a s l., vul. I. |i. Ki-2.
(21 Tail. 181(1.
ch Tall. 1.11)-’ .