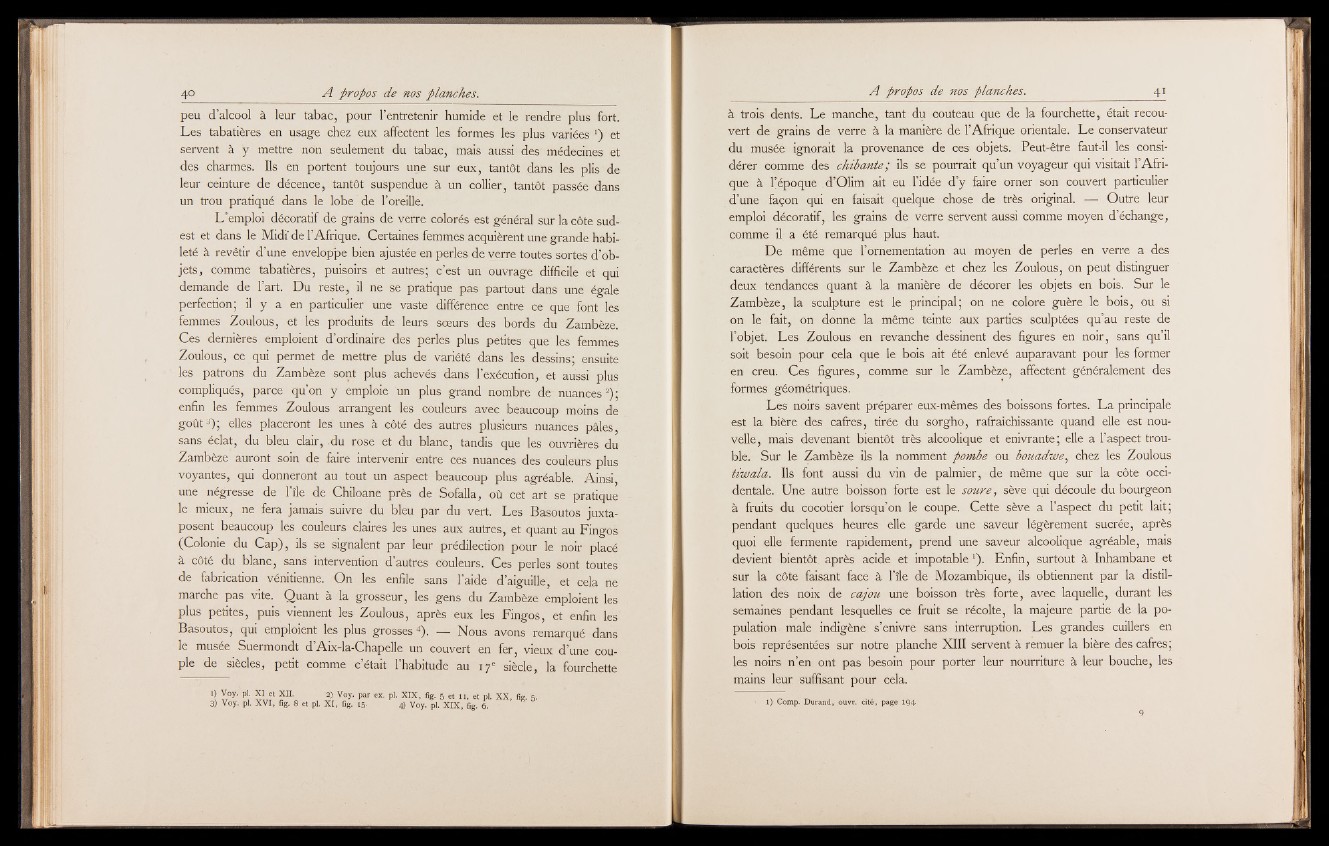
peu d’alcool à leur tabac, pour l’entretenir humide et le rendre plus fort.
Les tabatières en usage chez eux affectent les formes les plus variées *) et
servent à y mettre non seulement du tabac, mais aussi des médecines et
des charmes. Ils en portent toujours une sur eux, tantôt dans les plis de
leur ceinture de décence, tantôt suspendue à un collier, tantôt passée dans
un trou pratiqué dans le lobe de l’oreille.
L ’emploi décoratif de grains de verre colorés est général sur la côte sud-
est et dans le Midi' de l’Afrique. Certaines femmes acquièrent une grande habileté
à revêtir d’une enveloppe bien ajustée en perles de verre toutes sortes d’objets,
comme tabatières, puisoirs et autres; c’est un ouvrage difficile et qui
demande de l’art. Du reste, il ne se pratique pas partout dans une égale
perfection; il y a en particulier une vaste différence entre ce que font les
femmes Zoulous, et les produits de leurs soeurs des bords du Zambèze.
Ces dernières emploient d’ordinaire des perles plus petites que lès femmes
Zoulous, ce qui permet de mettre plus de variété dans les dessins; ensuite
les patrons du Zambèze sont plus achevés dans l’exécution, et aussi plus
compliqués, parce qu’on y emploie un plus grand nombre de nuances2) ;
enfin les femmes Zoulous arrangent les couleurs avec bèaucoup moins de
goût3); elles placeront les unes à côté des autres plusieurs nuances pâles
sans éclat, du bleu clair, .du rose et du blanc, tandis que les ouvrières du
Zambèze auront soin de faire intervenir entre ces nuances des couleurs plus
voyantes, qui donneront au tout un aspect beaucoup plus agréable. Ainsi
une négresse de l’île de Chiloane près de Sofalla, où cet art se pratique
le mieux, ne fera jamais suivre du bleu par du vert. Les Basoutos juxtaposent
beaucoup les couleurs claires les unes aux autres, et quant au Fingos
(Colonie du Cap), ils se signalent par leur prédilection pour le noir placé
à côté du blanc, sans intervention d’autres couleurs. Ces perles sont toutes
de fabrication vénitienne. On les enfile sans l’aide d’aiguille, et cela ne
marche pas vite. Quant à la grosseur, les gens du Zambèze emploient les
plus petites, puis viennent les Zoulous, après eux les Fingos, et enfin les
Basoutos, qui emploient les plus grosses *). H Nous avons remarqué dans
le musée Suermondt d Aix-la-Chapelle un couvert en fer, vieux d’une couple
de siècles, petit comme c’était l’habitude au 17 e siècle, la fourchette
1) V o y . pi. X I et XII,
3) Voy. pi. X V I , fig. 8
2) Voy. par ex. pi. X IX , fig. 5 et ISy et pi. X X , fig. 5.
et pi. X I , fig. 15. 4) Voy, pi. X IX , fig. 6.
à trois dents. L e manche, tant du couteau que de la fourchette, était recouvert
de grains de verre à la manière de l’Afrique orientale. L e conservateur
du musée ignorait la provenance de ces objets. Peut-être faut-il les considérer
comme des chibante; ils se pourrait qu’un voyageur qui visitait l’Afrique
à l’époque d’Olim ait eu l’idée d’y faire orner son couvert particulier
d’une façon qui en faisait quelque chose de très original. — Outre leur
emploi décoratif, les grains de verre servent aussi comme moyen d’échange,
comme il a été remarqué plus haut.
De même que l’ornementation au moyen de perles en verre a des
caractères différents sur le Zambèze et chez les Zoulous, on peut distinguer
deux tendances quant à la manière de décorer les objets en bois. Sur le
Zambèze, la sculpture est le principal; on ne colore guère le bois, ou si
on le fait, on donne la même teinte aux parties sculptées qu’au reste de
l’objet. Les Zoulous en revanche dessinent des figures en noir, sans qu’il
soit besoin pour cela que le bois ait été enlevé auparavant pour les former
en creu. Ces figures, comme sur le Zambèze, affectent généralement des
formes géométriques.
Les noirs savent préparer eux-mêmes des boissons fortes. L a principale
est la bière des cafres, tirée du sorgho, rafraîchissante quand elle est nouvelle,
mais devenant bientôt très alcoolique et enivrante; elle a l’aspect trouble.
Sur le Zambèze ils la nomment pombe ou bouadwe, chez les Zoulous
tiw ala. Ils font aussi du vin de palmier, de même que sur la côte occidentale.
Une autre boisson forte est le soure, sève qui découle du bourgeon
à fruits du cocotier lorsqu’on le coupe. Cette sève a l’aspect du petit lait;
pendant quelques heures elle garde une saveur légèrement sucrée, après
quoi elle fermente rapidement, prend une saveur alcoolique agréable, mais
devient bientôt après acide et impotable '). Enfin, surtout à Inhambane et
sur la côte faisant face à l’île de Mozambique, ils obtiennent par la distillation
des noix de cajou une boisson très forte, avec laquelle, durant les
semaines pendant lesquelles ce fruit se récolte, la majeure partie de la population
male indigène s’enivre sans interruption. Les grandes cuillers en
bois représentées sur notre planche XIII servent à remuer la bière des cafres;
les noirs n’en ont pas besoin pour porter leur nourriture à leur bouche, les
mains leur suffisant pour cela.
l) Comp. Durand, ouvr. cité, page 194.