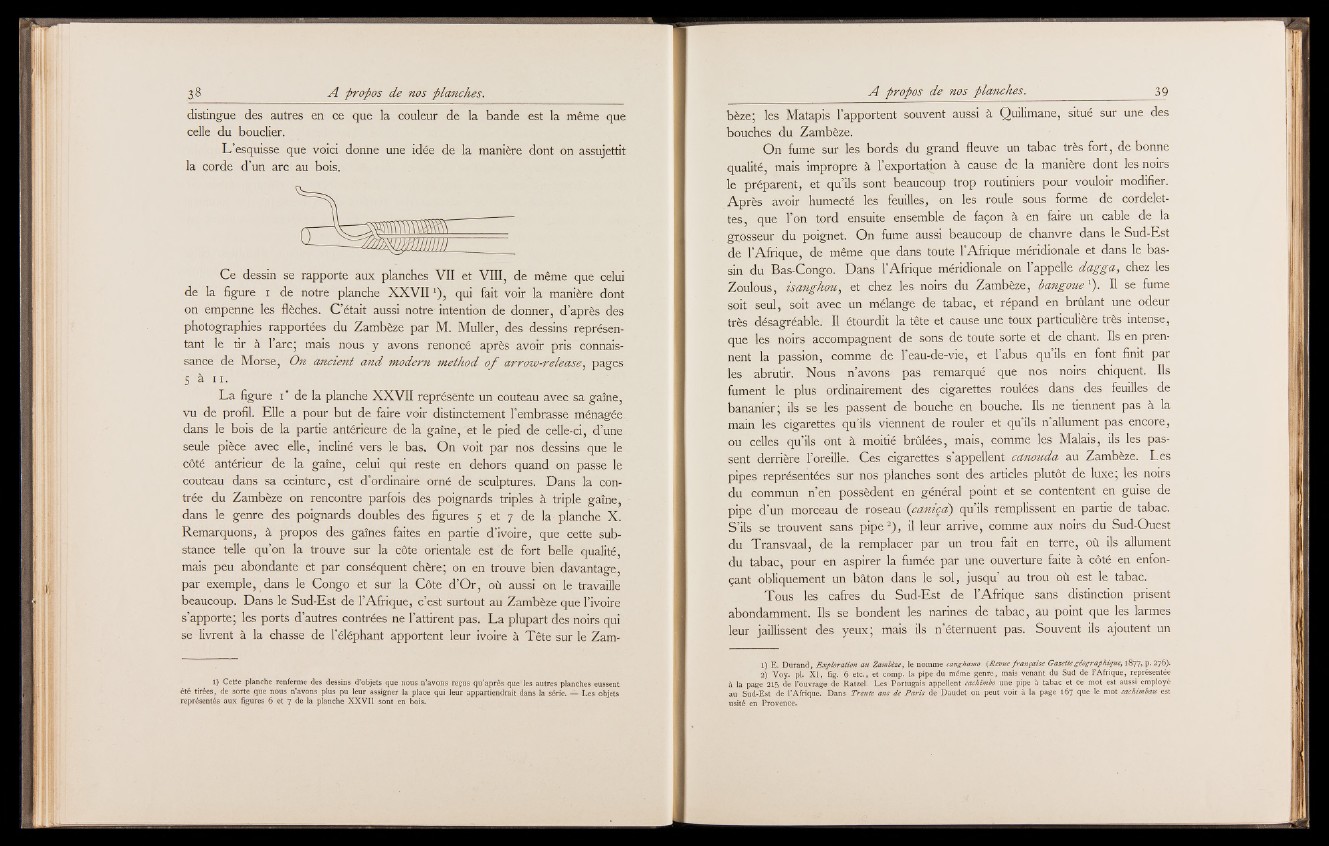
distingue des autres en ce que la couleur de la bande est la même que
celle du bouclier.
L ’esquisse que voici donne une idée de la manière dont on assujettit
la corde d’un arc au bois.
Ce dessin se rapporte aux planches VII et VIII, de même que celui
de la figure i de notre planche X X V I I 1) , qui fait voir la manière dont
on empenne les flèches. C ’était aussi notre intention de donner, d’après des
photographies rapportées du Zambèze par M. Muller, des dessins représentant
le tir à l’arc; mais nous y avons renoncé après avoir pris connaissance
de Morse, On ancient an d modem method o f arrow-retease, pages
S à n .
L a figure i* de la planche X X V II représente un couteau avec sa gaîne,
vu de profil. Elle a pour but de faire voir distinctement l’embrasse ménagée.
dans le bois de la partie antérieure de la gaîne, et le pied de celle-ci, d’une
seule pièce avec elle, incliné vers le bas. On voit par nos dessins que le
côté antérieur de la gaîne, celui qui reste en dehors quand on passe le
couteau dans sa ceinture, est d’ordinaire orné de sculptures. Dans la contrée
du Zambèze on rencontre parfois des poignards triples à triplé gaîne,
dans le genre des poignards doubles des figures 5 et 7 de la planche X .
Remarquons, à propos des gaînes faites en partie d’ivoire, que cette substance
telle qu’on la trouve sur la côte orientale est de fort belle qualité,
mais peu abondante et par conséquent chère; on en trouve bien davantage,
par exemple, dans le Congo et sur la Côte d’Or, où aussi on le travaille
beaucoup. Dans le Sud-Est de l’Afrique, c’est surtout au Zambèze que l’ivoire
s’apporte; les ports d’autres contrées ne l’attirent pas. L a plupart des noirs qui
se livrent à la chasse de l’éléphant apportent leur ivoire à Tête sur le Zaml)
Cette planche renferme des dessins d’objets que nous n’avons reçus qu'après quelles autres planches eussent
été tirées, de sorte que nous n’avons plus pu leur assigner la place qui leur appartiendrait dans la série. — Les objets
représentés aux figures 6 et 7 de la planche X X V I I sont en bois.
A propos de nos planches.
bèze; les Matapis l’apportent souvent aussi à Quilimane, situé sur une des
bouches du Zambèze.
On fume sur les bords du grand fleuve un tabac très fort, de bonne
qualité, mais impropre à l’exportation à cause de la manière dont les noirs
le préparent, et qu’ils sont beaucoup trop routiniers pour vouloir modifier.
Après avoir humecté les feuilles, on les roule sous forme de cordelettes,
que l’on tord ensuite ensemble de façon à en faire un cable de la
grosseur du poignet. On fume aussi beaucoup de chanvre dans le Sud-Est
de l’Afrique, de même que dans toute l’Afrique méridionale et dans le bassin
du Bas-Congo. Dans l’Afrique méridionale on l’appelle d a g g a , chez les
Zoulous, isanghou, et chez les noirs du Zambèze, bangoue'). Il se fume
soit seul, soit avec un mélange de tabac, et répand en brûlant une odeur
très désagréable. Il étourdit la tête et cause une toux particulière très intense,
que les noirs accompagnent de sons de toute sorte et de chant. Ils en prennent
la passion, comme de l’eau-de-vie, et 1 abus qu ils en font finit par
les abrutir. Nous n’avons- pas remarqué que nos noirs chiquent. Ils
fument le plus ordinairement des cigarettes roulées dans de s. feuilles- de
bananier; ils se les passent de bouche en bouche. Ils ne tiennent pas à la
main les cigarettes qu’ils viennent de rouler et qu’ils n’allument pas encore,
ou celles qu’ils ont à moitié brûlées, mais, comme les Malais, ils les passent
derrière l’oreille. Ces cigarettes s’appellent- canouda au Zambèze. Les
pipes représentées sur nos planches sont des articles plutôt de luxe; les noirs
du commun n’en possèdent en général point et se contentent en guise de
pipe d’un morceau de roseau (caniça) qu’ils remplissent en partie de tabac.
S ’ils se trouvent sans pipe 2) , il leur arrive, comme aux noirs du Sud-Ouest
du Transvaal, de la remplacer par un trou fait en terre, où ils allument
du tabac, pour en aspirer la fumée par une ouverture faite à côté en enfonçant
obliquement un bâton dans le sol, jusqu’ au trou où est le tabac.
Tous les cafres du Sud-Est de l’Afrique sans distinction prisent
abondamment. Us se bondent les narines de tabac, au point que les larmes
leur jaillissent des yeux; mais ils n’éternuent pas. Souvent ils ajoutent un
1) E . Durand, Exploration au Zambèze, le nomme canghamo {Revue française Gazette géographique, 1877, p. 276).
2) Voy. pl. X I , fig. 6 etc., et comp. la pipe du même genre, mais venant du Sud de l’Afrique, représentée
à la page 2 1 5 de- l’ouvrage de Ratzel. Les Portugais appellent cachimbo une pipe à tabac et ce mot est aussi employé
au Sud-Est de l’Afrique. Dans Trente ans de P a ris de Daudet on peut voir à la page 16 7 que le mot cachimbau est
usité en Provence.