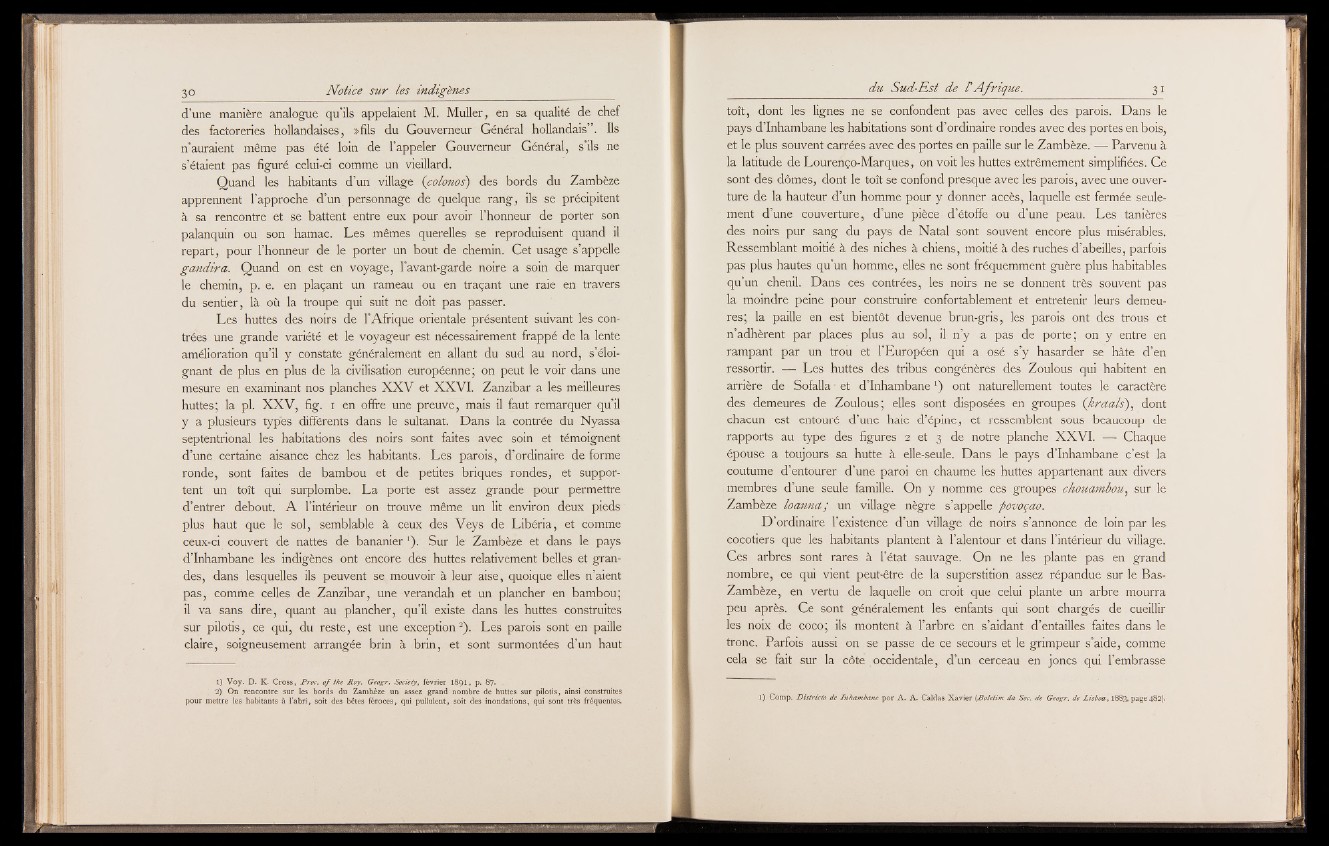
d’une manière analogue qu’ils appelaient M. Muller, en sa qualité de chef
des factoreries hollandaises, »fils du Gouverneur Général hollandais” . Ils
n’auraient même pas été loin de l’appeler Gouverneur Général, s’ils ne
s’étaient pas figuré celui-ci comme un vieillard.
Quand les habitants d’un village (çolonos) des bords du Zambèze
apprennent l’approche d’un personnage de quelque rang, ils se précipitent
à sa rencontre et se battent entre eux pour avoir l’honneur de porter son
palanquin ou son hamac. Les mêmes querelles se reproduisent quand il
repart, pour l’honneur de le porter un bout de chemin. Cet usage s’appelle
gandin a. Quand on est en voyage, l’avant-garde noire a soin de marquer
le chemin, p. e. en plaçant un rameau ou en traçant une raie en travers
du sentier, là où la troupe qui suit ne doit pas passer.
Les huttes des noirs de l’Afrique orientale présentent suivant les contrées
une grande variété et le voyageur est nécessairement frappé de la lente
amélioration qu’il y constate généralement en allant du sud au nord, s’éloignant
de plus en plus de la civilisation européenne; on peut le voir dans une
mesure en examinant nos planches X X V et X X V I. Zanzibar a les meilleures
huttes; la pl. X X V , fig. i en offre une preuve, mais il faut remarquer qu’il
y a plusieurs types différents dans le sultanat. Dans la contrée du Nyassa
septentrional les habitations des noirs sont faites avec soin et témoignent
d’une certaine aisance chez les habitants. Les parois, d’ordinaire de forme
ronde, sont faites de bambou et de petites briques rondes, et supportent
un toît qui surplombe. L a porte est assez grande pour permettre
d’entrer debout. A l’intérieur on trouve même un lit environ deux pieds
plus haut que le sol, semblable à ceux des Veys de Libéria, et comme
ceux-ci couvert de nattes de bananier '). Sur le Zambèze et dans le pays
d’Inhambane les indigènes ont encore des huttes relativement belles et grandes,
dans lesquelles ils peuvent se mouvoir à leur aise, quoique elles n’aient
pas, comme celles de Zanzibar, une verandah et un plancher en bambou;
il va sans dire, quant au plancher, qu’il existe dans les huttes construites
sur pilotis, ce qui, du reste, est une exception2). Les parois sont en paille
claire, soigneusement arrangée brin à brin, et sont surmontées d’un haut
1) Voy. D. K. Cross, Proc, o f the Roy. Geogr. Society, février 18 9 1 , p. 87. _
2) On rencontre sur les bords du Zambèze un assez grand nombre de huttes sur pilotis, ainsi construites
pour mettre les habitants à l’abri, soit des bêtes féroces, qui pullulent, soit des inondations, qui sont très fréquentes.
toît, dont les lignes ne se confondent pas avec celles des parois. Dans le
pays d’Inhambane les habitations sont d’ordinaire rondes avec des portes en bois,
et le plus souvent carrées avec des portes en paille sur le Zambèze. — Parvenu à
la latitude de Lourenço-Marques, on voit les huttes extrêmement simplifiées. Ce
sont des dômes, dont le toît se confond presque avec les parois, avec une ouverture
de la hauteur d’un homme pour y donner accès, laquelle est fermée seulement
d’une couverture, d’une pièce d’étoffe ou d’une peau. Les tanières
des noirs pur sang du pays de Natal sont souvent encore plus misérables.
Ressemblant moitié à des niches à chiens, moitié à des ruches d’abeilles, parfois
pas plus hautes qu’un homme, elles ne sont fréquemment guère plus habitables
qu’un chenil. Dans ces contrées, les noirs ne se donnent très souvent pas
la moindre peine pour construire confortablement et entretenir leurs demeures;
la paille en est bientôt devenue brun-gris, les parois ont des trous et
n’adhèrent par places plus au sol, il n’y a pas de porte; on y entre en
rampant par un trou et l'Européen qui a osé s’y hasarder se hâte d’en
ressortir. —■ Les huttes des tribus congénères des Zoulous qui habitent en
arrière de Sofalla- et d’Inhambane1) ont naturellement toutes lé caractère
des demeures de Zoulous; elles sont disposées en groupes (k ra a ls), dont
chacun est entouré d’une haie d’épine, et ressemblent sous beaucoup de
rapports, au type des figures 2 et 3 de notre planche X X V I. Chaque
épouse a toujours sa hutte à elle-seule. Dans pays d’Inhambane c’est la
coutume d’entourer d’une paroi en chaume les huttes appartenant aux divers
membres d’une seule famille. On y nomme ces groupes chouambou, sur le
Zambèze loanna; un village nègre s’appelle fovoçao.
D ’ordinaire l’existence d’un village de noirs s’annonce détîoin par les
cocotiers que les habitants plantent à l’alentour et dans l’intérieur du village.
Ces arbres sont rares à l’état sauvage. On ne les plante pas en grand
nombre, ce qui vient peut-être de la superstition assez répandue sur le Bas-
Zambèze, en vertu de laquelle on croit que celui plante un arbre mourra
peu après. Ce sont généralement les enfants qui sont chargés de cueillir
les noix de coco; ils montent à l’arbre en s’aidant d’entailles faites dans le
tronc. Parfois aussi on se passe de ce secours et le grimpeur s’aide, comme
cela se fait sur la côte occidentale, d’un cerceau en joncs qui l’embrasse
1) Comp. Districto de Inhambane por A . A . Caldas Xavier (.Boletim da Soc. de Geogr. de Lisboa, 1883, page 482).