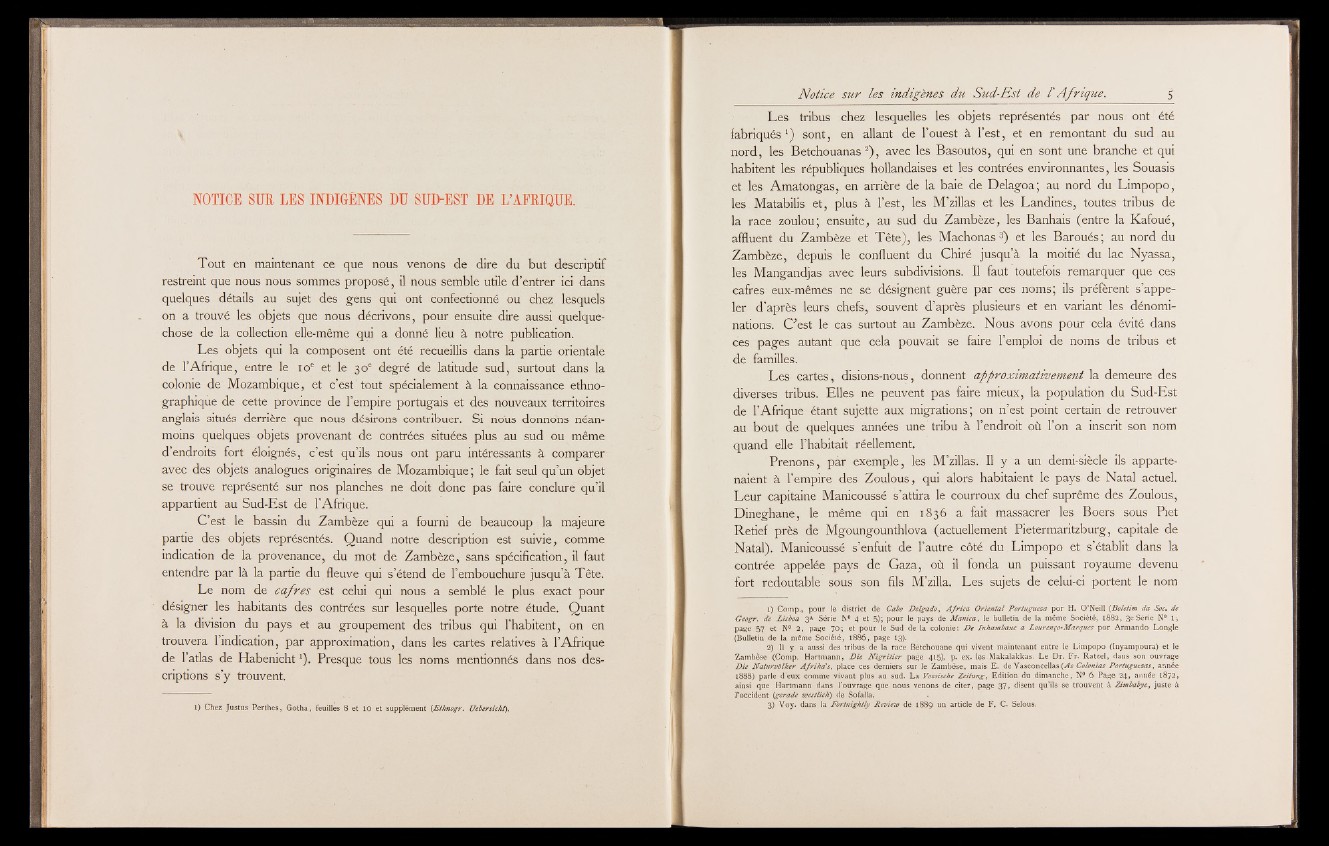
NOTICE SUR LES INDIGÈNES DU SUD-EST DE L’AFRIQUE.
Tout en maintenant ce que nous venons de dire du but descriptif
restreint que nous nous sommes proposé, il nous semble utile d’entrer ici dans
quelques détails au sujet des gens qui ont confectionné ou chez lesquels
on a trouvé les objets que nous décrivons, pour ensuite dire aussi quelque-
chose de la collection elle-même qui a donné lieu à notre publication.
Le s objets qui la composent ont été recueillis dans la partie orientale
de l’Afrique, entre le 10e et le 30e degré de latitude sud, surtout dans la
colonie de Mozambique, et c’est tout spécialement à la connaissance ethnographique
de cette province de l’empire portugais et des nouveaux territoires
anglais situés derrière que nous désirons contribuer. Si nous donnons néanmoins
quelques objets provenant de contrées situées plus au sud ou même
d’endroits fort éloignés, c’est qu’ils nous ont paru intéressants à comparer
avec des objets analogues originaires de Mozambique; le fait seul qu’un objet
se trouve représenté sur nos planches ne doit donc pas faire conclure qu’il
appartient au Sud-Est de l’Afrique.
C ’est le bassin du Zambèze qui a fourni de beaucoup la majeure
partie des objets représentés. Quand notre description est suivie, comme
indication de la provenance, du mot de Zambèze, sans spécification, il faut
entendre par là la partie du fleuve qui s’étend de l’embouchure jusqu’à Tête.
L e nom de ca fres est celui qui nous a semblé le plus exact pour
désigner les habitants des contrées sur lesquelles porte notre étude. Quant
à la division du pays et au groupement des tribus qui l’habitent, on en
trouvera l’indication, par approximation, dans les cartes relatives à l’Afrique
de l’atlas de Habenicht *). Presque tous les noms mentionnés dans nos descriptions
s ’y trouvent.
l) Chez Justus Perthes, Gotha, feuilles 8 et ÎO et supplément (Ethnogr. Uebersichf).
Le s tribus chez lesquelles les objets représentés par nous ont été
fabriqués1) sont, en allant de l’ouest à l’est, et en remontant du sud au
nord, les Betchouanas 2) , avec les Basoutos, qui en sont une branche et qui
habitent les républiques hollandaises et les contrées environnantes, les Souasis
et les Amatongas, en arrière de la baie de Delagoa; au nord du Limpopo,
les Matabilis et, plus à l’est, les M’zillas et les Landines, toutes tribus de
la race zoulou; ensuite, au sud du Zambèze, les Banhais (entre la Kafoué,
affluent du Zambèze et Tête), les Machonas3) et les Baroués; au nord du
Zambèze, depuis le confluent du Chiré jusqu’à la moitié du lac Nyassa,
les Mangandjas avec leurs subdivisions. Il faut toutefois remarquer que ces
cafres eux-mêmes ne se désignent guère par ces noms; ils préfèrent s’appeler
d’après leurs chefs, souvent d’après plusieurs et en variant les dénominations.
C ’est le cas surtout au Zambèze. Nous avons pour cela évité dans
ces pages autant que cela pouvait se faire l’emploi de noms de tribus et
de familles.
Le s cartes, disions-nous, donnent approximativement la demeure des
diverses tribus. Elles ne peuvent pas faire mieux, la population du Sud-Est
de l’Afrique: étant sujette aux migrations; on n’est point certain de retrouver
au bout de quelques années une tribu à l’endroit où l’on a inscrit son nom
quand elle l’habitait réellement.
Prenons, par exemple, les M’zillas. Il y a. un demi-siècle ils appartenaient
à l’empire des Zoulous, qui alors habitaient le pays de Natal actuel.
Leur capitaine Manicoussé s’attira le courroux du chef suprême des Zoulous,
Dineghane, le même qui en 1836 a fait massacrer les Boers sous Piet
Retief près de Mgoungounthlova (actuellement Pietermaritzburg, capitale de
Natal). Manicoussé s’enfuit de l’autre côté du Limpopo et s’établit dans la
contrée appelée pays de Gaza, où il fonda un puissant royaume devenu
fort redoutable sous son fils M’zilla. Le s sujets de celui-ci portent le nom
1) Comp., pour le district de Cabo Delgado, A frica Oriental portugueza por H. O’Neill (Boielim da Soc. de
Geogr. de Lisboa 3A Série N° 4 et 5); pour le pays de Manica, le bulletin de la môme Société, 1882, 3eSérie N° 1',
page 57 et N° 2 , page 70 ;, et pour le Sud de la colonie; D e Inhambane a Lourenço-Marques por Armando Longle
{Bulletin de la même Société, 1886, page 13).
2) 11 y a aussi des tribus de la race Bétchouane qui vivent maintenant entre le Limpopo (Inyampoura) et le
Zambèse (Comp. Hartmann, D ie N ig ritie r page 415), P- ex. les Makalakkas. L e Dr. Fr. Ratzel, dans son ouvrage
D ie Naturvölker A frik a 's, place ces derniers sur le Zambèse, mais E . de Vasconcellas (A s Colonias Portuguezas, année
1888) parle d'eux comme vivant plus au sud. L a Vossische Zeitung, Edition du dimanche, N° 6 Page 24, année 1872 ,
ainsi que Hartmann dans l'ouvrage que nous venons dè citer, page 3 7 » disent qu’ils se trouvent à Zimbabye, juste à
l’occident (gerade westlich) de Sofalla. «
3) Voy. dans la Fortnightly Review de 1889 un article de F . C. Selous.