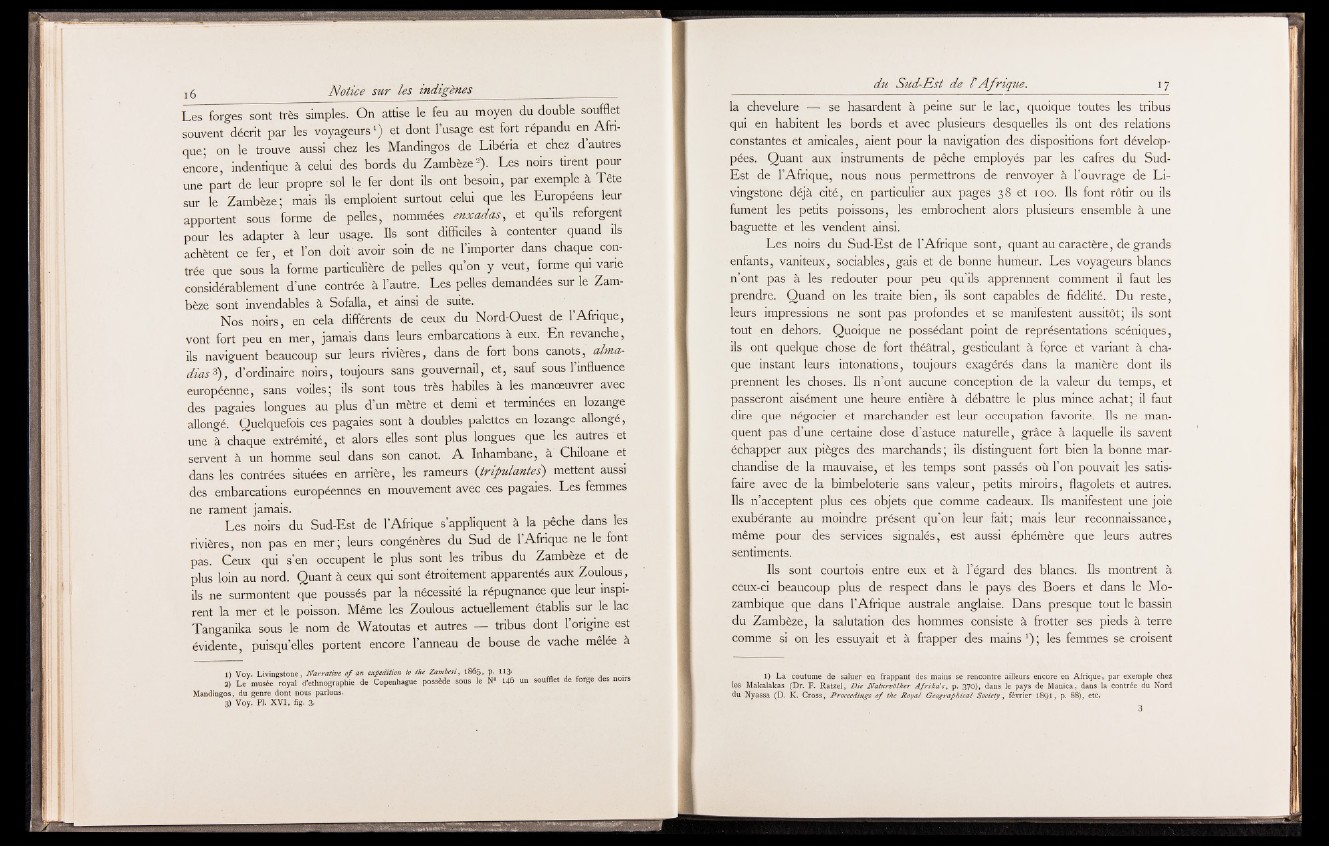
16
Le s forges sont très simples. On attise le feu au moyen du double soufflet
souvent décrit par les voyageurs ‘ ) et dont l’usage est fort répandu en Afrique
; on le trouve aussi chez les Mandingos de Libéria et chez d autres
encore, indentique à celui des bords du Zambèze3). Le s noirs tirent pour
une part de leur propre sol le fer dont ils ont besoin, par exemple à Tête
sur le Zambèze; mais ils emploient surtout celui que les Européens leur
apportent sous forme de pelles, nommées enxadas-, et qu’ils reforgent
pour les adapter à leur usage. Ils sont difficiles à contenter quand ils
achètent ce fer, et l’on doit avoir soin de ne l’importer dans chaque contrée
que sous la forme particulière de pelles quon y veut, forme qui varie
considérablement d’une contrée à l’autre. Les pelles demandées sur le Zambèze
sont invendables à Sofalla, et ainsi de suite.
Nos noirs, en cela différents de ceux du Nord-Ouest de 1 Afrique,
vont fort peu en mer, jamais dans leurs embarcations à eux. En revanche,
ils naviguent beaucoup sur leurs rivières, dans de fort bons canots, alma-
d ia s 3) , d’ordinaire noirs, toujours sans gouvernail, et, sauf sous l’influence
européenne, sans voiles; ils sont tous très habiles à les manoeuvrer avec
des pagaies longues au plus d un mètre et demi et terminées en lozange
allongé. Quelquefois ces pagaies sont à doubles palettes en lozange allongé,
une à chaque extrémité, et alors elles sont plus longues que les autres et
servent à un homme seul dans son canot. A Inhambane, à Chiloane et
dans les contrées situées en arrière, les rameurs (tripulantes) mettent aussi
des embarcations européennes en mouvement avec ces pagaies. Les femmes
ne rament jamais.
Le s noirs du Sud-Est de l’Afrique s’appliquent à la pêche dans les
rivières, non pas en mer; leurs congénères du Sud de 1 Afrique ne le font
pas. Ceux qui s’en occupent le plus sont les tribus du Zambèze et de
plus loin au nord. Quant à ceux qui sont étroitement apparentés aux Zoulous,
ils ne surmontent que poussés par la nécessité la répugnance que leur inspirent
la mer et le poisson. Même les Zoulous actuellement établis sur le lac
Tanganika sous le nom de Watoutas et autres — tribus dont 1 origine est
évidente, puisqu’elles portent encore l’anneau de bouse de vache mêlée à 1 2 3
1) Voy. Livingstone, Narrative o f an expédition to the Zambesi, 1865, p. 113- ‘
2) L e musée royal d’ethnographie de Copenhague possède sous le N° 146 un soufflet de forge des noirs
Mandingos, du genre dont nous parlons.
3) Voy. PI. X V I , fig. 3 -
la chevelure —- se hasardent à peine sur le lac, quoique toutes les tribus
qui en habitent les bords et avec plusieurs desquelles ils ont des relations
constantes et amicales, aient pour la navigation des dispositions fort développées.
Quant aux instruments de pêche employés par les cafres du Sud-
Est de l’Afrique, nous nous permettrons de renvoyer à l’ouvrage de L ivingstone
déjà cité, en particulier aux pages 38 et 100. Ils font rôtir ou ils
fument les petits poissons, les embrochent alors plusieurs ensemble à une
baguette et les vendent ainsi.
Les noirs du Sud-Est de l’Afrique sont, quant au caractère, de grands
enfants, vaniteux, sociables, gais et de bonne humeur. Les voyageurs blancs
n’ont pas à les redouter pour peu qu’ils apprennent comment il faut les
prendre. Quand on les traite bien, ils sont capables de fidélité. Du reste,
leurs impressions ne sont pas profondes’ et se manifestent aussitôt; ils sont
tout en dehors. Quoique ne possédant point de représentations scéniques,
ils ont quelque chose de fort théâtral, gesticulant à force et variant à chaque
instant leurs intonations, toujours exagérés dans la manière dont ils
prennent les choses. Ils n’ont aucune conception de la valeur du temps, et
passeront aisément une heure entière à débattre le plus mince achat; il faut
dire que négocier et marchander est leur occupation favorite. Ils ne manquent
pas d’une certaine dose d’astuce naturelle, grâce à laquelle ils savent
échapper aux pièges des marchands; ils distinguent fort bien la bonne marchandise
de la mauvaise, et les temps sont passés où l’on pouvait les satisfaire
avec de la bimbeloterie sans valeur, petits miroirs, flagolets et autres.
Ils n’acceptent plus ces objets que comme cadeaux. Ils manifestent une joie
exubérante au moindre présent qu’on leur fait; mais leur reconnaissance,
même pour des services signalés, est aussi éphémère que leurs autres
sentiments.
Ils sont courtois entre eux et à l’égard des blancs. Ils montrent à
ceux-ci beaucoup plus de respect dans le pays des Boers et dans le Mozambique
que dans l’Afrique australe anglaise. Dans presque tout le bassin
du Zambèze, la salutation des hommes consiste à frotter ses pieds à terre
comme si on les essuyait et à frapper des mains *) ; les femmes se croisent 1
1) L a coutume de saluer en frappant des mains se rencontre ailleurs encore en Afrique, par exemple chez
les Makalakas (Dr. F. Ratzel, D ie Naturvölker A fr ik a s , p. 370), dans le pays de Manica, dans la contrée du Nord
du Nyassa (D. K. Cross, .Proceedings o f the Royal Geographical Society, février 18 9 1 , p. 88), etc.