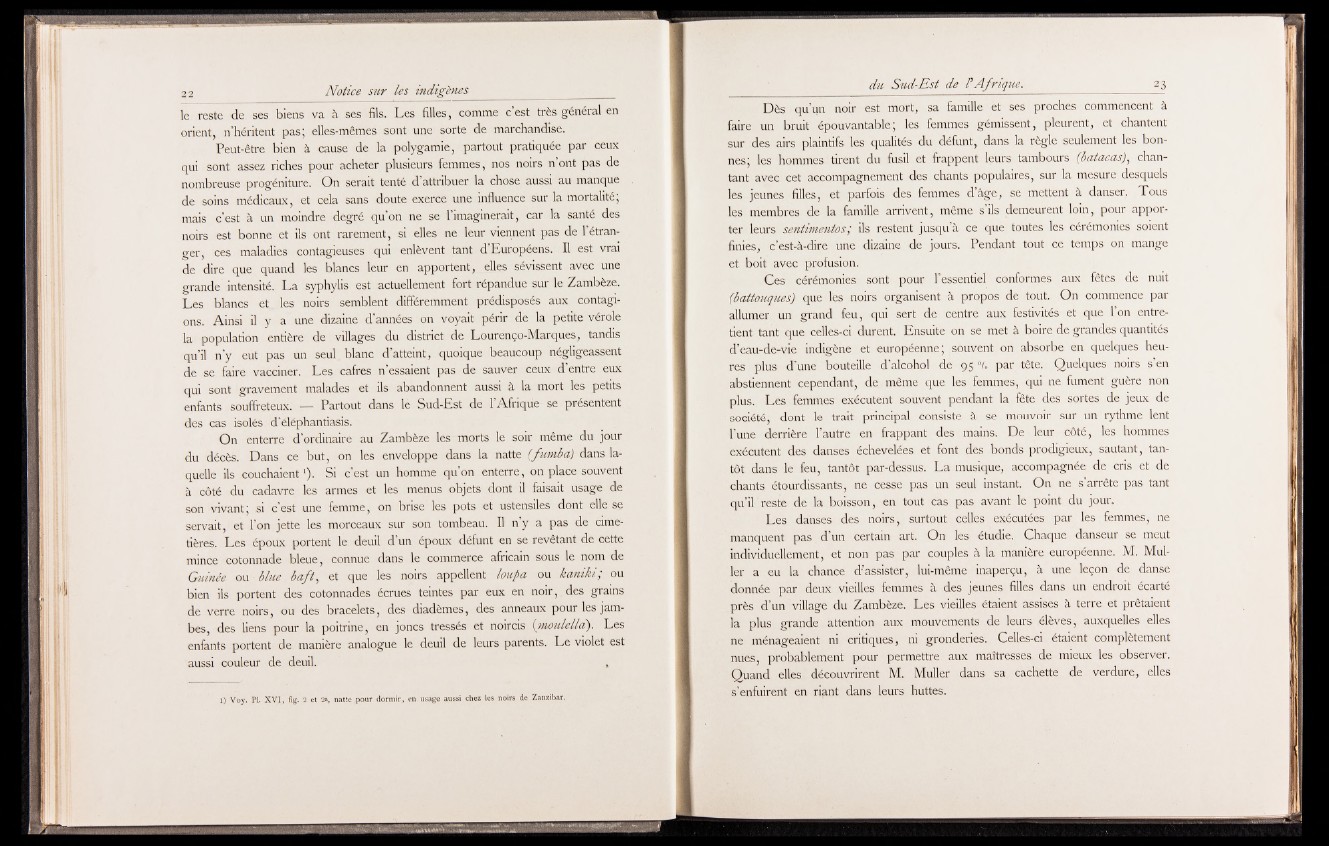
le reste de ses biens va à ses fils. Les filles, comme c’est très général en
orient, n’héritent pas; elles-mêmes sont une sorte de marchandise.
Peut-être bien à cause de la polygamie, partout pratiquée par ceux
qui sont assez riches pour acheter plusieurs femmes, nos noirs n ont pas de
nombreuse progéniture. On serait tenté d’attribuer la chose aussi au manque
de soins médicaux, et cela sans doute exerce une influence sur la mortalité;
mais c’est à un moindre degré qu’on ne se l’imaginerait, car la santé des
noirs est bonne et ils ont rarement, si elles ne leur viennent pas de 1 étranger,
ces maladies contagieuses qui enlèvent tant d Européens. Il est vrai
de dire que quand les blancs leur en apportent, elles sévissent avec une
grande intensité. L a syphylis est actuellement fort répandue sur le Zambèze.
Les blancs et les noirs semblent différemment prédisposés aux contagions.
Ainsi il y a une dizaine d’années on voyait périr de la petite vérole
la population entière de villages du district de Lourenço-Marques, tandis
qu’il n’y eut pas un seul blanc d’atteint, quoique beaucoup négligeassent
de se faire vacciner. Les cafres n’essaient pas de sauver ceux d’entre eux
qui sont gravement malades et ils abandonnent aussi à la mort les petits
enfants souffreteux. — Partout dans le Sud-Est de l’Afrique se présentent
des cas isolés d’éléphantiasis.
On enterre d’ordinaire au Zambèze les morts le soir même du jour
du décès. Dans ce but, on les enveloppe dans la natte (fumba) dans laquelle
ils couchaientl). Si c’est un homme qu’on enterre, on place souvent
à côté du cadavre les armes et les menus objets dont il faisait usage de
son vivant; si c’est une femme, on brise les pots et ustensiles dont elle se
servait, et l’on jette les morceaux sur son tombeau. Il n’y a pas de cimetières.
Les époux portent le deuil d’un époux défunt en se revêtant de cette
mince cotonnade bleue, connue dans le commerce africain sous le nom de
Guinée ou blue b a ft, et que les noirs appellent loupa ou k a n ik i; ou
bien ils portent des cotonnades écrues teintes par eux en noir, des grains
de verre noirs, ou des bracelets, des diadèmes, des anneaux pour les jambes,
des liens pour la poitrine, en joncs tressés et noircis (moulella). Les
enfants portent de manière analogue le deuil de leurs parents. L e violet est
aussi couleur de deuil. ,
1) Voy. PI. X V I , fig. 2 et 2«, natte pour dormir, en usage aussi chez les noirs de Zanzibar.
Dès qu’un noir est mort, sa famille et ses proches commencent à
faire un bruit épouvantable; les femmes gémissent, pleurent, et chantent
sur des airs plaintifs les qualités du défunt, dans la règle seulement les bonnes;
les hommes tirent du fusil et frappent leurs tambours (batacasj, chantant
avec cet accompagnement des chants populaires, sur la mesure desquels
les jeunes filles, et parfois des femmes d a g e , se mettent à danser. Tous
les membres de la famille arrivent, même s’ils demeurent loin, pour apporter
leurs sentimentos; ils restent jusqu’à ce que toutes les cérémonies soient
finies, c’est-à-dire une dizaine de jours. Pendant tout ce temps on mange
et boit avec profusion.
Ces cérémonies sont pour l’essentiel conformes aux fêtes de nuit
(battouques) que les noirs organisent à propos de tout. On commence par
allumer un grand feu, qui sert de centre aux festivités et que 1 on entretient
tant que celles-ci durent. Ensuite on se met à boire de grandes quantités
d’eau-de-vie indigène et européenne; souvent on absorbe en quelques heures
plus d’une bouteille d’alcohol de 95 "/, par tête. Quelques noirs s’en
abstiennent cependant, de même que les femmes, qui ne fument guère non
plus. Les femmes exécutent souvent pendant la fête des sortes de jeux de
société, dont le trait principal consiste à se mouvoir sur un rythme lent
l’une derrière l’autre en frappant des mains. De leur côté, les hommes
exécutent des danses échevelées et font des bonds prodigieux, sautant, tantôt
dans le feu, tantôt par-dessus. L a musique, accompagnée de cris et de
chants étourdissants, ne cesse pas un seul instant. On ne s’arrête pas tant
qu’il reste de la boisson, en tout cas pas avant le point du jour.
Les danses des noirs, surtout celles exécutées par les femmes, ne
manquent pas d’un certain art. On les étudie. Chaque danseur se meut
individuellement, et non pas par couples à la manière européenne. M. Muller
a eu la chance d’assister, lui-même inaperçu, à une leçon de danse
donnée par deux vieilles femmes à des jeunes filles dans un endroit écarté
près d’un village du Zambèze. Les vieilles étaient assises à terre et prêtaient
la plus grande attention aux mouvements de leurs élèves, auxquelles elles
ne ménageaient ni critiques, ni gronderies. Celles-ci étaient complètement
nues, probablement pour permettre aux maîtresses de mieux les observer.
Quand elles découvrirent M. Muller dans sa cachette de verdure, elles
s’enfuirent en riant dans leurs huttes.