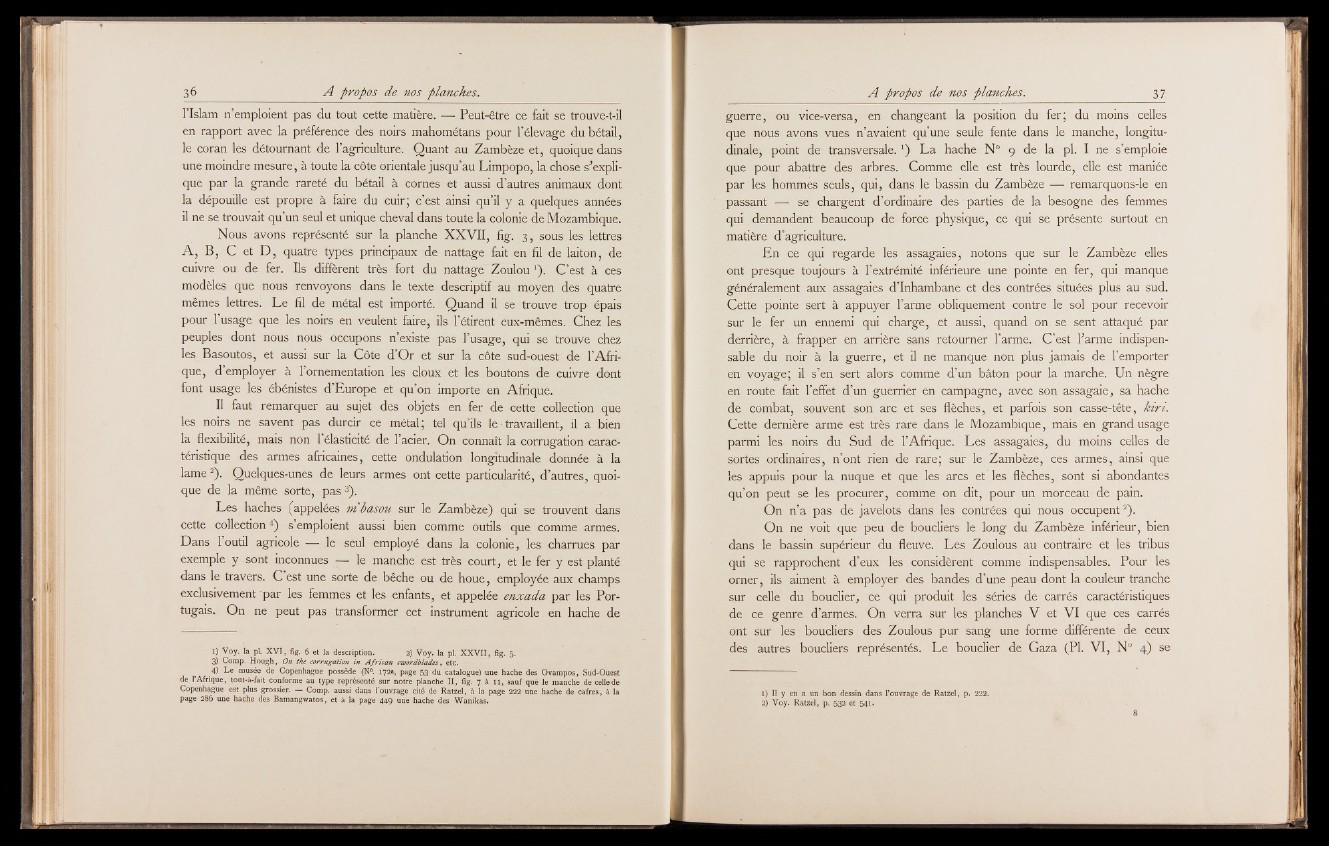
l’Islam n’emploient pas du tout cette matière. — Peut-être ce fait se trouve-t-il
en rapport avec la préférence des noirs mahométans pour l’élevage du bétail,
le coran les détournant de l’agriculture. Quant au Zambèze et, quoique dans
une moindre mesure, à toute la côte orientale jusqu’au Limpopo, la chose s'explique
par la grande rareté du bétail à cornes et aussi d’autres animaux dont
la dépouille est propre à faire du cuir; c’est ainsi qu’il y a quelques années
il ne se trouvait qu’un seul et unique cheval dans toute la colonie de Mozambique.
Nous avons représenté sur la planche X X V I I , fig. 3 , sous les lettres
A , B , C et D , quatre types principaux de nattage fait en fil de laiton, de
cuivre ou de fer. Ils diffèrent très fort du nattage Zoulou 1). C ’est à ces
modèles que nous renvoyons dans le texte descriptif au moyen des quatre
mêmes lettres. L e fil de métal est importé. Quand il se trouve trop épais
pour 1 usage que les noirs en veulent faire, ils l’étirent eux-mêmes. Chez les
peuples dont nous nous occupons n’existe pas l’usage, qui se trouve chez
les Basoutos, et aussi sur la Côte d’Or et sur la côte sud-ouest de l’Afrique,
d’employer à l’ornementation les doux et les boutons de cuivre dont
font usage les ébénistes d’Europe et qu’on importe en Afrique.
Il faut remarquer au sujet des objets en fer de cette collection que
les noirs ne savent pas durcir ce métal; tel qu’ils le • travaillent, il a bien
la flexibilité, mais non l’élasticité de l’acier. On connaît la corrugation caractéristique
des armes africaines, cette ondulation longitudinale donnée à la
lame2). Quelques-unes de leurs armes ont cette particularité, d’autres, quoique
de la même sorte, p a s 3).
Le s haches (appelées nibasou sur le Zambèze) qui se trouvent dans
cette collection4) s emploient aussi bien comme outils que comme armes.
Dans 1 outil agricole -—■ le seul employé dans la colonie, les charrues par
exemple y sont inconnues -— le manche est très court, et le fer y est planté
dans le travers. C e st une sorte de bêche ou de houe, employée aux champs
exclusivement par les femmes et les enfants, et appelée enxada par les Portugais.
On ne peut pas transformer cet instrument agricole en hache de
1) Voy. la pi. X V I , ffe. 6 et la description. 2) Voy. la pi.. X X V I I , fig. 5.
3) Comp. Hough, On the corrugation in A frican swordb lades, etc.
4) L e musée de Copenhague possède (N°. 172a, page 53 du catalogue) une hache des Ovampos, Sud-Ouest
de 1 Afrique, tout-à-fait conforme au type représenté sur notre planche I I , fig. 7 à 1 1 , sauf què le manche de celle de
Copenhague est plus grossier. — Comp. aussi dans l’ouvrage cité de Ratzel, à la page 222 une hache de cafres, à la
page 286 une hache des Bamangwatos, et à la page 449 une hache des Wanikas.
guerre, ou vice-versa, en changeant la position du fer; du moins celles
que nous avons vues n’avaient qu’une seule fente dans le manche, longitudinale;
point de transversale. l) L a hache N° 9 de la pl. I ne s’emploie
que pour abattre des arbres. Comme elle est très lourde, elle est maniée
par les hommes seuls, qui, dans le bassin du Zambèze — remarquons-le en
passant •—■ se chargent d’ordinaire des parties de la besogne des femmes
qui demandent beaucoup de force physique, ce qui se présente surtout en
matière d’agriculture.
En ce qui regarde lès assagaies, notons que sur le Zambèze elles
ont presque toujours à l’extrémité inférieure une pointe en fer, qui manque
généralement aux assagaies d’Inhambane et des contrées situées plus au sud.
Cette pointe sert à appuyer l’arme obliquement contre le sol pour recevoir
sur le fer un ennemi qui charge, et aussi, quand on se sent attaqué par
derrière, à frapper en arrière sans retourner l’arme. C ’est l'arme indispensable
du noir à la guerre, et il ne manque non plus jamais de l’emporter
en voyage; il s’en sert alors comme d’un bâton pour la marche. Un nègre
en route fait l’effet d’un guerrier en campagne, avec son assagaie, sa hache
de combat, souvent son arc et ses flèches, et parfois son casse-tête, k iri.
Cette dernière arme est très rare dans le Mozambique, mais en grand usage
parmi les noirs du Sud de l’Afrique. Le s assagaies, du moins celles de
sortes ordinaires, n’ont rien de rare; sur le Zambèze, ces armes, ainsi qùe
les appuis pour la nuque et que les arcs et les flèches, sont si abondantes
qu’on peut se les procurer, comme on dit, pour un morceau de pain.
On n’a pas de javelots dans les contrées qui nous occupent2).
On ne voit que peu de boucliers le long du Zambèze inférieur, bien
dans le bassin supérieur du fleuve. Le s Zoulous au contraire et les tribus
qui se rapprochent d’eux les considèrent comme indispensables. Pour les
orner, ils aiment à employer des bandes d’une peau dont la couleur tranche
sur celle du bouclier, ce qui produit les séries de carrés caractéristiques
de ce genre d’armes. On verra sur les planches V et V I que ces carrés
ont sur les boucliers des Zoulous pur sang une forme différente de ceux
des autres boucliers représentés. L e bouclier de Gaza (Pl. V I, N° 4) se
1) Il y en a un bon dessin dans l’ouvrage de Ratzel, p. 222.
2) Voy. Ratzel, p. 532 et 541.