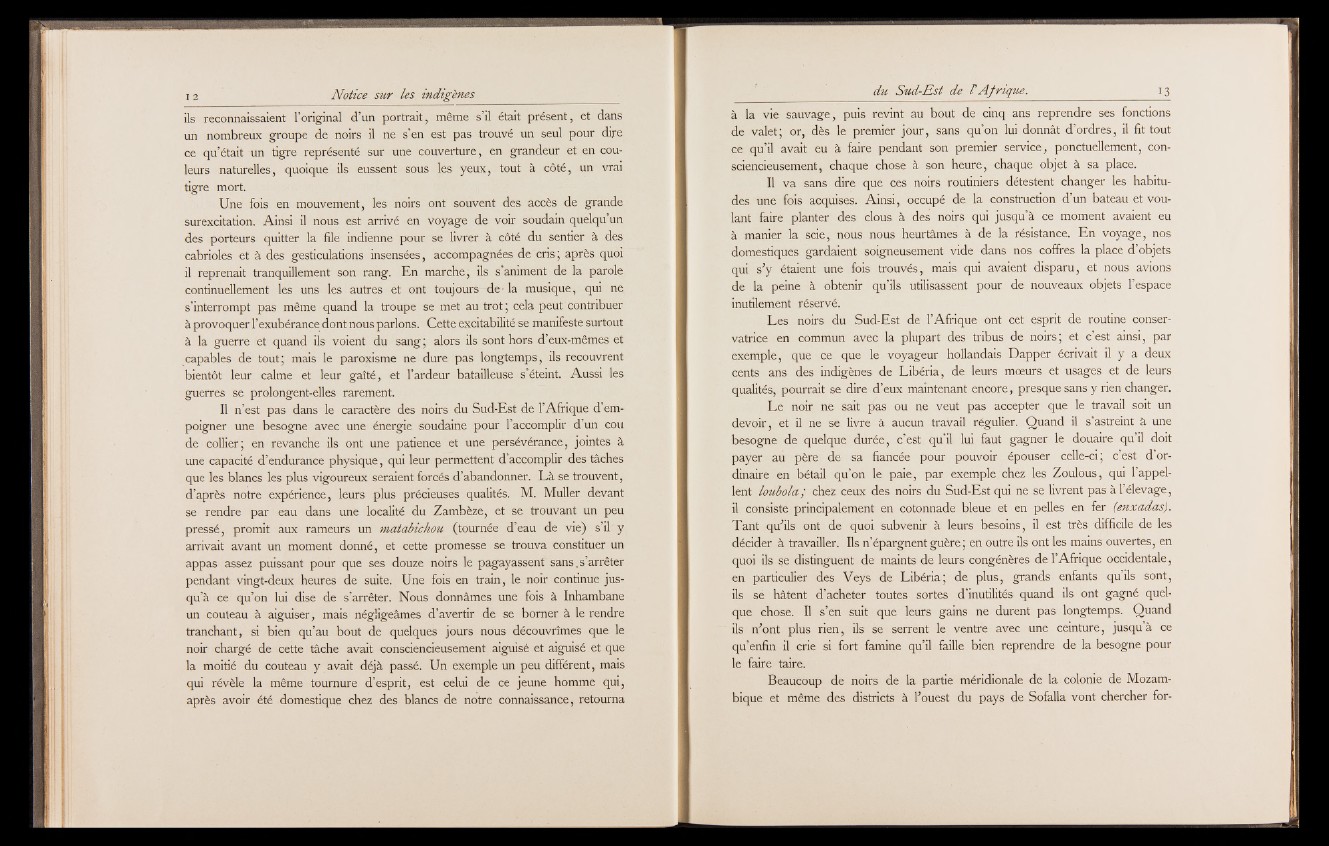
ils reconnaissaient l’original d’un portrait, même s’il était présent, et dans
un nombreux groupe de noirs il ne s’en est pas trouvé un seul pour dire
ce qu’était un tigre représenté sur une couverture, en grandeur et en couleurs
naturelles, quoique ils eussent sous les yeux, tout à côté, un vrai
tigre mort.
Une fois en mouvement, les noirs ont souvent des accès de grande
surexcitation. Ainsi il nous est arrivé en voyage de voir soudain quelqu un
des porteurs quitter la file indienne pour se livrer à côté du sentier à des
cabrioles et à des gesticulations insensées, accompagnées de cris; après quoi
il reprenait tranquillement son rang. En marche, ils s’animent de la parole
continuellement les uns les autres et ont toujours de- la musique, qui ne
s’interrompt pas même quand la troupe se met au trot; cela peut contribuer
à provoquer l’exubérance dont nous parlons. Cette excitabilité se manifeste surtout
à la guerre et quand ils voient du sang ; alors ils sont hors d’eux-mêmes et
capables de tout; mais le paroxisme ne dure pas longtemps, ils recouvrent
bientôt leur calme et leur gaîté, et l’ardeur batailleuse s’éteint. Aussi les
guerres se prolongent-elles rarement.
Il n’est pas dans le caractère des noirs du Sud-Est de l’Afrique d’empoigner
une besogne avec une énergie soudaine pour l’accomplir d’un cou
de collier; en revanche ils ont une patience et une persévérance, jointes à
une capacité d’endurance physique, qui leur permettent d’accomplir des tâches
que les blancs les plus vigoureux seraient forcés d’abandonner. L à se trouvent,
d’après notre expérience, leurs plus précieuses qualités. M. Muller devant
se rendre par eau dans une localité du Zambèze, et se trouvant un peu
pressé, promit aux rameurs un matabichou (tournée d’eau de vie) s’il y
arrivait avant un moment donné, et cette promesse se trouva constituer un
appas assez puissant pour que ses douze noirs le pagayassent sans.s’arrêter
pendant vingt-deux heures de suite. Une fois en train, le noir continue jusqu’à
ce qu’on lui dise de s’arrêter. Nous donnâmes une fois à Inhambane
un couteau à aiguiser, mais négligeâmes d’avertir de se borner à le rendre
tranchant, si bien qu’au bout de quelques jours nous découvrîmes que le
noir chargé de cette tâche avait consciencieusement aiguisé et aiguisé et que
la moitié du couteau y avait déjà passé. Un exemple un peu différent, mais
qui révèle la même tournure d’esprit, est celui de ce jeune homme qui,
après avoir été domestique chez des blancs de notre connaissance, retourna
à la vie sauvage, puis revint au bout de cinq ans reprendre ses fonctions
de valet; or, dès le premier jour, sans qu’on lui donnât d’ordres, il fit tout
ce qu’il avait eu à faire pendant son premier service, ponctuellement, consciencieusement,
chaque chose à son heure, chaque objet à sa place.
Il va sans dire que ces noirs routiniers détestent changer les habitudes
une fois acquises. Ainsi, occupé de la construction d’un bateau et voulant
faire planter des clous à des noirs qui jusqu’à ce moment avaient eu
à manier la scie, nous nous heurtâmes à de la résistance. E n voyage, nos
domestiques gardaient soigneusement vide dans nos coffres la place d’objets
qui s’y étaient une fois trouvés, mais qui avaient disparu, et nous avions
de la peine à obtenir qu’ils utilisassent pour de nouveaux objets l’espace
inutilement réservé.
Les noirs du Sud-Est de l’Afrique ont cet esprit de routine conservatrice
en commun avec la plupart des tribus de noirs; et c’est ainsi, par
exemple, que ce que le voyageur hollandais Dapper écrivait il y a deux
cents ans des indigènes de Libéria, de leurs moeurs et usages et de leurs
qualités, pourrait se dire d’eux maintenant encore, presque sans y rien changer.
L e noir ne sait pas ou ne veut pas accepter que le travail soit un
devoir, et il ne se livre à aucun travail régulier. Quand il s’astreint à une
besogne de quelque durée, c’est qu’il lui faut gagner le douaire qu’il doit
payer au père de sa fiancée pour pouvoir épouser celle-ci ; c’est d’ordinaire
en bétail qu’on le paie, par exemple chez les Zoulous, qui l’appellent
lo u b o la chez ceux des noirs du Sud-Est qui ne se livrent pas à l’élevage,
il consiste principalement en cotonnade bleue et en pelles en fer (enxadas).
Tant qu’ ils ont de quoi subvenir à leurs besoins, il est très difficile de les
décider à travailler. Ils n’épargnent guère ; en outre ils ont les mains ouvertes, en
quoi ils se distinguent de maints de leurs congénères de l’Afrique occidentale,
en particulier des Veys de Libéria; de plus, grands enfants qu’ils sont,
ils sé hâtent d’acheter toutes sortes d’inutilités quand ils ont gagné quelque
chose. Il s’en suit que leurs gains ne durent pas longtemps. Quand
ils n’ ont plus rien, ils se serrent le ventre avec une ceinture, jusqu à ce
qu’enfin il crie si fort famine qu’il faille bien reprendre de la besogne pour
le faire taire.
Beaucoup de noirs de la partie méridionale de la colonie de Mozambique
et même des districts à l’ ouest du pays de Sofalla vont chercher for