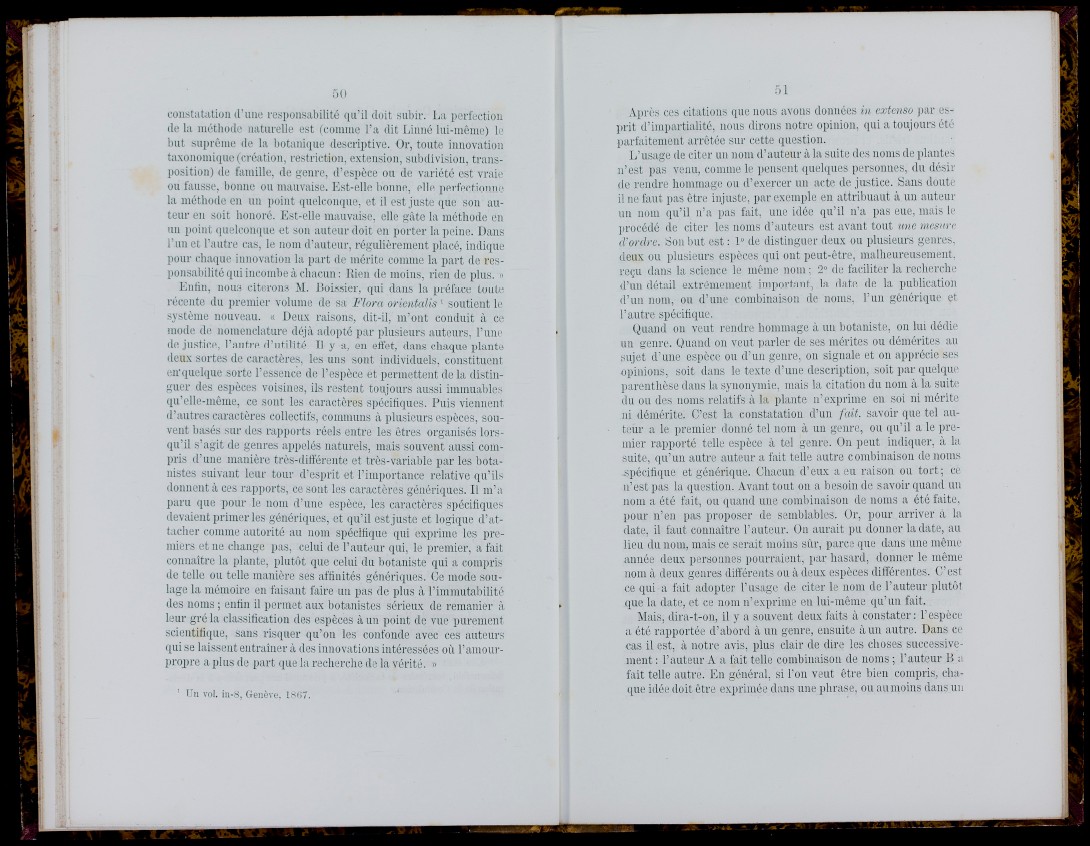
50
coustatiitiuii d'ime responsabilité ([u'il doit subir. La perfection
de la méthode naturelle est (comme l'a dit Linné lui-même) le
but suprème de la botanique descriptive. Or, toute innovation
taxonomique (création, restriction, extension, subdivision, transposition)
de famille, de genre, d'espèce ou de variété est vraie
ou fausse, bonne ou mauvaise. Est-elle bonne, elle perfectionne
la métliode en un point quelconque, et il est juste que son auteur
en soit honoré. Est-elle mauvaise, elle gâte la méthode en
un point (iuelcon([ue et son auteur doit en porter la peine. Dans
l'un et l'autre cas, le nom d'auteur, régulièrement placé, indique
pour chaque innovation la part de mérite connue la part de responsabilité
qui incombe à chacun : Rien de moins, rien de plus. «
Enfin, nous citerons M. Loissier, qui dans la préface toute
récente du premier volume de sa Flora orientalis ' soutient le
système nouveau. « Deux raisons, dit-il, m'ont conduit à ce
mode de nomenclature déjà adopté par plusieurs auteurs, l'une
de justice, l'autre d'utilité. Il y a, en effet, dans chaque plante
deux sortes de caractères, les uns sont individuels, constituent
en-quelque sorte l'essence de l'espèce et permettent de la distinguer
des espèces voisines, ils restent toujours aussi immuables
qu'elle-même, ce sont les caractères spécifiques. Puis viennent
d'autres caractères collectifs, communs à plusieurs espèces, souvent
basés sur des rapports réels entre les êtres organisés lorsqu'il
s'agit de genres appelés naturels, mais souvent aussi compris
d'une manière très-differente et très-variable par les botanistes
suivant leur tour d'esprit et l'importance relative qu'ils
donnent à ces rapports, ce sont les caractères génériques. Il m'a
paru que pour le nom d'une espèce, les caractères spécifiques
devaient primer les génériques, et qu'il est juste et logique d'attacher
comme autorité au nom spécifique qui exprime les premiers
et ne change pas, celui de l'auteur qui, le premier, a fait
connaître la plante, plutôt que celui du botaniste qui a compris
de telle ou telle manière ses affinités génériques. Ce mode soulage
la mémoire en faisant faire un pas de plus cà l'immutabilité
des noms ; enfin il permet aux botanistes sérieux de remanier à
leur gré la classification des espèces à un point de vue purement
scientifique, sans risquer qu'on les confonde avec ces auteurs
qui se laissent entraîner à des innovations intéressées où l'amourpropre
a plus de part que la recherche de la vérité. «
' Un vol. in-8, Genève. lS(i7.
51
Après ces citations que nous avons données in extenso ])ar esprit
d'impartialité, nous dirons notre opinion, qui a toujours été
})arfaitement arrêtée sui- cette question.
L'usage de citer un nom d'auteur à la suite des noms de plantes
n'est pas venu, comme le pensent quelques personnes, du désir
de rendre hommage ou d'exercer un acte de justice. Sans doute
il ne faut pas être injuste, par exemple en attribuant à un auteui'
un nom qu'il n'a pas fait, une idée qu'il n'a pas eue, mais le
l)rocédé de citer les noms d'auteurs est avant tout une mesure
iVordre. Son but est : 1° de distinguer deux ou plusieurs genres,
deux ou plusieurs espèces qui ont peut-être, malheureusement,
reçu dans la science le même nom ; 2° de faciliter la recherche
d'un détail extrêmement important, la date de la publication
d'un nom, ou d'une combinaison de noms, l'un générique et
l'autre spécifique.
Quand on veut rendre hommage à un botaniste, on lui dédie
un genre. Quand on veut parler de ses mérites ou démérites au
sujet d'une espèce ou d'un genre, on signale et on apprécie ses
opinions, soit dans le texte d'une description, soit par quelque
parenthèse dans la synonymie, mais la citation du nom à la suite
du ou des noms relatifs à la plante n'exprime en soi ni mérite
ni démérite. C'est la constatation d'un fait, savoir que tel auteur
a le premier donné tel nom cà un genre, ou qu'il a le premier
rapporté telle espèce à tel genre. On peut indiquer, à la
suite, qu'un autre auteur a fait telle autre combinaison de noms
-spécifique et générique. Chacun d'eux a eu raison ou tort; ce
n'est pas la question. Avant tout on a besoin de savoir quand un
nom a été fait, ou quand une combinaison de noms a été faite,
pour n'en pas proposer de semblables. Or, pour arriver à la
date, il faut connaître l'auteur. On aurait pu donner la date, au
lieu du nom, mais ce serait moins sûr, parce que dans une même
année deux personnes pourraient, par hasard, donner le même
nom à deux genres difiérents ou à deux espèces différentes. C'est
ce qui a fait adopter l'usage de citer le nom de l'auteur plutôt
que la date, et ce nom n'exprime en lui-même qu'un fait.
Mais, clira-t-on, il y a souvent deux faits à constater: l'espèce
a été rapportée d'abord à un genre, ensuite à un autre. Dans ce
cas il est, à notre avis, plus clair de dire les choses successivement
: l'auteur A a fait telle combinaison de noms ; l'auteur B a
fait telle autre. En général, si l'on veut être bien compris, cha-
(lue idée doit être exprimée dans une phrase, ou au moins dans un