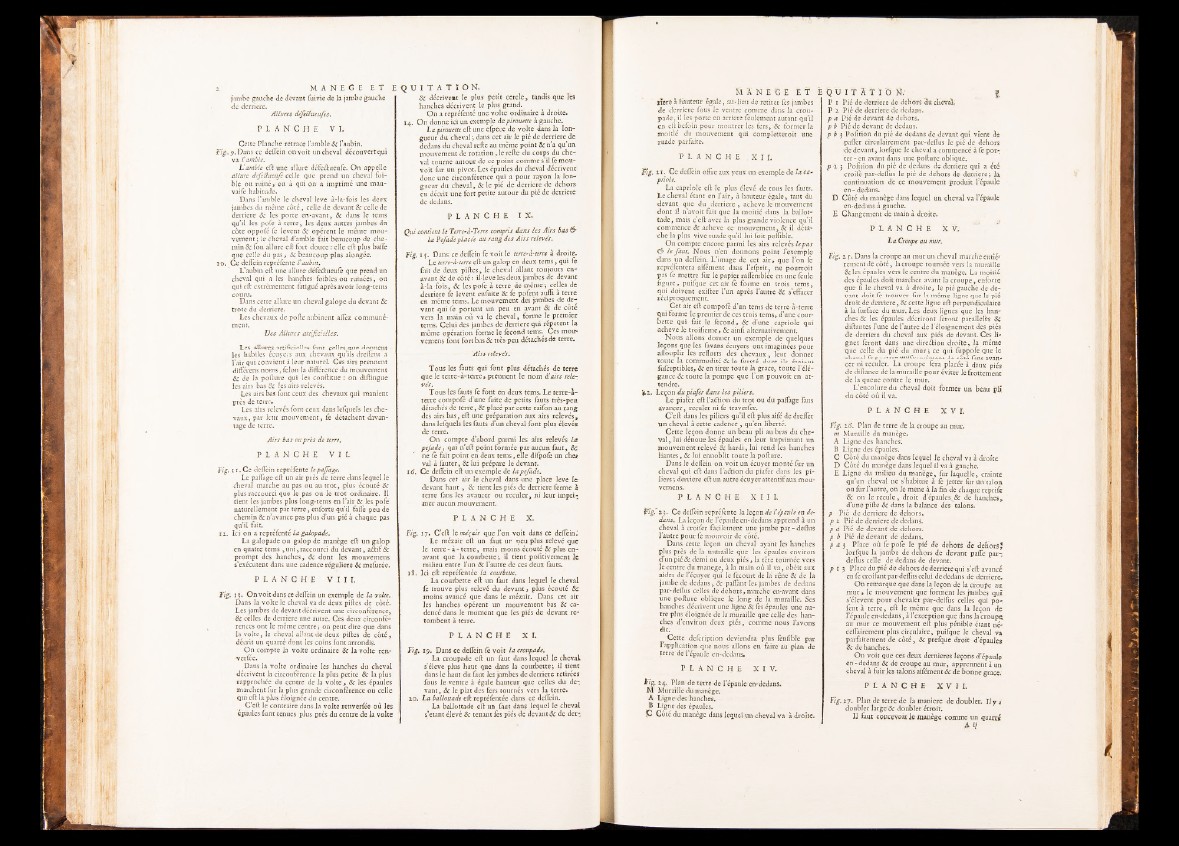
M A N E G E E T E
jambe gauche de devant fuivie de la .jambe gauche [
de derrière.
A llures defèclueu/es.
P L A N C H E V I .
Cette Planche retrace l’amble Sc l’aubin.
9. Dans ce delfein on voit un cheval découvert qui
va l’amble.
L ’amble eft une allure défeéhieufe. On appelle
allu re defcclueu/è celle que prend un cheval foi-
ble ou ruine, ou à qui on a imprimé une mau-
vaife habitude»
Dans l’amble le cheval leve à-la-fois les deux
jambes du même côté , celle de devant & celle de
derrière Sc les porte en-avant, & dans le tems
qu’il les pofè à terre, les deux autres jambes dn
côte oppofé le lèvent Sc opèrent le même mouvement;
le cheval d’amble fait beaucoup de chemin
& fon allure eft fort douce : elle eft plus baffe
que celle du p a s, Sc beaucoup plus alongée.
C e delfein reprélente l'a u b in .
L ’aubin eft une allure défeétueufè que prend un
cheval qui a les hanches foibles ou ruinées, ou
qui eft extrêmement fatigué après avoir long-tems
couru.
Dans cette allure un cheval galope du devant &
trote du derrière.
Les chevaux de porte aubinent allez communément.
D es A llures a rtific ielles.
L és allures font Cl“ » ^ n n en t
les habiles écuyers aux chevaux qu’ils dreffent à
l’air qui convient à leur naturel. Ces airs prennent
diffère ns noms, félon la différence du mouvement
Sc de la pofture qui les conftitue : on diftingue
les airs bas & les airs relevés.
Les airs bas lont ceux des chevaux qui manient
près de terre*
Les airs relevés font ceux dans lefquels les chevaux,
par leur mouvement, le détachent davantage
de terre.
A irs bas ou p rès de terre.
P L A N C H E V I L
1 1 . C e defféin reprélente le pajfage.
Le paftàge eft un air près de terre dans lequel le
cheval marche au pas ou au tro t, plus écouté Sc
plus raccourci que le pas ou le trot ordinaire. Il
tient les jambes plus long-tems en l’air & les pôle
naturellement par terre, enforte qu’il fafte peu de
chemin Sc n’avance pas plus d’un pié à chaque pas
qu’il fait.
Ici on a reprélénté la galopade.
La galopade ou galop de manège eft un galop
en quatre tems , uni,raccourci du devant, a é t if&
prompt des hanches, Sc dont les mouvemens
s’exécutent dans une cadence régulière Sc mefurée.
P L A N C H E V I I I .
, 13. On voit dans ce deflèin un exemple de la v o lte .
Dans la volte le cheval va de deux piftes de côté.
Les jambes de devant décrivent une circonférence,
& celles de derrière une autre. Ces deux circonférences
ont le même centre; on peut dire que dans
la volte, le cheval allant de deux piftes de côté,
décrit un quarré dont les coins font arrondis.
On compte la volte ordinaire Sc la volte ren-
verfée.
Dans la volte ordinaire les hanches du cheval
décrivent la circonférence la plus petite & la plus
rapprochée du centre de la volte , Sc les épaules
marchent fur la plus grande circonférence ou celle
qui eft la plus éloignée du centre.
C ’eft le contraire dans la volte renverfée où les
épaules font tenues plus près du centre d elà volte
Q Ü I T A T I O R
& décrive*t le plus petit cercle, tandis que lés
hanches décrivent le plus grand.
O n a reprélénté une volte ordinaire à droite.
14 . On donne ici un exemple d e pirouette à gauche.
L a pirouette eft une efpece de volte dans la longueur
du cheval ; dans cet air le pié de derrière de
dedans du cheval refte au même point Sc n’a qu’un
mouvement de rotation, le refte du corps du cher
val tourne autour de ce point comme s’il lé mouvoir
fur un pivot. Les épaules du cheval décrivent
donc une circonférence qui a pour rayon la longueur
du cheval, Sc le pié de derrière de dehors
en décrit une fort petite autour du pié de derrière
de dedans.
P L A N C H E I X .
Qui contient le Terre-à-Terre compris dans le s A irs la s &
la Vefade placée au rang des A irs relevés.
F ig . 1 ç. Dans ce deflèin fe Voit le terre-à-terre à droite.
Le terre-à-terre eft un galop en deux tems, qui le
fait de deux piftes, le cheval allant toujours en-
avant Sc de côté : iMeve les deux jambes de devant
à-la fo is , Sc les pofe à terre de même;, celles de
derrière lé lèvent enfuite & fe pofène auflï à terre
en même tems. Le mouvement des jambes de devant
qui fe portent un peu en avant Sc de côte
vers la main où va le cheval, forme le premier
tems. Celui des jambes de derrière qui repetent la
même opération forme le fécond tems.^ Ces moir-
vemens font fort bas Sc très-peu détachés de terre.
A irs relevés;
T ous les fauts qui font plus détachés de terre
que le terre-à-terre, prennent le nom d’a irs relev
é s.T
ous les fàuts lé font en deux tems. L e terre-à-
terre compofé d’une fuite de petits fàuts très-peu
détachés de terre, Sc placé par cette raifon au rang
des airs bas, eft une préparation aux airs relevés,
dans lefquels les fauts d’un cheval font plus élevés
de terre.
On compte d’abord parmi les airs relevés la
p efa d e, qui n’eft point formée par aucun faut, 8c
ne fé ffiit point en deux tems, elle difpofè un che*:
val-à fauter, & lui prépare le devant.
1 6. C e defféin eft un exemple de la pefa de.
Dans cet air le cheval dans une place leve le
devant haut , Sc tient les piés de derrière ferme à
terre fans les avancer ou reculer, ni leur imprimer
aucun mouvement.
P L A N C H E X .
F ig . 17 . C ’eft 1 em éça ir que l’on voit dans ce defféin.'
Le mezair eft un faut ur peu plus relevé que
le terre - à - terre, mais moins écoute Sc plus en-
avant que la courbette ; il tient pofîtivement le
milieu entre l’un & l’autre de ces deux fauts.
18 . Ici eft repréfèntée la courbette.
La courbette eft un faut dans lequel le cheval
fé trouve plus relevé du devant, plus écouté Sc
moins avancé que dans le mézair. Dans cet air
les hanches opèrent un mouvement bas Sc cadencé
dans le moment que les piés de devant retombent
à terre.
P L A N C H E X I .
F ig . 19 . Dans ce defféin fé voit la croupade.
La croupade eft un faut dans lequel le cheval
s’ élève plus haut que dans la courbette; il tient
dans le haut du faut les jambes de derrière retirées
fous Je ventre à égale hauteur que celles du devant,
Sc le plat des fers tournés vers la terre.
20. L a ballottade eft repréfèntée dans ce defféin.
La ballottade eft un faut dans lequel le cheval
s’ etant éjevé Sc tenant fés piés de devant Sc de der-
B A N E :‘G É E Ï ï
riere à hauteur égale, aü-lieti de retirer fés jambes
de derrière fous le ventre comme dans là erou-
pade, il les porte en arriéré feulement autant qu’il
en eft befôin pour montrer les fers, Sc former la
moitié du mouvement qui completteroit une
ruade parfaite.
P L A N C H E X I I .
f ig . 2 1 . C e defféin offre aux yeux un exemple de la ca-
priole.
La capriole eft le plus élevé de tous les fàuts. •
L e cheval étant en l’a ir, à hauteur égale, tant du
devant que du derrière , achevé le mouvement-
dont il n’avoit fait que la moitié dans la ballottade,
mais c’eft avec la plus grande violence qu’il
commence & achevé ce mouvement, & il déta-
xhe la plus vive ruade qu’il lui foit poflible.
On compte encore parmi les airs relevés le p a s
& le fa u t. Nous n’en donnons point l’exemple
■ dans un defféin. L ’ image de cet a ir, que l’on fé
repréféntera aifément dans l’efprit, ne pourroit
pas fé mettre fur le papier raflèmblée en une féule
figure, puifque cet air fé forme en trois tems,
qui doivent exifter l’un après l’autre & s’effàcer
^réciproquement.
Cet air eft compofe d’un tems de terre-à-terre
qui forme le premier de ces trois tems, d’une courbette
qui fait le fécond, & d’une capriole qui
achevé le troifieme, & ainfî alternativement.
Nous allons donner un exemple de quelques
leçons que les favans écuyers ont imaginées pour
affouplir les refforts des chevaux, leur donner
toute la commodité Sc la fu.-ct£ J« » « ;io
fufceptibles, Sc en tirer toute la grâce, toute l’élégance
& toute la pompe que l’on pouvoit en attendre.
'£2. Leçon du p ia fer dans le s p ilie rs .
Le piafer eft l’aétion du trot ou du paffàge fans
avancer, reculer n i fe traverfér.
C ’eft dans les piliers qu’il eft plus aifé de dreflèr
un cheval à cette cadence , qu’en liberté.
Cette leçon donne un beau pli au bras du chev
a l, lui dénoue les. épaules en leur imprimant un
mouvement relevé Sc hardi, lui rend les hanches
liantes, Sc lui ennoblit toute la pofture.
Dans le defféin on voit un écuyer monté für un
cheval qui eft dans l’action du piafer dans les p iliers
; derrière eft un autre écuyer attentif aux mou-
vemens.
P L A N C H E X I I I .
F ig - 2 3 . C e defféin repréfénte la leçon de £ épaule en dedans.
La leçon de l’épaule en-dedans apprend à un
cheval à croifer facilement une jambe par-de flus
l ’autre pour fé mouvoir de côté.
Dans cette leçon un cheval ayant les hanches
p.lus près de la muraille que les épaules environ
d’un pié Sc demi ou deux piés , la tête tournée vers
le centre du fnanege, à la main où il v a , obéit aux
aides de l’écuyer qui le fecourt de là rêne Sc de la
jambe de dedans, Sc paflànt les jambes de dedans
par-deflus celles de dehors, marche en-avant dans
line pofture oblique le long de la muraille. Ses
hanches décrivent une ligne Sc fés épaules une autre
plus éloignée de la muraille que celle des hanches
d’environ deux piés, comme nous l’avons
dit:
t Cette defeription deviendra plus fénfîble par
l’application que nous allons en faire au plan de
yerre de l’épaule en-dedans.
P L A N C H E X I V .
h ig . 24. Plan de terre de l’épaule en-dedans.
M Muraille du manège.
A Ligne des hanches.
, B Ligne des épaules. P Côté du manège dans lequel-un cheval va à droite.
I T X T ï Ô |
P i Pié de derrière de dehors au cheVaïi
P 2 Pié de derrière de dedans.
p a Pié de devant de dehors.
p b Pié de devant de dedaus.
p b 3 Poficiofl du pié de dedans de devant qui vient dé
paflèr circulairement par-deflus le pié de dehors
•de devant , lorfque le cheval a commencé à fe porte
r - en avant dans une pofture obliqué.
p 1 3 Pofîtion du pié de dedans de derrière qui a été
crôifé par-defflis le pié de dehors de derrière ; la
•continuation de ce mouvement produit l’épaule
en-dedans.
D Côté du manège dans lequel un cheval va l’épaule
en-dedans à gàuche.
E Changement de main à droite.
P L A N C H E X V ;
L a Croupe au mur.
F ig . 2 Dans la croupe au mur un cheval marche entièrement
dé côté, la croupe tournée vers la muraille
Sc les épaules .vers le centre du manège. La moitié
des épaules doit marcher avant la croupe, enforte
que fi le cheval va à droite, le pié gauche de devant
doit fé trouver fur la même ligne que le pié
droit de derrière, & cette ligne eft perpendiculaire
à la furface du mur. Les deux lignes que les han*
ches & les épaules décriront feront parallèles Sc
diftantes l’une de l’autre de l’éloignement des piés
de derrière du cheval aux piés de devant. Ces lignes
feront dans une direction droite , la même
que celle du pié du mur ; ce qui fuppofe que le
cer ni reculer. La croupe fera placée à deux piés
de diftance de la muraille pour éviter le frottement
de la queue contre le mur.
L ’encolure du cheval doit former un beau plî
•du côté où il va.
P L A N C H E X V I .
F ig . liS . Plan de terre de la croupe au mur.
m Muraille du manège.
A Ligne des hanches.
B Ligne des épaules.
C Côté du manège dans lequel Je cheval va à droite
D Côté dù manège dans lequel il va à gauche.
E Ligne du milieu du manège, fur laquelle, crainte
qu’un cheval ne s’habitue à fé jetter fur un talon
ou fur l’autre, on le mene à la fin de chaque reprife
6c on le recule, droit d’épaules^& de hanches,
d’une pifte Sc dans la balance des talons.
p Pié de derrière de dehors.
p 2 Pié de derrière de dedans.
p d Pié de devant de dehors.
p b Pié de devant de dedans.
p a 5 Place où fe pofe le pié de dehors de dehors J
lorfque la jambe de dehors de devant paflè par-;
deflus celle de dedans de devant.
p l 3 Place du pié de dehors de derrière qui s’eft avancé
en fé croifànt par-defliis celui de dedans de derrière.
On remarque que dans la leçon de la croupe au
m ur, le mouvement que forment les jambes qui
s’élèvent pour chevaler par-delfus celles qui po-
fent à terre, eft le même que dans la leçon de
l’épaule en-dedans, à l’exception que dans la croupe,
au mur ce mouvement eft plus pénible étant né-
ceffàirement plus circulaire, puifque le cheval va
parfaitement de côté, Sc prefque droit d’épaules
Sc de hanches.
On voit que ces deux dernières leçons d’épaule
en - dedans Sc de croupe au mur, apprennent à un
cheval à fuir les talons aifément & de bonne grâce.
P L A N C H E X V I I .
F ig . 27. Plan de terre de la maniéré de doubler. I l y *
doubler large Sc doubler étroit.
I l faut concevoir Je manège comme un quans
m